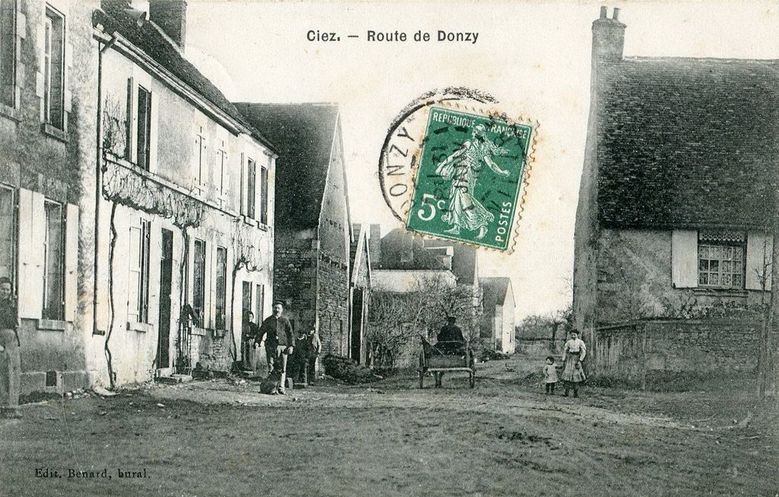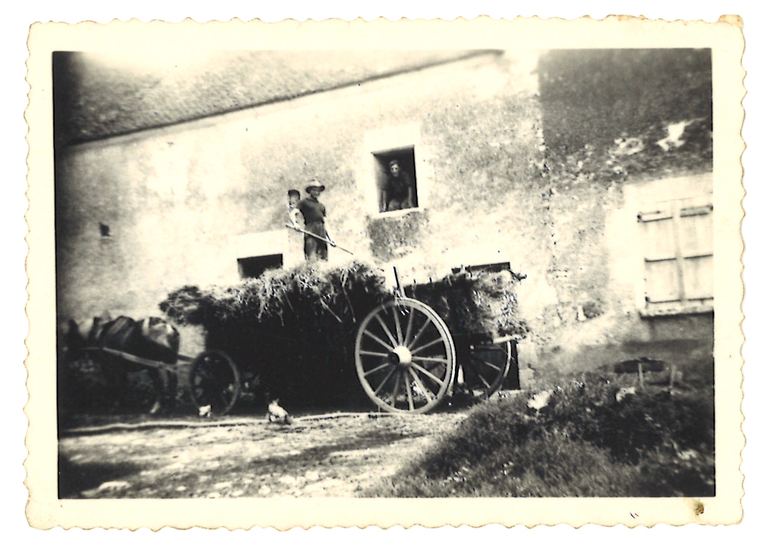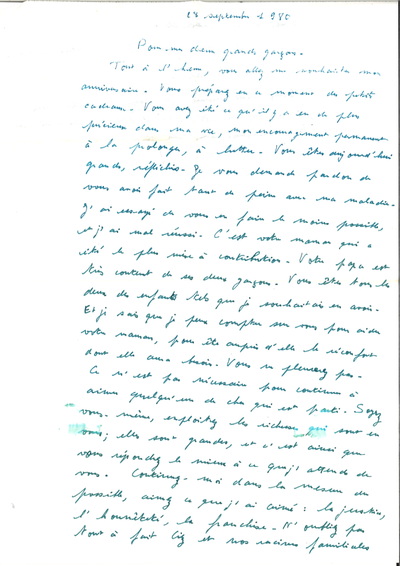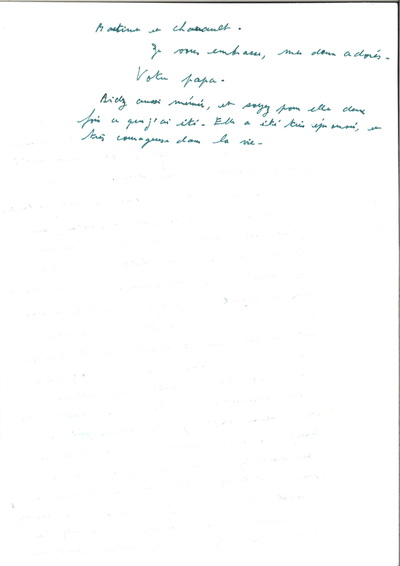l'enfance de PAPA
"Mon père et moi, nous ne nous aimions point par le dehors, nous ne tenions pas l'un à l'autre par nos branches : nous nous aimions par nos racines souterraines." Jules Renard, 28 septembre 1897.
Papa est né le 28 septembre 1937 à Bréau, sur la commune de Perroy, canton de Donzy, dans le nord de la Nièvre. Fils, petit-fils et arrière petit-fils de paysans, il est repéré par son instituteur, et réalise le parcours idéal de l'ascension promise par l'école républicaine: lycée en internat à Cosne-sur-Loire, Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon, puis professorat, agrégation et enfin doctorat. Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Raoul Follereau de Nevers, il était également maire d'Urzy.
Nous savions qu'il avait rédigé quelques chroniques de son enfance, mais nous n'avons trouvé le manuscrit qu'après sa mort, en 1988. Pudeur nivernaise oblige, Ciez est devenu « Briez » et la plupart des noms propres ont été changés. Sauf, en particulier, ceux de ses grand-parents maternels adorés, Suzanne et Edouard Charrault, « l’Douard » figure centrale, ancien combattant, cuisinier, cultivateur et bon vivant. Bizarrement, il n'y parle jamais de ses parents, Eugène et Renée. Je les ai intégrés au récit en scannant presque toutes les photos de famille.
Ces nouvelles ont pour moi le goût de Giono, de Colette de Vincenot et de Pagnol. Elles sont aussi le lien qui nous relie à notre très ancien passé paysan, cette vie simple et rude, presque sans argent, que nos ancêtres vécurent pendant des générations, sans aucun changement pendant des siècles, sur les mêmes terres, avec les mêmes animaux et les mêmes outils, jusqu'à ce que la mécanisation arrive après 1945, l'américanisation de l'agriculture. C'est de ces transformations dont parle mon père, les changements qu'elles opérèrent dans le quotidien, dans le paysage et dans les mentalités. Papa était conscient d'avoir vu un monde, une civilisation disparaître, en quelques décennies, sous ses yeux.
Peut-être se trouvait-il aussi un peu coupable, ayant lui-même quitté la terre, posé son fusil faute de lièvres, et déchaussé ses sabots ?
Visiblement, au-delà de la nostalgie qui sourd et suinte à chaque page, il tenait à nous en laisser une trace, en héritage.
Papa est né le 28 septembre 1937 à Bréau, sur la commune de Perroy, canton de Donzy, dans le nord de la Nièvre. Fils, petit-fils et arrière petit-fils de paysans, il est repéré par son instituteur, et réalise le parcours idéal de l'ascension promise par l'école républicaine: lycée en internat à Cosne-sur-Loire, Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon, puis professorat, agrégation et enfin doctorat. Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Raoul Follereau de Nevers, il était également maire d'Urzy.
Nous savions qu'il avait rédigé quelques chroniques de son enfance, mais nous n'avons trouvé le manuscrit qu'après sa mort, en 1988. Pudeur nivernaise oblige, Ciez est devenu « Briez » et la plupart des noms propres ont été changés. Sauf, en particulier, ceux de ses grand-parents maternels adorés, Suzanne et Edouard Charrault, « l’Douard » figure centrale, ancien combattant, cuisinier, cultivateur et bon vivant. Bizarrement, il n'y parle jamais de ses parents, Eugène et Renée. Je les ai intégrés au récit en scannant presque toutes les photos de famille.
Ces nouvelles ont pour moi le goût de Giono, de Colette de Vincenot et de Pagnol. Elles sont aussi le lien qui nous relie à notre très ancien passé paysan, cette vie simple et rude, presque sans argent, que nos ancêtres vécurent pendant des générations, sans aucun changement pendant des siècles, sur les mêmes terres, avec les mêmes animaux et les mêmes outils, jusqu'à ce que la mécanisation arrive après 1945, l'américanisation de l'agriculture. C'est de ces transformations dont parle mon père, les changements qu'elles opérèrent dans le quotidien, dans le paysage et dans les mentalités. Papa était conscient d'avoir vu un monde, une civilisation disparaître, en quelques décennies, sous ses yeux.
Peut-être se trouvait-il aussi un peu coupable, ayant lui-même quitté la terre, posé son fusil faute de lièvres, et déchaussé ses sabots ?
Visiblement, au-delà de la nostalgie qui sourd et suinte à chaque page, il tenait à nous en laisser une trace, en héritage.
CHRONIQUES NIVERNAISES
JEAN-CLAUDE MARTINET
28 septembre 1937 - 14 avril 1988
JEAN-CLAUDE MARTINET
28 septembre 1937 - 14 avril 1988
Mon village
On tombait dessus à l'improviste, avant d'en avoir soupçonné l'existence, tapi qu'il était derrière ses haies, ses arbres qui dégringolaient sur lui en cascades. On tombait dessus au déboucher d'un chemin creux, poussiéreux ou boueux selon la saison. Le bitume n'avait pas encore aseptisé ma campagne, et les routes étaient “ blanches ” comme on disait, c'est-à-dire seulement empierrées. On surprenait mon village qu'aucun panneau ne signalait, et on avait envie de lui demander pardon de l'avoir dérangé.
Mon village, c'était une sorte de nébuleuse, une quinzaine d'habitations au total, et une église plantée à peu près au centre ; quinze habitations essaimées sur près d'un kilomètre, mais rassemblées en trois groupes nettement distincts les uns des autres, comme trois troupeaux qui font semblant de s'ignorer. Et dans chaque troupeau, les maisons se tenaient encore à distance méfiante les unes des autres, entourées de leurs “ éances ”, leurs ouches, deux ou trois champs clos de haies vives et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Un chemin circulaire, de forme elliptique, reliait les trois groupes, encerclant le village. En faire le tour demandait bien trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour aborder à quinze galaxies différentes, étrangères, parfois hostiles, rassemblées par hasard, tenues de faire ménage vivable.
La ferme de mon père faisait partie du groupement le plus important, celui du nord. Elle présentait deux grands blocs de bâtiments ; l'un réservé uniquement aux granges et aux étables se terminait par un hangar sous lequel nous entassions en été la moisson ; l'autre comprenait la maison d'habitation — quatre pièces en tout, avec grenier au-dessus —, une écurie et une grange. Une grande cour ouverte s'étendait devant les bâtiments, occupée par une pompe monumentale, dont nous balancions le bras tout au long de la journée pour abreuver les bêtes et les gens, et, juste à côté de la pompe, un énorme tas de fumier qui venait buter contre un vieux chêne. En dépit de la proximité de l'eau et du fumier, jamais aucun de nous ne contracta la moindre maladie. Un orme gigantesque, au tronc colossal, tourmenté, couvert de plaies et de bosses veillait, depuis plus d'un siècle, devant la maison d'habitation. Il avait manifestement été planté au moment de la construction, au 19ème siècle, par des gens qui l'avaient investi de multiples missions. Et depuis, il était là, silencieux et tutélaire, témoin des jours de bonheur comme des drames de ma famille, et chaque année il donnait à la façade, tournée vers le midi, une ombre et une relative fraîcheur dont nous nous délections.
La cour était en partie garnie d'herbes sauvages variées, apportées des champs en été, avec le foin et la moisson. Mais le reste était nu, dénivelé, poussiéreux en été, fangeux à la moindre pluie, et pendant tout l'hiver. Nous pataugions dans dix centimètres de boue et de fiente, et bien souvent nous “ gaugions ” : cette pâtée dégoûtante passait par dessus le rebord de nos sabots et souillait nos chaussettes.
Une mare, nous disions un “ crot ”, avait enfin été creusée tout près ; chaque ferme avait sa mare. La notre était cernée d'un demi-cercle d'ormes aussi vieux que le premier. C'était un coin d'ombre et de fraîcheur permanente.
Le temps a passé. Mes parents ont quitté la ferme, rachetée par les Tavard. Les nouveaux propriétaires n'avaient que faire de la maison d'habitation ; ils l'ont vendue à des Parisiens qui sont venus finir leurs jours là. Toutes les maisons d'habitation en vente dans mon village sont acquises par des Parisiens. On les signale dans les journaux : fermette à vendre. Un Parisien se présente, assoiffé de propriété, d'un toit à lui tout seul et d'un lopin de terre. Il achète et se met au travail.
On tombait dessus à l'improviste, avant d'en avoir soupçonné l'existence, tapi qu'il était derrière ses haies, ses arbres qui dégringolaient sur lui en cascades. On tombait dessus au déboucher d'un chemin creux, poussiéreux ou boueux selon la saison. Le bitume n'avait pas encore aseptisé ma campagne, et les routes étaient “ blanches ” comme on disait, c'est-à-dire seulement empierrées. On surprenait mon village qu'aucun panneau ne signalait, et on avait envie de lui demander pardon de l'avoir dérangé.
Mon village, c'était une sorte de nébuleuse, une quinzaine d'habitations au total, et une église plantée à peu près au centre ; quinze habitations essaimées sur près d'un kilomètre, mais rassemblées en trois groupes nettement distincts les uns des autres, comme trois troupeaux qui font semblant de s'ignorer. Et dans chaque troupeau, les maisons se tenaient encore à distance méfiante les unes des autres, entourées de leurs “ éances ”, leurs ouches, deux ou trois champs clos de haies vives et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Un chemin circulaire, de forme elliptique, reliait les trois groupes, encerclant le village. En faire le tour demandait bien trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour aborder à quinze galaxies différentes, étrangères, parfois hostiles, rassemblées par hasard, tenues de faire ménage vivable.
La ferme de mon père faisait partie du groupement le plus important, celui du nord. Elle présentait deux grands blocs de bâtiments ; l'un réservé uniquement aux granges et aux étables se terminait par un hangar sous lequel nous entassions en été la moisson ; l'autre comprenait la maison d'habitation — quatre pièces en tout, avec grenier au-dessus —, une écurie et une grange. Une grande cour ouverte s'étendait devant les bâtiments, occupée par une pompe monumentale, dont nous balancions le bras tout au long de la journée pour abreuver les bêtes et les gens, et, juste à côté de la pompe, un énorme tas de fumier qui venait buter contre un vieux chêne. En dépit de la proximité de l'eau et du fumier, jamais aucun de nous ne contracta la moindre maladie. Un orme gigantesque, au tronc colossal, tourmenté, couvert de plaies et de bosses veillait, depuis plus d'un siècle, devant la maison d'habitation. Il avait manifestement été planté au moment de la construction, au 19ème siècle, par des gens qui l'avaient investi de multiples missions. Et depuis, il était là, silencieux et tutélaire, témoin des jours de bonheur comme des drames de ma famille, et chaque année il donnait à la façade, tournée vers le midi, une ombre et une relative fraîcheur dont nous nous délections.
La cour était en partie garnie d'herbes sauvages variées, apportées des champs en été, avec le foin et la moisson. Mais le reste était nu, dénivelé, poussiéreux en été, fangeux à la moindre pluie, et pendant tout l'hiver. Nous pataugions dans dix centimètres de boue et de fiente, et bien souvent nous “ gaugions ” : cette pâtée dégoûtante passait par dessus le rebord de nos sabots et souillait nos chaussettes.
Une mare, nous disions un “ crot ”, avait enfin été creusée tout près ; chaque ferme avait sa mare. La notre était cernée d'un demi-cercle d'ormes aussi vieux que le premier. C'était un coin d'ombre et de fraîcheur permanente.
Le temps a passé. Mes parents ont quitté la ferme, rachetée par les Tavard. Les nouveaux propriétaires n'avaient que faire de la maison d'habitation ; ils l'ont vendue à des Parisiens qui sont venus finir leurs jours là. Toutes les maisons d'habitation en vente dans mon village sont acquises par des Parisiens. On les signale dans les journaux : fermette à vendre. Un Parisien se présente, assoiffé de propriété, d'un toit à lui tout seul et d'un lopin de terre. Il achète et se met au travail.
Les grands-parents encadrent, les parents sont debout au centre, Papa est assis au milieu.
Nos Parisiens se sont mis au travail. Ils ont porté la main sur la maison où je suis né, où j'ai vécu vingt ans. Je ne veux plus la voir. Ils lui ont arraché son âme. D'abord, le Parisien qui achète une “ fermette ” veut être chez lui, que ça se voie et qu'on le sache. Nos fermes nivernaises n'étaient jamais closes. La façade donnait presque toujours sur la rue, la cour n'était jamais fermée. Le Nivernais n'est pas, je crois, particulièrement ouvert. Ses maisons, si. En passant dans la rue on peut voir le ventre de nos maisons, leurs entrailles : le mobilier, la femme au travail, quand ce n'est pas la scène de ménage. Il ne serait venu à l'idée de personne, originaire du village, de faire clore sa maison d'habitation. Les clôtures, c'est pour les bêtes. L'idée est venue à nos Parisiens. Ils ont commencé par faire abattre le vieil orme, qui leur cachait l'horizon ; s'ils sont venus à la campagne, c'est pour voir la campagne, pas pour ne voir qu'un bout de cour cerné par des arbres. Alors, à quoi bon quitter Paris ? Mais aussi, le Parisien, dont toute la vie a été limitée à la cour intérieure d'un immeuble, ne peut plus se passer de béton. Les miens ont acheté du ciment, du grillage et du fil de fer barbelé, et ils ont fait venir le maçon du coin, et ils ont fait dresser tout autour de leur propriété une jolie petite Muraille de Chine en parpaings barbouillés d'un ciment couleur ciment et surmontée d'une clôture grillagée, fil-de-ferrée, mais non encore électrifiée. Ils ont fait aménager une porte étroite dans la muraille, ils ont acheté deux plaques à la ville. Sur l'une, on lit : “ Propriété privée. Défense d'entrer ”. Sur l'autre : “ Chien méchant ”. Et puis, ils se sont fait forger par le maréchal-ferrant du village, un peu reconverti depuis que les chevaux ont déserté ma campagne, et je comprends ces braves bêtes, une sorte d'enseigne en fer tourmenté à l'espagnole, ils ont appliqué l'enseigne sur la façade de ma maison, et ils ont appelé ma maison “ Lou Bastidou ”. En Nivernais. Je ne veux plus voir ma maison.
Les volets de bois ont été remplacés par des persiennes métalliques, la façade a été recrépie, et le maçon du village a flanqué sur tout cela, avec sa moulinette, un badigeon vaguement lie de vin. Mes Parisiens ont refermé leur porte, acheté un téléviseur. Depuis, on ne les a pour ainsi dire pas revus. Ils attendent la mort derrière leur Muraille de Chine, à “ Lou Bastidou ”. Mais ma maison est déjà morte, comme la moitié du village.
En sortant de la cour, j'avais le choix : prendre sur ma gauche, et descendre le “ Chemin vert ” qui menait aux champs ; ou alors, partir sur la droite, et faire le tour du village. Je passais près du vieil orme, et je laissais sur ma gauche un énorme noyer. Les noyers se sont bien vendus, voici une quinzaine d'années. En face du noyer, retirée au fond d'une cour spacieuse, herbeuse, se tenait une maison d'habitation, modeste mais bien proportionnée ; elle avait été avant ma naissance une petite ferme vivante, qui abritait deux vieux et leurs quelques bêtes. La cour, déserte maintenant, avait vécu de la vie intense des basses-cours, avec des volailles qui se disputent, des chiens qui se poursuivent ; elle avait retenti des bruits de la vie, des cris des hommes, de leurs colères et de leurs rires, du tintement des seaux qui s'entrechoquent, du claquement des sabots qui battent le sol.
Quand je l'ai connue, la petite maison était fermée depuis longtemps. Les deux vieux avaient, à peu de temps l'un de l'autre, franchi pour la dernière fois le seuil, portés par quatre voisins. Les héritiers, de lointains neveux, avaient fermé portes et volets, comme on ferme les paupières des morts. Et le temps avait commencé son travail de lente destruction. Les herbes envahissaient le seuil, des arbustes jaillissaient de derrière les volets. Le toit de vielles tuiles commençait à se déniveler, à s'affaisser. La petite maison n'existe plus, aujourd'hui. On ne distingue plus à sa place qu'un tas de pierres recouvert de ronces et d'orties. Moi seul en ai gardé le souvenir. La petite maison s'est fait hara-kiri, quelque temps avant l'arrivée des Parisiens.
Je longeais ensuite un jardin entouré de sa haie, dans laquelle on avait aussi planté des arbres fruitiers, surtout des quetschiers. C'était le jardin d'Edith. Je me souviens qu'en septembre bien des fois je me suis laissé aller à tendre la main vers les fruits oblongs aux reflets bleutés, dont le parfum inondait le chemin. Je me cachais un peu, mais je ne pense pas qu'Edith m'eût grondé, si elle m'avait surpris. Sa maison, perpendiculaire au jardin, possédait deux façades, l'une tournée au nord, face à la route, l'autre au midi. C'était la seule maison du village qui fût purement résidentielle ; aucune écurie ne la flanquait, seulement une sorte de grange dans laquelle Edith faisait entreposer son bois. C'est côté nord, côté route, que se tenait la vie. Une belle cour, entièrement occupée par une sorte de gazon ras, séparait la maison de la route. Un sentier bien droit, recouvert de gravillons, conduisait à la porte d'entrée, et à chaque printemps Edith faisait sortir son banc de bois vert et cinq énormes baquets qui contenaient des géraniums. L'ensemble faisait un peu froid, et n'était véritablement agréable que par les chaudes après-midi d'été. C'est là que je voyais souvent Edith, assise sur le banc et tricotant.
— Bonjour, Jean, me disait-elle de sa voix douce, de celles qu'on contracte dans la fréquentation assidue des sacristies et des confessionnaux, de celles que l'on compose avec application. Bonjour ! Te voilà parti faire un tour !
Edith était “ le ” notable du village. C'était la seule personne qui vécût “ sans rien faire ” comme nous disions, c'est-à-dire en bourgeoise, de ses rentes. Elle était le plus important propriétaire terrien du village ; c'est elle qui possédait la ferme dans laquelle peinaient mes parents et leurs deux employés — on disait alors “ domestiques ”, comme pour les gens de maison —. J'avais donc pour Edith la crainte et le respect qu'ont les petites gens pour ceux dont ils dépendent. Et puis, pour tous les habitants du village, Edith, outre la grande propriétaire-qui-pouvait-vivre-sans-travailler, c'était aussi un passé exceptionnel, romanesque et à peine croyable dans une campagne aussi conformiste. Elle avait été, cinquante ans plus tôt, un personnage à scandale. Sa “ renommée ” avait gagné plusieurs cantons des environs ; tout le monde connaissait son histoire, et comme on ne l'évoquait devant les enfants qu'en chuchotant et par allusions, je savais que ce devait être un affaire scabreuse. On ne disait jamais, pour désigner notre propriétaire : Mademoiselle Teute, ou Mademoiselle Edith, et encore moins, comme on aurait dû, Madame Gendrot, mais tout simplement Edith.
Sa maison était attenante à celle des Picarnon, et se continuait par une grange, une écurie, l'habitation des Picarnon, deux pièces seulement comme dans la plupart des fermes nivernaises, et enfin une autre écurie ; tout cela, placé sous un même toit, formait une grande bâtisse basse et très allongée. En face, la petite maison de Charles Massery faisait tout à fait maison de retraité, avec sa porte pleine et son unique fenêtre, son petit poulailler appuyé au pignon. Charles Massery s'était retiré là avec la “ Fine ” sa femme quand il avait quitté la ferme qu'il exploitait dans un autre village.
Passée la maison des Picarnon, la route prenait un brusque tournant à angle droit, et, toujours se glissant sous les arbres fruitiers si grands que leurs branches s'embrassaient au-dessus de nous et formaient tunnel, elle entreprenait le tour du village, laissant sur la gauche, à l'écart, la ferme des Ledin, gagnant celle de Plautat. Là, nouveau tournant à gauche à angle droit, nouveau passage sous un tunnel de pommiers, et l'on débouchait sur la place de l'église, à peu près au milieu du village. C'était une vaste place, qui avait été occupée jusqu'au milieu du 19ème siècle par le cimetière. On avait supprimé ce cimetière qui enserrait l'église, soit parce qu'il était devenu trop exigu, soit pour des raisons d'hygiène, et on avait planté des tilleuls. Ils étaient devenus opulents et donnaient à la place de l'église un air de petite ville. Chaque été, au mois de juin, les hommes venaient en couper quelques branches, et toutes les femmes du village arrivaient avec des paniers, attirées comme des abeilles par l'odeur sucrée des fleurs de tilleul. Elles butinaient leur récolte pour une année, et ces fleurs, une fois séchées, donnaient pour tout l'hiver des tisanes que l'on administrait pour un oui ou pour un non, à la moindre fièvre, surtout aux enfants. Les hommes préféraient la “ tisane de Bertignelles ”, c'est-à-dire les vins, blancs et rouges des coteaux de Loire, ou la “ goutte ”.
L'église de mon village était, et est toujours une importante construction, protégée par ses grands tilleuls. On est surpris même par l'ampleur du bâtiment, comparée à la faible population du village, et à sa tiédeur religieuse. Mais c'est qu'elle draine les paysans de plusieurs gros hameaux, et c'est aussi qu'à l'époque de sa construction notre compagne était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. L'édifice date de la première moitié du seizième siècle, comme la plupart de ceux du nord du département. Il est de style gothique flamboyant. Je ne connais dans la région qu'une église qui échappe à la règle, remonte trois siècles plus avant et appartienne à l'art roman. On dirait que la région n'a été peuplée, ou christianisée, que tardivement, au temps de François 1er.
En réalité, je crois que mon village, comme beaucoup d'autres, possédait son édifice cultuel avant le seizième siècle ; peut-être une petite chapelle, ou peut-être une petite église sans voûte, ou même dans quelques cas une humble église romane ; mais toutes ces constructions, et probablement les villages avec, ont dû être rasés plusieurs fois au cours de la Guerre de Cent Ans.
Notre région se trouvait en effet, pour son malheur, située juste aux confins des zones contrôlées depuis Bourges par le dauphin Charles, et de celles occupées par les Anglais, ou plutôt les Bourguignons leurs alliés. Au temps de Jeanne d'Arc, mon village était tenu, comme à peu près tout le Val de Loire, par un seigneur-brigand, Perrinet Gressard, qui possédait toute une série de forteresses face au Berry, depuis Chevenon au sud de Nevers, en passant par la ville fortifiée de La Charité-sur-Loire, son fleuron, jusqu'à La Motte-Josserand au nord de Cosne. Ce coin de terre a dû voir s'affronter Bourguignons et Français, et je me demande comment quelques vilains, parmi lesquels mes ancêtres, ont pu passer au travers des massacres. Ce que je sais, c'est que où que l'on creuse dans mon village, on tombe fatalement sur des amas de crânes et de tibias. Nous vivons sur un charnier.
Les volets de bois ont été remplacés par des persiennes métalliques, la façade a été recrépie, et le maçon du village a flanqué sur tout cela, avec sa moulinette, un badigeon vaguement lie de vin. Mes Parisiens ont refermé leur porte, acheté un téléviseur. Depuis, on ne les a pour ainsi dire pas revus. Ils attendent la mort derrière leur Muraille de Chine, à “ Lou Bastidou ”. Mais ma maison est déjà morte, comme la moitié du village.
En sortant de la cour, j'avais le choix : prendre sur ma gauche, et descendre le “ Chemin vert ” qui menait aux champs ; ou alors, partir sur la droite, et faire le tour du village. Je passais près du vieil orme, et je laissais sur ma gauche un énorme noyer. Les noyers se sont bien vendus, voici une quinzaine d'années. En face du noyer, retirée au fond d'une cour spacieuse, herbeuse, se tenait une maison d'habitation, modeste mais bien proportionnée ; elle avait été avant ma naissance une petite ferme vivante, qui abritait deux vieux et leurs quelques bêtes. La cour, déserte maintenant, avait vécu de la vie intense des basses-cours, avec des volailles qui se disputent, des chiens qui se poursuivent ; elle avait retenti des bruits de la vie, des cris des hommes, de leurs colères et de leurs rires, du tintement des seaux qui s'entrechoquent, du claquement des sabots qui battent le sol.
Quand je l'ai connue, la petite maison était fermée depuis longtemps. Les deux vieux avaient, à peu de temps l'un de l'autre, franchi pour la dernière fois le seuil, portés par quatre voisins. Les héritiers, de lointains neveux, avaient fermé portes et volets, comme on ferme les paupières des morts. Et le temps avait commencé son travail de lente destruction. Les herbes envahissaient le seuil, des arbustes jaillissaient de derrière les volets. Le toit de vielles tuiles commençait à se déniveler, à s'affaisser. La petite maison n'existe plus, aujourd'hui. On ne distingue plus à sa place qu'un tas de pierres recouvert de ronces et d'orties. Moi seul en ai gardé le souvenir. La petite maison s'est fait hara-kiri, quelque temps avant l'arrivée des Parisiens.
Je longeais ensuite un jardin entouré de sa haie, dans laquelle on avait aussi planté des arbres fruitiers, surtout des quetschiers. C'était le jardin d'Edith. Je me souviens qu'en septembre bien des fois je me suis laissé aller à tendre la main vers les fruits oblongs aux reflets bleutés, dont le parfum inondait le chemin. Je me cachais un peu, mais je ne pense pas qu'Edith m'eût grondé, si elle m'avait surpris. Sa maison, perpendiculaire au jardin, possédait deux façades, l'une tournée au nord, face à la route, l'autre au midi. C'était la seule maison du village qui fût purement résidentielle ; aucune écurie ne la flanquait, seulement une sorte de grange dans laquelle Edith faisait entreposer son bois. C'est côté nord, côté route, que se tenait la vie. Une belle cour, entièrement occupée par une sorte de gazon ras, séparait la maison de la route. Un sentier bien droit, recouvert de gravillons, conduisait à la porte d'entrée, et à chaque printemps Edith faisait sortir son banc de bois vert et cinq énormes baquets qui contenaient des géraniums. L'ensemble faisait un peu froid, et n'était véritablement agréable que par les chaudes après-midi d'été. C'est là que je voyais souvent Edith, assise sur le banc et tricotant.
— Bonjour, Jean, me disait-elle de sa voix douce, de celles qu'on contracte dans la fréquentation assidue des sacristies et des confessionnaux, de celles que l'on compose avec application. Bonjour ! Te voilà parti faire un tour !
Edith était “ le ” notable du village. C'était la seule personne qui vécût “ sans rien faire ” comme nous disions, c'est-à-dire en bourgeoise, de ses rentes. Elle était le plus important propriétaire terrien du village ; c'est elle qui possédait la ferme dans laquelle peinaient mes parents et leurs deux employés — on disait alors “ domestiques ”, comme pour les gens de maison —. J'avais donc pour Edith la crainte et le respect qu'ont les petites gens pour ceux dont ils dépendent. Et puis, pour tous les habitants du village, Edith, outre la grande propriétaire-qui-pouvait-vivre-sans-travailler, c'était aussi un passé exceptionnel, romanesque et à peine croyable dans une campagne aussi conformiste. Elle avait été, cinquante ans plus tôt, un personnage à scandale. Sa “ renommée ” avait gagné plusieurs cantons des environs ; tout le monde connaissait son histoire, et comme on ne l'évoquait devant les enfants qu'en chuchotant et par allusions, je savais que ce devait être un affaire scabreuse. On ne disait jamais, pour désigner notre propriétaire : Mademoiselle Teute, ou Mademoiselle Edith, et encore moins, comme on aurait dû, Madame Gendrot, mais tout simplement Edith.
Sa maison était attenante à celle des Picarnon, et se continuait par une grange, une écurie, l'habitation des Picarnon, deux pièces seulement comme dans la plupart des fermes nivernaises, et enfin une autre écurie ; tout cela, placé sous un même toit, formait une grande bâtisse basse et très allongée. En face, la petite maison de Charles Massery faisait tout à fait maison de retraité, avec sa porte pleine et son unique fenêtre, son petit poulailler appuyé au pignon. Charles Massery s'était retiré là avec la “ Fine ” sa femme quand il avait quitté la ferme qu'il exploitait dans un autre village.
Passée la maison des Picarnon, la route prenait un brusque tournant à angle droit, et, toujours se glissant sous les arbres fruitiers si grands que leurs branches s'embrassaient au-dessus de nous et formaient tunnel, elle entreprenait le tour du village, laissant sur la gauche, à l'écart, la ferme des Ledin, gagnant celle de Plautat. Là, nouveau tournant à gauche à angle droit, nouveau passage sous un tunnel de pommiers, et l'on débouchait sur la place de l'église, à peu près au milieu du village. C'était une vaste place, qui avait été occupée jusqu'au milieu du 19ème siècle par le cimetière. On avait supprimé ce cimetière qui enserrait l'église, soit parce qu'il était devenu trop exigu, soit pour des raisons d'hygiène, et on avait planté des tilleuls. Ils étaient devenus opulents et donnaient à la place de l'église un air de petite ville. Chaque été, au mois de juin, les hommes venaient en couper quelques branches, et toutes les femmes du village arrivaient avec des paniers, attirées comme des abeilles par l'odeur sucrée des fleurs de tilleul. Elles butinaient leur récolte pour une année, et ces fleurs, une fois séchées, donnaient pour tout l'hiver des tisanes que l'on administrait pour un oui ou pour un non, à la moindre fièvre, surtout aux enfants. Les hommes préféraient la “ tisane de Bertignelles ”, c'est-à-dire les vins, blancs et rouges des coteaux de Loire, ou la “ goutte ”.
L'église de mon village était, et est toujours une importante construction, protégée par ses grands tilleuls. On est surpris même par l'ampleur du bâtiment, comparée à la faible population du village, et à sa tiédeur religieuse. Mais c'est qu'elle draine les paysans de plusieurs gros hameaux, et c'est aussi qu'à l'époque de sa construction notre compagne était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. L'édifice date de la première moitié du seizième siècle, comme la plupart de ceux du nord du département. Il est de style gothique flamboyant. Je ne connais dans la région qu'une église qui échappe à la règle, remonte trois siècles plus avant et appartienne à l'art roman. On dirait que la région n'a été peuplée, ou christianisée, que tardivement, au temps de François 1er.
En réalité, je crois que mon village, comme beaucoup d'autres, possédait son édifice cultuel avant le seizième siècle ; peut-être une petite chapelle, ou peut-être une petite église sans voûte, ou même dans quelques cas une humble église romane ; mais toutes ces constructions, et probablement les villages avec, ont dû être rasés plusieurs fois au cours de la Guerre de Cent Ans.
Notre région se trouvait en effet, pour son malheur, située juste aux confins des zones contrôlées depuis Bourges par le dauphin Charles, et de celles occupées par les Anglais, ou plutôt les Bourguignons leurs alliés. Au temps de Jeanne d'Arc, mon village était tenu, comme à peu près tout le Val de Loire, par un seigneur-brigand, Perrinet Gressard, qui possédait toute une série de forteresses face au Berry, depuis Chevenon au sud de Nevers, en passant par la ville fortifiée de La Charité-sur-Loire, son fleuron, jusqu'à La Motte-Josserand au nord de Cosne. Ce coin de terre a dû voir s'affronter Bourguignons et Français, et je me demande comment quelques vilains, parmi lesquels mes ancêtres, ont pu passer au travers des massacres. Ce que je sais, c'est que où que l'on creuse dans mon village, on tombe fatalement sur des amas de crânes et de tibias. Nous vivons sur un charnier.
Château de la Motte Josserand, fief du sanguinaire Perrinet-Gressard, tombeur de Jeanne d'Arc.
Au sortir de cette période de guerre et probablement d'épidémies, les rescapés, mes ancêtres, ont vu grand, et je crois qu'ils ont voulu faire un pied de nez aux malheurs passés, un acte de foi dans la vie. Ils ont bâti un grand édifice de quatre travées, avec chœur et transept, le tout recouvert d'une haute voûte ogivale, et surmonté d'un clocher d'ardoise pointu qui pique le ciel. Mais ils n'avaient pas tout à fait oublié les incursions des soldats pillards, et ils ont flanqué l'église de puissantes tours percées d'archères qui lui donnent un peu l'aspect d'une forteresse.
La route longe les tilleuls, et continue, bordée de haies, à desservir les trois noyaux du village. Elle tourne une dernière fois à angle droit, toujours à gauche, et la boucle se referme juste devant notre maison, près de la mare.
Je pouvais aussi, en sortant de la cour de notre ferme, prendre à gauche, et alors je quittais aussitôt le village par le plus beau des chemins qui le desservaient, et que nous appelions le “ Chemin vert ”.
C'était un chemin encaissé entre deux talus plantés de haies. En fait, ce sont des arbres fruitiers qui l'ombrageaient au départ. Il y en avait de toutes sortes, pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers ; ils nous appartenaient ; je veux dire, ils appartenaient à Edith. Les fermiers ne possédaient pas l'arbre, ils n'avaient droit qu'aux fruits ; nous en consommions tout au long de l'année. La saison commençait en juin avec de grosses prunes d'un violet foncé, peu sucrées, que nous appelions “ macariées ” ; leur rustaude âcreté nous faisait grimacer, mais c'étaient les premiers fruits de l'année, ils annonçaient un renouveau, la pâque de la terre. Venaient ensuite les pommes de moisson, au mois de juillet, et cela ne finissait plus, jusqu'en novembre où nous cueillons avec dévotion les longues “ poires d'épine ”, dites aussi “ poires de curé ”, que nous allongions avec précaution sur le plancher du grenier, l'une à côté de l'autre, sans qu'elles se touchent surtout, comme de petits soldats morts au combat. Elles reposaient là, se “ faisaient ” jusqu'au mois de janvier, et à partir de ce moment nous offraient, jusqu'en avril, leur chair blanche, délicatement parfumée, sous une peau un peu fripée.
Nos grands-parents avaient la religion de l'arbre. Chaque génération avait à cœur d'enrichir le patrimoine familial en en plantant, en en greffant de nouveaux.
Mais le dieu-tracteur est arrivé. Il ne pouvait s'accommoder du bocage. On lui a tout sacrifié, on a remembré les champs, livré au bulldozer les haies vives et les arbres sans discernement, sans exception, sans remords. On a nivelé le paysage, dénudé la terre, vouée désormais aux rendements intensifs du blé et du colza. Et aujourd'hui, les petits-fils des vieux sages qui plantaient un arbre comme on met au monde un enfant, achètent des pommes “ golden ” sous cellophane, d'un bout à l'autre de l'année. Ils achètent aussi leur lait — en poudre — et leur œufs.
Maintenant, ils vivent comme à la ville.
La route longe les tilleuls, et continue, bordée de haies, à desservir les trois noyaux du village. Elle tourne une dernière fois à angle droit, toujours à gauche, et la boucle se referme juste devant notre maison, près de la mare.
Je pouvais aussi, en sortant de la cour de notre ferme, prendre à gauche, et alors je quittais aussitôt le village par le plus beau des chemins qui le desservaient, et que nous appelions le “ Chemin vert ”.
C'était un chemin encaissé entre deux talus plantés de haies. En fait, ce sont des arbres fruitiers qui l'ombrageaient au départ. Il y en avait de toutes sortes, pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers ; ils nous appartenaient ; je veux dire, ils appartenaient à Edith. Les fermiers ne possédaient pas l'arbre, ils n'avaient droit qu'aux fruits ; nous en consommions tout au long de l'année. La saison commençait en juin avec de grosses prunes d'un violet foncé, peu sucrées, que nous appelions “ macariées ” ; leur rustaude âcreté nous faisait grimacer, mais c'étaient les premiers fruits de l'année, ils annonçaient un renouveau, la pâque de la terre. Venaient ensuite les pommes de moisson, au mois de juillet, et cela ne finissait plus, jusqu'en novembre où nous cueillons avec dévotion les longues “ poires d'épine ”, dites aussi “ poires de curé ”, que nous allongions avec précaution sur le plancher du grenier, l'une à côté de l'autre, sans qu'elles se touchent surtout, comme de petits soldats morts au combat. Elles reposaient là, se “ faisaient ” jusqu'au mois de janvier, et à partir de ce moment nous offraient, jusqu'en avril, leur chair blanche, délicatement parfumée, sous une peau un peu fripée.
Nos grands-parents avaient la religion de l'arbre. Chaque génération avait à cœur d'enrichir le patrimoine familial en en plantant, en en greffant de nouveaux.
Mais le dieu-tracteur est arrivé. Il ne pouvait s'accommoder du bocage. On lui a tout sacrifié, on a remembré les champs, livré au bulldozer les haies vives et les arbres sans discernement, sans exception, sans remords. On a nivelé le paysage, dénudé la terre, vouée désormais aux rendements intensifs du blé et du colza. Et aujourd'hui, les petits-fils des vieux sages qui plantaient un arbre comme on met au monde un enfant, achètent des pommes “ golden ” sous cellophane, d'un bout à l'autre de l'année. Ils achètent aussi leur lait — en poudre — et leur œufs.
Maintenant, ils vivent comme à la ville.
Papa et son Papa, et son chien.
Les ormes
J'aimais à descendre le “ Chemin vert ” à la fin février ou au début de mars, aux premiers rayons du soleil nouveau. Ils commençaient à chauffer le talus exposé au midi, et très tôt apparaissaient, presque incongrues dans l'herbe brûlée par le gel et la neige, les premières violettes. Deux mois plus tard, les haies se faisaient processions de premières communiantes avec leurs robes blanches d'aubépines. A ce moment, quelque choses se serrait dans ma poitrine, remontait à ma gorge. Je ressentais de délicieuses angoisses.
Mais ce qui faisait, en toutes saisons, la noblesse du “ Chemin vert ”, c'étaient ses vieux ormes qui de chaque côté le bordaient, alignés comme de vieux grognards ; leur peau était craquelée, épaisse comme celle des crocodiles, ou des hippopotames. Les vieux ormes portaient sur eux les cicatrices du temps, les blessures des hommes et celles des bêtes, deux cents ans de l'histoire et des malheurs de mon village : les uns montraient des chancres suintants, d'autres, de monstrueuses excroissances.
Les vieux ormes, depuis deux cents ans, donnaient tout ce qu'ils pouvaient aux hommes qui les avaient plantés là, leur ombre en été, mais aussi leur bois de chauffage lorsqu'on les étêtait tous les quinze ans. Et quand les étés arides desséchaient les champs, que le bétail risquait la mort, et les hommes la famine, on s'adressait encore aux ormes ; on les dépouillait de leurs basses branches, et l'on sauvait le troupeau avec leur feuillage.
Les vieux ormes parfois mouraient. Ils s'abattaient alors en travers du chemin, et les hommes les couchaient dans la haie, près des leurs. Les orties et les ronces les recouvraient peu à peu, et ils pourrissaient là, comme les autres arbres, comme les autres êtres, comme les hommes que l'on ensevelissait dans le cimetières de colline. Mais les vieux ormes donnaient leur substance aux survivants, et sur leur cadavre croissant le plus merveilleux des champignons, l'ormelle, que nous appelions “ oreille d'orme ”.
Une connivence s'était rapidement établie entre les vieux ormes et moi. Je leur disais tout. Ils ne répondaient pas, ne frémissaient point, mais je sentais bien leur muette compréhension.
Les vieux ormes ne se plaignaient jamais, mais ils nous regardaient passer depuis des générations dans ce chemin. Ils étaient notre mémoire, un morceau de la conscience collective des villageois.
Les vieux ormes ont été bousculés comme tous les autres arbres, comme les haies ; ils ont été écartelés, étripés, traînes, entassés. On les a arrosés de fuel, farcis de vieux pneus, et on les a fait brûler.
Je n'ai plus de mémoire, plus d'enfance. Je ne veux plus me rappeler les vieux ormes et le “ Chemin vert ”.
Je ne veux plus savoir qu'il conduisait à des champs qui se nommaient “ Langrelles ”, “ Sauveur ” et “ Paradis ”, “ Vallée de la Sourde ” et “ Castines ”, et puis aussi “ Ch'tis prés ”. Il ne faut pas que je me souvienne de l'herbe fraîche et haute des “ Ch'tis prés ”, de l'eau qui les envahissait en hiver, des oiseaux étranges qui alors s'y abattaient à nuit tombante, des canards sauvages et des vanneaux que j'essayais d'approcher au plus près, en rampant. Il ne faut pas. Cela n'est plus. Ou alors, j'ai rêvé.
J'aimais à descendre le “ Chemin vert ” à la fin février ou au début de mars, aux premiers rayons du soleil nouveau. Ils commençaient à chauffer le talus exposé au midi, et très tôt apparaissaient, presque incongrues dans l'herbe brûlée par le gel et la neige, les premières violettes. Deux mois plus tard, les haies se faisaient processions de premières communiantes avec leurs robes blanches d'aubépines. A ce moment, quelque choses se serrait dans ma poitrine, remontait à ma gorge. Je ressentais de délicieuses angoisses.
Mais ce qui faisait, en toutes saisons, la noblesse du “ Chemin vert ”, c'étaient ses vieux ormes qui de chaque côté le bordaient, alignés comme de vieux grognards ; leur peau était craquelée, épaisse comme celle des crocodiles, ou des hippopotames. Les vieux ormes portaient sur eux les cicatrices du temps, les blessures des hommes et celles des bêtes, deux cents ans de l'histoire et des malheurs de mon village : les uns montraient des chancres suintants, d'autres, de monstrueuses excroissances.
Les vieux ormes, depuis deux cents ans, donnaient tout ce qu'ils pouvaient aux hommes qui les avaient plantés là, leur ombre en été, mais aussi leur bois de chauffage lorsqu'on les étêtait tous les quinze ans. Et quand les étés arides desséchaient les champs, que le bétail risquait la mort, et les hommes la famine, on s'adressait encore aux ormes ; on les dépouillait de leurs basses branches, et l'on sauvait le troupeau avec leur feuillage.
Les vieux ormes parfois mouraient. Ils s'abattaient alors en travers du chemin, et les hommes les couchaient dans la haie, près des leurs. Les orties et les ronces les recouvraient peu à peu, et ils pourrissaient là, comme les autres arbres, comme les autres êtres, comme les hommes que l'on ensevelissait dans le cimetières de colline. Mais les vieux ormes donnaient leur substance aux survivants, et sur leur cadavre croissant le plus merveilleux des champignons, l'ormelle, que nous appelions “ oreille d'orme ”.
Une connivence s'était rapidement établie entre les vieux ormes et moi. Je leur disais tout. Ils ne répondaient pas, ne frémissaient point, mais je sentais bien leur muette compréhension.
Les vieux ormes ne se plaignaient jamais, mais ils nous regardaient passer depuis des générations dans ce chemin. Ils étaient notre mémoire, un morceau de la conscience collective des villageois.
Les vieux ormes ont été bousculés comme tous les autres arbres, comme les haies ; ils ont été écartelés, étripés, traînes, entassés. On les a arrosés de fuel, farcis de vieux pneus, et on les a fait brûler.
Je n'ai plus de mémoire, plus d'enfance. Je ne veux plus me rappeler les vieux ormes et le “ Chemin vert ”.
Je ne veux plus savoir qu'il conduisait à des champs qui se nommaient “ Langrelles ”, “ Sauveur ” et “ Paradis ”, “ Vallée de la Sourde ” et “ Castines ”, et puis aussi “ Ch'tis prés ”. Il ne faut pas que je me souvienne de l'herbe fraîche et haute des “ Ch'tis prés ”, de l'eau qui les envahissait en hiver, des oiseaux étranges qui alors s'y abattaient à nuit tombante, des canards sauvages et des vanneaux que j'essayais d'approcher au plus près, en rampant. Il ne faut pas. Cela n'est plus. Ou alors, j'ai rêvé.
Edouard tient les rênes, pépère.
Céline - Eté 1949
Céline… Tu étais déjà une ombre… Et tu es devenue maintenant l'ombre des ombres. Tu étais je pense le personnage le plus terne de mon village. Pourquoi est-ce toi qui, précisément maintenant, as laissé la trace la plus nette dans la trame de mes souvenirs ? Peut-être parce que tu résumes et rassembles en toi tous les êtres qui s'entrevivaient dans ce petit rassemblis de maisons perdues au fond du bocages nivernais. Enfin, ce qui fut le bocage nivernais, et qu'aucun de ces êtres qui défilent dans ma mémoire, cortège de noirs vieillards depuis longtemps disparus, ne reconnaîtrait.
De ce passé, de mon enfance, tout a disparu. Bêtes et gens depuis longtemps sont retournés à la terre, le bocage, pulvérisé par les bulldozers a été gommé, remplacé par une sorte de no man’s land, la plupart du temps jaunâtre. Si bien que j'évoque un pays qui pourrait être parfaitement imaginaire, qui n'a laissé aucune trace, sinon en moi, et qui pourtant fut bien réel.
Oui, pourquoi de ce monde des ombres, est-ce la plus grise d'entre toutes qui émerge ? On l'appelait Céline. Céline, c'est tout. Pas de nom de famille. Pour moi, c'était Céline l'énigmatique, Céline la mystérieuse. La désigner ainsi suffisait à tout le monde, comme il suffit au paysan de dire : la Jaunette. Ou la Bichette. Aussi, en quoi était-il besoin d'en dire plus ? En quoi différait-elle de l'une des vaches que, deux fois par jour, elle menait aux champs ? Pour l'enfant que j'étais, elle apparaissait comme parfaitement impropre à toute datation : elle était vieille, très vieille, et l'avait sans aucun doute toujours été. Petite bonne femme courbée sur son bâton, conduite sagement par ses vaches. Le grand chien fou qui l'aidait à maintenir un ordre que rien en fait ne troublait dans ce maigre troupeau de six bêtes malingres semblait tout à fait indépendant de la gardienne, et ne se souciait pas plus d'elle qu'aucun autre habitant de Briez.
Je la voyais presque chaque jour passer, contourner la mare ronde qu'ombrageaient une demi-douzaine d'ormes, je la voyais passer, guillemet noir fermant la phrase de son petit troupeau de charolais blancs. Une chauve-souris vêtue d'oripeaux sombres, échappée d'un passé lointain, oubliée par la mort, une survivance en somme, comme la coiffe nivernaise qu'elle était la dernière du village à porter. Petite face de guenon, jaune terreux, ridée comme une pomme au bout de l'hiver. La crasse tapissait le réseau dense des rides de son visage. D'un bout à l'autre de l'année, Céline allait, derrière ses bêtes, petit pantin mécanique, silencieux, au regard hébété, vaguement rêveur, tout comme celui de ses vaches.
J'ignore quand tu es arrivée à Briez. Je sais seulement que tu n'as pas toujours habité parmi nous. Je crois même que tu as goûté un peu de la ville, je veux dire de Paris, dans ta jeunesse. C'est ce que disent les gens, mais j'ai de la peine à le croire, à croire que tu as eu une jeunesse. Pourtant, il t'est resté de cette époque, je le reconnais, quelques expressions, des intonations qui ne ressortissent pas à notre patois. Quand tu parles de ton mari, tu ne dis pas “ moun houmme ”, comme les paysannes de mon village, tu dis : “ Défunt mon mari qu'est mort ”. Je dois donc reconnaître que tu viens d'ailleurs, que tu as eu une autre vie, avant la vie animale que je te vois maintenant mener.
Céline, je te sens différente. Je t'imagine un passé fabuleux. C'est pour cela que j'ai demandé au père Massery, mon vieux voisin bourru, moustachu, ce qu'il savait de toi.
— Oh, p'tit, qu'est-ce que ça peut te faire ?
— Mais tout de même, dis-moi… je voudrais savoir : elle n'est pas d'ici ?
Le vieux regarde ailleurs, et s'il pouvait dissimuler tout son visage derrière sa grosse moustache, je crois bien qu'il le ferait.
— Non. Elle n'est pas d'ici. Mais il y a un moment qu'elle est arrivée… Oui, ça fait longtemps… Tu n'étais pas encore “ au monde ”.
Là-dessus, il remonte des deux mains son vieux pantalon de coutil bleu, placardé de larges pièces. Le pantalon n'en demandait pas tant, mais cela signifiait : allons, n'en parlons plus. J'insiste :
— Pourquoi est-elle venue ?
Le vieux cette fois me regarde. On distingue à peine l'iris de ses yeux à travers le fente étroite de des paupières lourdes. Visage inexpressif, un peu bouffi comme ceux des buveurs. Il grogne dans sa moustache, plutôt qu'il ne parle :
— Elle est arrivée après la mort de la mère Plautat… Oui. Plautat était malade. Heu…heu…heu…
Ça y est, Charles Massery va parler, puisqu'il a retrouvé son rire. Enfin, ce qui lui sert de rire, ce heu…heu…heu…, c'est un rire de remplacement, parce que Charles Massery ne rit jamais. Et à la réflexion, quand je fais défiler, les unes après les autres toutes les ombres de mon village dans ma mémoire, je m'aperçois qu'elles ne riaient jamais. Jamais vraiment. Des pseudo-rires, oui. Mais le rire franc, le rire explosant, personne, mis à part grand-père et mon père, non, personne n'en connaissait le secret. C'étaient toujours des rires apprêtés, des rires faux-jeton. Je suppose que chez les vignerons de Bouilly, ou de Bourgogne, on se laisse aller au rire qui explose, au rire à poitrine ouverte. Dans mon village, les poitrines étaient fermées et aussi les cœurs.
Heu… heu… heu… il va parler :
— Enfin, malade… malade imaginaire, oui. Quelque temps après la mort de sa vieille, il s'est fait venir un dictionnaire où c'est qu'on trouve toutes les maladies que “ l'yab ” il a inventées, et puis il s'est couché. Il passait son temps à se regarder dans une glace, à tirer la langue, à s'abaisser les paupières, à se tâter de partout. Il changeait de maladie tous les jours et se croyait “ condamné ”. Mé dévie qu'la mort de sa femme, ça lui avait comme qui dirait tourné la ciboule. Il ne se levait plus, mais il mangeait, le bougre ! Il était devenu tout gros, tout gras. Il ne supportait plus sa fille, ni surtout Domet, son gendre, qu'il a jamais pu “ encaisser ”… Oui, neurasthénique, v'la ce qu'il était. Mais pas plus malade que toi et moi.
— Mais ses bêtes, qui s'en occupait ?
— Ses bêtes ? Heu… heu… heu… elles étaient sûrement plus malades que lui ! Ses vaches, c'était une peau tendue sur des os. Et puis, un mauvais poil long, qu'elles gardaient toute l'année. Il ne “ faisait ” plus ses champs. Ils sont retournés en friches. Des arbres ont commencé à pousser dedans, et puis des “ aronces ”… Tu les connais, les champs à Plautat, à c’t'heure ? V'là que ça devient des taillis. Combien ça fait de temps qu'ils n'ont pas vus la queue d'une charrue ? Hein, combien qu'ça fait de temps ? On est en 49, sa vieille est morte en 35, ça fait à peu près ce temps-là. Oui, c'est ça, fait le vieux après un silence, le regard vague. A peu près ce temps-là qu'ils n'ont pas vu le soc de la charrue, ses champs…
— Mais Domet, il ne pouvait pas faire le travail, lui ?
— Domet ? Heu… heu… heu… J'te l'ai déjà dit, que l'vieux n'a jamais pu l'encaisser. Il n'a jamais digéré le mariage de sa fille avec Domet. Pourquoi, ça j'sais pas… Peut-êt’ bien parce que le Domet, il avait “ pas ène roe d'terre ” ! Tout ce que je sais, c'est que quand Domet venait “ à la fumelle ” chez Plautat, il se cachait… même qu'un jour, l'vieux les a surpris, et, dame, le Domet, heureusement qu'il était jeune et “ drut ”, parce qu'il a fallu qu'il saute par la fenêtre, c'est moi qui te l'dis ! Le vieux avait pris un gourdin… ah ! il était pas malade à c'moment-là ! Heu… heu… heu…
Je crois bien que Charles Massery, cette fois, rit pour de bon, à l'idée de Domet sautant par la fenêtre.
— Si bien que, tu comprends, l'vieux, y n'tient pas du tout à ce que Domet fasse ses terres à sa place… Me dévie qu'ça lui donnerait trop d'importance.
Silence. Charles Massery hésite. Il reprend, plus bas, il s'arrête souvent, comme gêné :
— Et puis, tu le sais bien comme moi, y a pas plus feignant que Domet… Je ne sais pas s'il y tient tant que ça, à “ faire aller ” les terres du beau-père. C'est “ yée ” un paysan… Toujours à chercher de l'ouvrage… en priant “ l'bon yeu ” de n'pas en trouver… Depuis quelque temps, il a trouvé le moyen : il va “ faire du bois ”. J'voudrais bien savoir combien de cordes il empile dans sa journée… Il peut pas faire de bois, il est tout le temps chez lui… un jour il a mal aux reins, un autre jour, il fait grève… parce qu'ils ont un syndicat, les “ beuchtons ”, et ça fait grève… euh là, qu'c'en est honteux !
La voix du père Massery gronde. Manifestement, les syndicats, il n'est pas pour ; d'abord, ce n'est pas une “ affaire qui s'faisait de son temps ”. En quoi il se trompe, parce que les bûcherons de la Nièvre, et de tout le centre de la France ont été les premiers ouvriers à s'organiser en puissants syndicats, dès la fin du 19ème siècle. Mais Massery, lui, est un paysan. Pas un bûcheron. Pas un ouvrier. Il ignore tout des “ beuch'tons ” comme il dit avec mépris. Deux mondes qui cohabitent dans le même village, et s'ignorent. Il reprend, railleur :
— Il arrive le matin dans sa coupe ; il trouve deux brindilles entrecroisées sur sa “ chieuve ”, enfin, sa chèvre, son “ chigot ”, tu sais bien, pour poser le bois quand on le scie : les deux brindilles, ça veut dire que le chef (c'est le responsable du syndicat pour Massery) a décidé qu'aujourd'hui on ferait grève. Eh bien, mon Domet, il se le fait pas dire deux fois ! Il revient vite à la maison ! Feignant, que j'te dis !
Tout cela est très bien, mais nous avons un peu oublié Céline. J'insiste.
— La Céline ? Elle a débarqué un beau jour ici, à Briez. Je t'ai dit, t'étais pas encore “ au monde ”, ou en tout cas tout juste. Elle était comme à c’t'heure, ni plus vieille, ni moins. Y en a quelques-uns qui l'ont vue arriver (pas moi), déjà courbée, un grand sac de touille en toile où c'est qu'elle avait mis tout son “ bien ”. On s'demandait bien c'que c'était, et puis, où ça allait… Eh bien, c'est allé chez l'vieux Plautat. On a dit par la suite qu'il avait mis une annonce dans un journal, comme quoi il avait besoin d'une domestique… heu… heu… heu… il l'a eue, sa domestique, et puis tout le reste ! Cette fois, les rides du père Massery se plissent d'amusement, au coin des yeux. Je ne lui avais jamais vu cet air là. Au reste, je n'avais pas compris les derniers mots. Ce n'est que plus tard que je saurai ce qu'il voulait dire par “ et puis tout le reste ”.
Céline… Tu étais déjà une ombre… Et tu es devenue maintenant l'ombre des ombres. Tu étais je pense le personnage le plus terne de mon village. Pourquoi est-ce toi qui, précisément maintenant, as laissé la trace la plus nette dans la trame de mes souvenirs ? Peut-être parce que tu résumes et rassembles en toi tous les êtres qui s'entrevivaient dans ce petit rassemblis de maisons perdues au fond du bocages nivernais. Enfin, ce qui fut le bocage nivernais, et qu'aucun de ces êtres qui défilent dans ma mémoire, cortège de noirs vieillards depuis longtemps disparus, ne reconnaîtrait.
De ce passé, de mon enfance, tout a disparu. Bêtes et gens depuis longtemps sont retournés à la terre, le bocage, pulvérisé par les bulldozers a été gommé, remplacé par une sorte de no man’s land, la plupart du temps jaunâtre. Si bien que j'évoque un pays qui pourrait être parfaitement imaginaire, qui n'a laissé aucune trace, sinon en moi, et qui pourtant fut bien réel.
Oui, pourquoi de ce monde des ombres, est-ce la plus grise d'entre toutes qui émerge ? On l'appelait Céline. Céline, c'est tout. Pas de nom de famille. Pour moi, c'était Céline l'énigmatique, Céline la mystérieuse. La désigner ainsi suffisait à tout le monde, comme il suffit au paysan de dire : la Jaunette. Ou la Bichette. Aussi, en quoi était-il besoin d'en dire plus ? En quoi différait-elle de l'une des vaches que, deux fois par jour, elle menait aux champs ? Pour l'enfant que j'étais, elle apparaissait comme parfaitement impropre à toute datation : elle était vieille, très vieille, et l'avait sans aucun doute toujours été. Petite bonne femme courbée sur son bâton, conduite sagement par ses vaches. Le grand chien fou qui l'aidait à maintenir un ordre que rien en fait ne troublait dans ce maigre troupeau de six bêtes malingres semblait tout à fait indépendant de la gardienne, et ne se souciait pas plus d'elle qu'aucun autre habitant de Briez.
Je la voyais presque chaque jour passer, contourner la mare ronde qu'ombrageaient une demi-douzaine d'ormes, je la voyais passer, guillemet noir fermant la phrase de son petit troupeau de charolais blancs. Une chauve-souris vêtue d'oripeaux sombres, échappée d'un passé lointain, oubliée par la mort, une survivance en somme, comme la coiffe nivernaise qu'elle était la dernière du village à porter. Petite face de guenon, jaune terreux, ridée comme une pomme au bout de l'hiver. La crasse tapissait le réseau dense des rides de son visage. D'un bout à l'autre de l'année, Céline allait, derrière ses bêtes, petit pantin mécanique, silencieux, au regard hébété, vaguement rêveur, tout comme celui de ses vaches.
J'ignore quand tu es arrivée à Briez. Je sais seulement que tu n'as pas toujours habité parmi nous. Je crois même que tu as goûté un peu de la ville, je veux dire de Paris, dans ta jeunesse. C'est ce que disent les gens, mais j'ai de la peine à le croire, à croire que tu as eu une jeunesse. Pourtant, il t'est resté de cette époque, je le reconnais, quelques expressions, des intonations qui ne ressortissent pas à notre patois. Quand tu parles de ton mari, tu ne dis pas “ moun houmme ”, comme les paysannes de mon village, tu dis : “ Défunt mon mari qu'est mort ”. Je dois donc reconnaître que tu viens d'ailleurs, que tu as eu une autre vie, avant la vie animale que je te vois maintenant mener.
Céline, je te sens différente. Je t'imagine un passé fabuleux. C'est pour cela que j'ai demandé au père Massery, mon vieux voisin bourru, moustachu, ce qu'il savait de toi.
— Oh, p'tit, qu'est-ce que ça peut te faire ?
— Mais tout de même, dis-moi… je voudrais savoir : elle n'est pas d'ici ?
Le vieux regarde ailleurs, et s'il pouvait dissimuler tout son visage derrière sa grosse moustache, je crois bien qu'il le ferait.
— Non. Elle n'est pas d'ici. Mais il y a un moment qu'elle est arrivée… Oui, ça fait longtemps… Tu n'étais pas encore “ au monde ”.
Là-dessus, il remonte des deux mains son vieux pantalon de coutil bleu, placardé de larges pièces. Le pantalon n'en demandait pas tant, mais cela signifiait : allons, n'en parlons plus. J'insiste :
— Pourquoi est-elle venue ?
Le vieux cette fois me regarde. On distingue à peine l'iris de ses yeux à travers le fente étroite de des paupières lourdes. Visage inexpressif, un peu bouffi comme ceux des buveurs. Il grogne dans sa moustache, plutôt qu'il ne parle :
— Elle est arrivée après la mort de la mère Plautat… Oui. Plautat était malade. Heu…heu…heu…
Ça y est, Charles Massery va parler, puisqu'il a retrouvé son rire. Enfin, ce qui lui sert de rire, ce heu…heu…heu…, c'est un rire de remplacement, parce que Charles Massery ne rit jamais. Et à la réflexion, quand je fais défiler, les unes après les autres toutes les ombres de mon village dans ma mémoire, je m'aperçois qu'elles ne riaient jamais. Jamais vraiment. Des pseudo-rires, oui. Mais le rire franc, le rire explosant, personne, mis à part grand-père et mon père, non, personne n'en connaissait le secret. C'étaient toujours des rires apprêtés, des rires faux-jeton. Je suppose que chez les vignerons de Bouilly, ou de Bourgogne, on se laisse aller au rire qui explose, au rire à poitrine ouverte. Dans mon village, les poitrines étaient fermées et aussi les cœurs.
Heu… heu… heu… il va parler :
— Enfin, malade… malade imaginaire, oui. Quelque temps après la mort de sa vieille, il s'est fait venir un dictionnaire où c'est qu'on trouve toutes les maladies que “ l'yab ” il a inventées, et puis il s'est couché. Il passait son temps à se regarder dans une glace, à tirer la langue, à s'abaisser les paupières, à se tâter de partout. Il changeait de maladie tous les jours et se croyait “ condamné ”. Mé dévie qu'la mort de sa femme, ça lui avait comme qui dirait tourné la ciboule. Il ne se levait plus, mais il mangeait, le bougre ! Il était devenu tout gros, tout gras. Il ne supportait plus sa fille, ni surtout Domet, son gendre, qu'il a jamais pu “ encaisser ”… Oui, neurasthénique, v'la ce qu'il était. Mais pas plus malade que toi et moi.
— Mais ses bêtes, qui s'en occupait ?
— Ses bêtes ? Heu… heu… heu… elles étaient sûrement plus malades que lui ! Ses vaches, c'était une peau tendue sur des os. Et puis, un mauvais poil long, qu'elles gardaient toute l'année. Il ne “ faisait ” plus ses champs. Ils sont retournés en friches. Des arbres ont commencé à pousser dedans, et puis des “ aronces ”… Tu les connais, les champs à Plautat, à c’t'heure ? V'là que ça devient des taillis. Combien ça fait de temps qu'ils n'ont pas vus la queue d'une charrue ? Hein, combien qu'ça fait de temps ? On est en 49, sa vieille est morte en 35, ça fait à peu près ce temps-là. Oui, c'est ça, fait le vieux après un silence, le regard vague. A peu près ce temps-là qu'ils n'ont pas vu le soc de la charrue, ses champs…
— Mais Domet, il ne pouvait pas faire le travail, lui ?
— Domet ? Heu… heu… heu… J'te l'ai déjà dit, que l'vieux n'a jamais pu l'encaisser. Il n'a jamais digéré le mariage de sa fille avec Domet. Pourquoi, ça j'sais pas… Peut-êt’ bien parce que le Domet, il avait “ pas ène roe d'terre ” ! Tout ce que je sais, c'est que quand Domet venait “ à la fumelle ” chez Plautat, il se cachait… même qu'un jour, l'vieux les a surpris, et, dame, le Domet, heureusement qu'il était jeune et “ drut ”, parce qu'il a fallu qu'il saute par la fenêtre, c'est moi qui te l'dis ! Le vieux avait pris un gourdin… ah ! il était pas malade à c'moment-là ! Heu… heu… heu…
Je crois bien que Charles Massery, cette fois, rit pour de bon, à l'idée de Domet sautant par la fenêtre.
— Si bien que, tu comprends, l'vieux, y n'tient pas du tout à ce que Domet fasse ses terres à sa place… Me dévie qu'ça lui donnerait trop d'importance.
Silence. Charles Massery hésite. Il reprend, plus bas, il s'arrête souvent, comme gêné :
— Et puis, tu le sais bien comme moi, y a pas plus feignant que Domet… Je ne sais pas s'il y tient tant que ça, à “ faire aller ” les terres du beau-père. C'est “ yée ” un paysan… Toujours à chercher de l'ouvrage… en priant “ l'bon yeu ” de n'pas en trouver… Depuis quelque temps, il a trouvé le moyen : il va “ faire du bois ”. J'voudrais bien savoir combien de cordes il empile dans sa journée… Il peut pas faire de bois, il est tout le temps chez lui… un jour il a mal aux reins, un autre jour, il fait grève… parce qu'ils ont un syndicat, les “ beuchtons ”, et ça fait grève… euh là, qu'c'en est honteux !
La voix du père Massery gronde. Manifestement, les syndicats, il n'est pas pour ; d'abord, ce n'est pas une “ affaire qui s'faisait de son temps ”. En quoi il se trompe, parce que les bûcherons de la Nièvre, et de tout le centre de la France ont été les premiers ouvriers à s'organiser en puissants syndicats, dès la fin du 19ème siècle. Mais Massery, lui, est un paysan. Pas un bûcheron. Pas un ouvrier. Il ignore tout des “ beuch'tons ” comme il dit avec mépris. Deux mondes qui cohabitent dans le même village, et s'ignorent. Il reprend, railleur :
— Il arrive le matin dans sa coupe ; il trouve deux brindilles entrecroisées sur sa “ chieuve ”, enfin, sa chèvre, son “ chigot ”, tu sais bien, pour poser le bois quand on le scie : les deux brindilles, ça veut dire que le chef (c'est le responsable du syndicat pour Massery) a décidé qu'aujourd'hui on ferait grève. Eh bien, mon Domet, il se le fait pas dire deux fois ! Il revient vite à la maison ! Feignant, que j'te dis !
Tout cela est très bien, mais nous avons un peu oublié Céline. J'insiste.
— La Céline ? Elle a débarqué un beau jour ici, à Briez. Je t'ai dit, t'étais pas encore “ au monde ”, ou en tout cas tout juste. Elle était comme à c’t'heure, ni plus vieille, ni moins. Y en a quelques-uns qui l'ont vue arriver (pas moi), déjà courbée, un grand sac de touille en toile où c'est qu'elle avait mis tout son “ bien ”. On s'demandait bien c'que c'était, et puis, où ça allait… Eh bien, c'est allé chez l'vieux Plautat. On a dit par la suite qu'il avait mis une annonce dans un journal, comme quoi il avait besoin d'une domestique… heu… heu… heu… il l'a eue, sa domestique, et puis tout le reste ! Cette fois, les rides du père Massery se plissent d'amusement, au coin des yeux. Je ne lui avais jamais vu cet air là. Au reste, je n'avais pas compris les derniers mots. Ce n'est que plus tard que je saurai ce qu'il voulait dire par “ et puis tout le reste ”.
Edouard fume la pipe au milieu de ses quatre femmes.
Novembre 1949
Je suis allé me chauffer vers Céline ! Dans notre patois nous ne disons pas “ près de ”, encore moins “ auprès de ”. Cela fait “ parisien ”. On dit “ vers ”, ou plus exactement : “ vée ”. “ Vins-don vée moué ! ” disait grand-mère, et non pas : “ Viens donc auprès de moi ”. Toujours cette réserve, cette pudeur.
L'automne est le temps, “ en fin de saison ”, après la moisson, où les gardiens de troupeaux laissent leurs bêtes paître en liberté, n'importe où, même chez le voisin, en vaine pâture. La propriété, à ce moment, est abolie, pour le pâturage. Je devrais parler au passé, dire “ était abolie ”, car toutes ces coutumes ont disparu aujourd'hui. C'était, je crois, une survivance d'anciennes pratiques d'exploitation communautaire du terroir. Il en restait une concertation, souvent tacite, pour la rotation des assolements, et cette vaine pâture.
En octobre et novembre, nous “ sortions ” les vaches vers dix heures du matin, après disparition de la gelée blanche, et nous les rentrions vers trois ou quatre heures de l'après-midi. C'est dire que nous, les gardiens, “ déjeunions ” aux champs.
Pénétrante tristesse des ciels gris et bas de cette saison. Solitude. Silence. Le temps s'étirait, lentement, interminablement. J'aimais cette atmosphère mélancolique, cette patiente attente de l'heure du retour.
Ce jour de novembre, je me souviens, il pleuvait ; un crachin fin, et froid. Je m'étais adossé, pour m'en protéger, au tronc d'un orme qui avait gardé son feuillage. C'était une protection parfaite, même contre une pluie durable et plus importante. Il eût fallu des heures d'averse violente pour que le plumage de mon orme commence à être “ enfondu ”, “ aigé ”, et que les premières gouttes ne commencent à m'atteindre. Je regardais tomber cette pluie fine, et je fixais une feuille particulière de l'orme : à mesure que le poids de l'eau augmentait, la feuille s'inclinait, s'inclinait. Puis une grosse goutte se formait à l'extrémité pointue. La goutte grossissait encore et, comme à regret, se détachait de la feuille. Celle-ci se relevait alors légèrement, soulagée, et un nouveau cycle recommençait. J'ai passé des heures de mon enfance à contempler des spectacles aussi simples que celui-ci, en rêvant.
J'étais là parfaitement au sec, mais le col de mon “ capuchon ” relevé ne suffisait pas à me protéger du froid. Je n'avais pas allumé de feu, je ne sais plus pourquoi. Ma chienne, Pastille, allongée de tout son long près de moi, le museau sur les pattes, grelottait elle aussi. Le troupeau, douze vaches, un taureau et une chèvre, évoluait au loin dans une éteule, nous disions un “ pailleri ” riche en herbes dont les bêtes étaient friandes, et que nous appelions “ herbes à cochons ”. Ma chienne semblait écœurée de ce désœuvrement, de n'avoir pas à intervenir.
J'ai aperçu le petit troupeau de Céline, à près d'un kilomètre de moi ; la gardienne était assise, abritée par une épaisse “ bouchue ”, et elle avait allumé un feu. D'où j'étais je distinguais une tache noire, vaguement ronde, la tête inclinée vers les genoux. Céline ravaudait sans doute quelque chose, à moins qu'elle ne sommeillât. Je me suis détaché d'un coup d'épaule du tronc ; ma chienne a compris, mais je lui dis tout de même : “ allons voir Céline ! ”
J'avais eu rarement l'occasion de lui parler jusqu'à ce jour, nous avions seulement échangé quelques mots lorsqu'il arrivait que nos troupeaux se croisent dans les chemins.
Je me suis approché d'elle, jusqu'à quelques mètres. Elle ne m'avait pas entendu venir, et gardait la tête baissée, comme enfouie dans son ouvrage, à se demander comment elle ne se piquait pas le nez avec ses aiguilles. C'est le bond de son chien, et son grognement qui lui ont fait enfin lever les yeux vers moi :
— Tiens, c'est Jean ! Tu es donc réveillé ?
Je m'attendais à cette question stupide. C'était sa façon à elle, Céline, de dire bonjour. Quelle que soit l'heure à laquelle nous nous rencontrions, elle me demandait si j'étais réveillé. Cela m'agaçait à chaque fois : cela se voyait, que j'étais réveillé, non ? En fait, Céline ne faisait qu'adopter une coutume de la campagne, et spécialement de Briez, selon laquelle, d'une part il faut absolument échanger quelques mots avec le voisin que l'on croise, et d'autre part, choisir les tournures le plus banales, les plus dénuées de sens possible. Pas question de dire simplement : “ Bonjour, comment vas-tu ? ” Non, c'est trop direct, trop personnel. Encore moins d'engager une conversation sérieuse, de laisser poindre sa pensée, une opinion. On s'emploie au contraire à les cacher à vivre comme dissimulé continuellement derrière le brouillard de phrases creuses, de formules toutes faites.
Je dus grogner quelque chose comme “ on le dirait ”, et je tendis mes mains vers le feu. Céline replongea le nez dans ses chaussettes. Son chien se recoucha, tranquillisé par l'attitude pacifique de Pastille, qui se tenait derrière moi, sur la réserve.
Céline empoigna le bâton qu'elle avait posé près d'elle et qui est le sceptre du vacher, et, de la pointe, remua quelque chose dans les braises.
— Vous faites de la cuisine, Céline ?
— Oh, j'ai trouvé quelques châtaignes, et deux pommes, que je fais cuire, pour les manger.
— Vous n'avez donc pas apporté à manger ?
— Ma foi non ; ce n'est pas la peine, puisqu'on trouve de quoi se nourrir dans les champs.
Elle tournait vers moi sa petite face de guenon, ronde, terreuse, ravagée de rides. Elle clignait des paupières, comme si la lumière l'incommodait. Elle ressemblait à ces têtes que font réduire les Indiens d'Amazonie. J'étais bien incapable de dater cette tête momifiée, figée dans le temps. On pouvait dire 60, comme 70 ou 80. En fait, Céline devait approcher les soixante-dix ans. Elle me fixait de ses tout petits yeux noirs, qui n'exprimaient rien. Rien, sinon une sorte de ruse et de crainte animales.
— Tout de même, Céline, ce n'est pas un goûter, cela !
— Oh, vu qu'on soit calé, c'est le principal !
Moi aussi j'aimais faire cuire des pommes ou des châtaignes dans la braise, à l'automne. D'abord, je m'amusais à faire comme les trappeurs, dont je vivais les aventures dans les livres de Curwood. Je m'imaginais perdu dans le Grand-Nord, tout seul. J'oubliais que derrière moi, pas bien loin, fumaient les cheminées du village. Je m'inventais des histoires, j'étais parti en expédition pour de longs mois, je ne vivais que de cueillette… Il y avait aussi le plaisir de manger ces pommes ; leur peau était carbonisée, mais la chair, par-dessous, délicieuse, ramollie, un peu acidulée… Et quand je pouvais trouver un escargot (de Bourgogne, naturellement) qui ne s'était pas encore enterré pour hiverner, je l'ajoutais au menu, et l'envoyais tenir compagnie aux pommes et aux châtaignes, tel quel, avec sa plus noble fin coquille et sans autre préparation. L'escargot de Bourgogne mérite mieux, j'en conviens, et ceux que préparait grand-père, au printemps, c'était autre chose. Mais justement, mes escargots frits dans la braise me procuraient d'autres plaisirs : leur chair grillée avec les entrailles développait sa [saveur] indicible un peu aigre de la façon la plus naturelle qui soit : c'était l'escargot dans sa plus simple, dans sa plus grande expression. Aucun autre parfum ne venait l'altérer.
Céline avait repris son raccommodage.
— Toujours au travail, Céline.
— Eh oui, que veux-tu, il faut bien s'occuper ! On s'ennuierai sans cela ! Tu vois, ce sont des chaussettes à Lui, que je raccommode, pour qu'il ait chaud cet hiver. Il est si frileux…
Elle disait toujours “ Lui ” pour désigner son patron, Plautat. Elle avait, pour prononcer ce petit mot, des intonations pleines de respect quasi religieux. Une personne non avertie aurait pu croire qu'elle ravaudait les chaussettes de Dieu le père.
“ Lui ”, pourtant, ne me semblait pas justifier pareille dévotion. On l'apercevait, parfois, lorsque, fait rarissime, il sortait de chez lui. J'avais entrevu un vieillard de taille moyenne, ventripotent, une grosse touffe de cheveux blancs comme neige. C'était comme une apparition molle et falote. Un nuage sans consistance, sans contours définis. Son visage bouffi, aux traits incertains, m'avait frappé. Il avait tourné vers moi une face inexpressive au regard éteint. Et, sans doute sans m'avoir vu, il avait franchi le seuil de sa maison ; l'apparition s'était évanouie, comme une écharpe de brouillard qui s'effiloche et se dissout dans l'air.
Céline avait apporté un grand sac de toile grise, rempli de vieux vêtements qu'elle entendait repriser. Les chaussettes terminées, elle plongea dans le sac, fouilla dans les hardes, écarta un ou deux caleçons, quelques chemises, et, l'air rassuré, sortit une veste bleu marine qu'elle étendit sur ses genoux. Elle resta quelques instants silencieuse, contemplant la veste.
— Eh oui, elle est vieille ! Elle a peut-être quarante ans, peut-être plus. C'est une veste que nos patrons de Paris avaient donnée à défunt mon mari qu'est mort, pour qu'il la porte…
— C'était gentil de la part de vos patrons, Céline.
— Oh ça ! je peux dire que j'ai toujours eu de bons patrons. Mais mon mari n'a pas eu le temps de la porter bien longtemps, le pauvre… Regarde, elle est comme neuve. Aussi, c'est Lui qui va la mettre cet hiver.
Céline prend sa boîte à ouvrage, une boîte en fer blanc qui, à l'origine, avait contenu des biscuits. On distingue encore sur le couvercle une scène où l'on voit un petit apprenti pâtissier, courant dans la rue pour livrer ses friandises, poursuivi par un gros chien qui lui saute aux basques et cherche à s'emparer de la boîte. Sur le couvercle, on peut encore lire, à moitié effacée, l'inscription : “ Aux friandises parisiennes ”.
Céline ouvre la boîte, cherche les aiguilles et le fil dont elle a besoin ; mais c'est une petite montre qu'elle en sort ; elle secoue la tête, et me la fait admirer. :
— C'est la montre que défunt mon mari qu'est mort m'avait offerte, deux ans après notre mariage… Tu sais, Jean, elle est presque en or ! Et l'année d'après, il m'avait acheté cette broche.
Elle me montre la broche, comme on brandit une pièce à conviction. Elle aspire une grande bouffée d'air, soulève ses épaules, et soupire, comme oppressée par ses souvenirs :
— Oui, c'est bien loin tout cela !
Décidément, elle peut me produire toutes ces preuves d'une existence passée différente, d'une époque où elle était jeune, je ne parviens pas à l'imaginer autrement que maintenant, petit être gris, courbé et ridé. Je hoche tout de même poliment la tête.
Céline s'attaque au coude de la veste qu'elle destine à “ Lui ”.
Je suis allé me chauffer vers Céline ! Dans notre patois nous ne disons pas “ près de ”, encore moins “ auprès de ”. Cela fait “ parisien ”. On dit “ vers ”, ou plus exactement : “ vée ”. “ Vins-don vée moué ! ” disait grand-mère, et non pas : “ Viens donc auprès de moi ”. Toujours cette réserve, cette pudeur.
L'automne est le temps, “ en fin de saison ”, après la moisson, où les gardiens de troupeaux laissent leurs bêtes paître en liberté, n'importe où, même chez le voisin, en vaine pâture. La propriété, à ce moment, est abolie, pour le pâturage. Je devrais parler au passé, dire “ était abolie ”, car toutes ces coutumes ont disparu aujourd'hui. C'était, je crois, une survivance d'anciennes pratiques d'exploitation communautaire du terroir. Il en restait une concertation, souvent tacite, pour la rotation des assolements, et cette vaine pâture.
En octobre et novembre, nous “ sortions ” les vaches vers dix heures du matin, après disparition de la gelée blanche, et nous les rentrions vers trois ou quatre heures de l'après-midi. C'est dire que nous, les gardiens, “ déjeunions ” aux champs.
Pénétrante tristesse des ciels gris et bas de cette saison. Solitude. Silence. Le temps s'étirait, lentement, interminablement. J'aimais cette atmosphère mélancolique, cette patiente attente de l'heure du retour.
Ce jour de novembre, je me souviens, il pleuvait ; un crachin fin, et froid. Je m'étais adossé, pour m'en protéger, au tronc d'un orme qui avait gardé son feuillage. C'était une protection parfaite, même contre une pluie durable et plus importante. Il eût fallu des heures d'averse violente pour que le plumage de mon orme commence à être “ enfondu ”, “ aigé ”, et que les premières gouttes ne commencent à m'atteindre. Je regardais tomber cette pluie fine, et je fixais une feuille particulière de l'orme : à mesure que le poids de l'eau augmentait, la feuille s'inclinait, s'inclinait. Puis une grosse goutte se formait à l'extrémité pointue. La goutte grossissait encore et, comme à regret, se détachait de la feuille. Celle-ci se relevait alors légèrement, soulagée, et un nouveau cycle recommençait. J'ai passé des heures de mon enfance à contempler des spectacles aussi simples que celui-ci, en rêvant.
J'étais là parfaitement au sec, mais le col de mon “ capuchon ” relevé ne suffisait pas à me protéger du froid. Je n'avais pas allumé de feu, je ne sais plus pourquoi. Ma chienne, Pastille, allongée de tout son long près de moi, le museau sur les pattes, grelottait elle aussi. Le troupeau, douze vaches, un taureau et une chèvre, évoluait au loin dans une éteule, nous disions un “ pailleri ” riche en herbes dont les bêtes étaient friandes, et que nous appelions “ herbes à cochons ”. Ma chienne semblait écœurée de ce désœuvrement, de n'avoir pas à intervenir.
J'ai aperçu le petit troupeau de Céline, à près d'un kilomètre de moi ; la gardienne était assise, abritée par une épaisse “ bouchue ”, et elle avait allumé un feu. D'où j'étais je distinguais une tache noire, vaguement ronde, la tête inclinée vers les genoux. Céline ravaudait sans doute quelque chose, à moins qu'elle ne sommeillât. Je me suis détaché d'un coup d'épaule du tronc ; ma chienne a compris, mais je lui dis tout de même : “ allons voir Céline ! ”
J'avais eu rarement l'occasion de lui parler jusqu'à ce jour, nous avions seulement échangé quelques mots lorsqu'il arrivait que nos troupeaux se croisent dans les chemins.
Je me suis approché d'elle, jusqu'à quelques mètres. Elle ne m'avait pas entendu venir, et gardait la tête baissée, comme enfouie dans son ouvrage, à se demander comment elle ne se piquait pas le nez avec ses aiguilles. C'est le bond de son chien, et son grognement qui lui ont fait enfin lever les yeux vers moi :
— Tiens, c'est Jean ! Tu es donc réveillé ?
Je m'attendais à cette question stupide. C'était sa façon à elle, Céline, de dire bonjour. Quelle que soit l'heure à laquelle nous nous rencontrions, elle me demandait si j'étais réveillé. Cela m'agaçait à chaque fois : cela se voyait, que j'étais réveillé, non ? En fait, Céline ne faisait qu'adopter une coutume de la campagne, et spécialement de Briez, selon laquelle, d'une part il faut absolument échanger quelques mots avec le voisin que l'on croise, et d'autre part, choisir les tournures le plus banales, les plus dénuées de sens possible. Pas question de dire simplement : “ Bonjour, comment vas-tu ? ” Non, c'est trop direct, trop personnel. Encore moins d'engager une conversation sérieuse, de laisser poindre sa pensée, une opinion. On s'emploie au contraire à les cacher à vivre comme dissimulé continuellement derrière le brouillard de phrases creuses, de formules toutes faites.
Je dus grogner quelque chose comme “ on le dirait ”, et je tendis mes mains vers le feu. Céline replongea le nez dans ses chaussettes. Son chien se recoucha, tranquillisé par l'attitude pacifique de Pastille, qui se tenait derrière moi, sur la réserve.
Céline empoigna le bâton qu'elle avait posé près d'elle et qui est le sceptre du vacher, et, de la pointe, remua quelque chose dans les braises.
— Vous faites de la cuisine, Céline ?
— Oh, j'ai trouvé quelques châtaignes, et deux pommes, que je fais cuire, pour les manger.
— Vous n'avez donc pas apporté à manger ?
— Ma foi non ; ce n'est pas la peine, puisqu'on trouve de quoi se nourrir dans les champs.
Elle tournait vers moi sa petite face de guenon, ronde, terreuse, ravagée de rides. Elle clignait des paupières, comme si la lumière l'incommodait. Elle ressemblait à ces têtes que font réduire les Indiens d'Amazonie. J'étais bien incapable de dater cette tête momifiée, figée dans le temps. On pouvait dire 60, comme 70 ou 80. En fait, Céline devait approcher les soixante-dix ans. Elle me fixait de ses tout petits yeux noirs, qui n'exprimaient rien. Rien, sinon une sorte de ruse et de crainte animales.
— Tout de même, Céline, ce n'est pas un goûter, cela !
— Oh, vu qu'on soit calé, c'est le principal !
Moi aussi j'aimais faire cuire des pommes ou des châtaignes dans la braise, à l'automne. D'abord, je m'amusais à faire comme les trappeurs, dont je vivais les aventures dans les livres de Curwood. Je m'imaginais perdu dans le Grand-Nord, tout seul. J'oubliais que derrière moi, pas bien loin, fumaient les cheminées du village. Je m'inventais des histoires, j'étais parti en expédition pour de longs mois, je ne vivais que de cueillette… Il y avait aussi le plaisir de manger ces pommes ; leur peau était carbonisée, mais la chair, par-dessous, délicieuse, ramollie, un peu acidulée… Et quand je pouvais trouver un escargot (de Bourgogne, naturellement) qui ne s'était pas encore enterré pour hiverner, je l'ajoutais au menu, et l'envoyais tenir compagnie aux pommes et aux châtaignes, tel quel, avec sa plus noble fin coquille et sans autre préparation. L'escargot de Bourgogne mérite mieux, j'en conviens, et ceux que préparait grand-père, au printemps, c'était autre chose. Mais justement, mes escargots frits dans la braise me procuraient d'autres plaisirs : leur chair grillée avec les entrailles développait sa [saveur] indicible un peu aigre de la façon la plus naturelle qui soit : c'était l'escargot dans sa plus simple, dans sa plus grande expression. Aucun autre parfum ne venait l'altérer.
Céline avait repris son raccommodage.
— Toujours au travail, Céline.
— Eh oui, que veux-tu, il faut bien s'occuper ! On s'ennuierai sans cela ! Tu vois, ce sont des chaussettes à Lui, que je raccommode, pour qu'il ait chaud cet hiver. Il est si frileux…
Elle disait toujours “ Lui ” pour désigner son patron, Plautat. Elle avait, pour prononcer ce petit mot, des intonations pleines de respect quasi religieux. Une personne non avertie aurait pu croire qu'elle ravaudait les chaussettes de Dieu le père.
“ Lui ”, pourtant, ne me semblait pas justifier pareille dévotion. On l'apercevait, parfois, lorsque, fait rarissime, il sortait de chez lui. J'avais entrevu un vieillard de taille moyenne, ventripotent, une grosse touffe de cheveux blancs comme neige. C'était comme une apparition molle et falote. Un nuage sans consistance, sans contours définis. Son visage bouffi, aux traits incertains, m'avait frappé. Il avait tourné vers moi une face inexpressive au regard éteint. Et, sans doute sans m'avoir vu, il avait franchi le seuil de sa maison ; l'apparition s'était évanouie, comme une écharpe de brouillard qui s'effiloche et se dissout dans l'air.
Céline avait apporté un grand sac de toile grise, rempli de vieux vêtements qu'elle entendait repriser. Les chaussettes terminées, elle plongea dans le sac, fouilla dans les hardes, écarta un ou deux caleçons, quelques chemises, et, l'air rassuré, sortit une veste bleu marine qu'elle étendit sur ses genoux. Elle resta quelques instants silencieuse, contemplant la veste.
— Eh oui, elle est vieille ! Elle a peut-être quarante ans, peut-être plus. C'est une veste que nos patrons de Paris avaient donnée à défunt mon mari qu'est mort, pour qu'il la porte…
— C'était gentil de la part de vos patrons, Céline.
— Oh ça ! je peux dire que j'ai toujours eu de bons patrons. Mais mon mari n'a pas eu le temps de la porter bien longtemps, le pauvre… Regarde, elle est comme neuve. Aussi, c'est Lui qui va la mettre cet hiver.
Céline prend sa boîte à ouvrage, une boîte en fer blanc qui, à l'origine, avait contenu des biscuits. On distingue encore sur le couvercle une scène où l'on voit un petit apprenti pâtissier, courant dans la rue pour livrer ses friandises, poursuivi par un gros chien qui lui saute aux basques et cherche à s'emparer de la boîte. Sur le couvercle, on peut encore lire, à moitié effacée, l'inscription : “ Aux friandises parisiennes ”.
Céline ouvre la boîte, cherche les aiguilles et le fil dont elle a besoin ; mais c'est une petite montre qu'elle en sort ; elle secoue la tête, et me la fait admirer. :
— C'est la montre que défunt mon mari qu'est mort m'avait offerte, deux ans après notre mariage… Tu sais, Jean, elle est presque en or ! Et l'année d'après, il m'avait acheté cette broche.
Elle me montre la broche, comme on brandit une pièce à conviction. Elle aspire une grande bouffée d'air, soulève ses épaules, et soupire, comme oppressée par ses souvenirs :
— Oui, c'est bien loin tout cela !
Décidément, elle peut me produire toutes ces preuves d'une existence passée différente, d'une époque où elle était jeune, je ne parviens pas à l'imaginer autrement que maintenant, petit être gris, courbé et ridé. Je hoche tout de même poliment la tête.
Céline s'attaque au coude de la veste qu'elle destine à “ Lui ”.
Grand-père, l'Douard
Il y avait en Grand-père beaucoup de Colas Breugnon ; il était le prototype du Bourguignon tel qu'on l'a stéréotypé en littérature, et tel qu'il n'existe peut-être pas vraiment. Au reste, le Nivernais (je veux dire la province) n'est nullement bourguignon. Il a beaucoup plus d'affinités avec le Berry. Quand au Nivernais, à l'homme, on le dit froid et fermé, et il donne en effet ces impressions. Il faut être Jules Renard pour faire parler Ragotte et Philippe, et encore n'en tire-t-il par ruse que quelques mots lâchés comme à regret. Je crois le Nivernais surtout pudique, “ honteux ” de dévoiler ses sentiments.
Mais Grand-père était le contraire de tout cela. Il disait tout à trac ce qu'il pensait, comme le bon pain blanc, le pain de ménage, exhale simplement son parfum. Il aimait rire et faire rire et pour cela adorait faire des farces. Non la farce grossière, genre fin de repas de noce, non. La farce qui oblige l'autre à exprimer sa réelle personnalité, à se démasquer, à montrer un petit morceau de ce qu'il est réellement.
Il y avait en Grand-père beaucoup de Colas Breugnon ; il était le prototype du Bourguignon tel qu'on l'a stéréotypé en littérature, et tel qu'il n'existe peut-être pas vraiment. Au reste, le Nivernais (je veux dire la province) n'est nullement bourguignon. Il a beaucoup plus d'affinités avec le Berry. Quand au Nivernais, à l'homme, on le dit froid et fermé, et il donne en effet ces impressions. Il faut être Jules Renard pour faire parler Ragotte et Philippe, et encore n'en tire-t-il par ruse que quelques mots lâchés comme à regret. Je crois le Nivernais surtout pudique, “ honteux ” de dévoiler ses sentiments.
Mais Grand-père était le contraire de tout cela. Il disait tout à trac ce qu'il pensait, comme le bon pain blanc, le pain de ménage, exhale simplement son parfum. Il aimait rire et faire rire et pour cela adorait faire des farces. Non la farce grossière, genre fin de repas de noce, non. La farce qui oblige l'autre à exprimer sa réelle personnalité, à se démasquer, à montrer un petit morceau de ce qu'il est réellement.
A gauche, Edouard.
Grand-mère était naturellement, à son corps défendant, le principal partenaire de Grand-père, qui blaguait à tout moment et à tout propos. Bien souvent, après le déjeuner, il “ abachvautait ” une chaise, c'est-à-dire qu'il l'enfourchait ; ventre contre le dossier, bras croisés au-dessus ; le menton appuyé sur les mains, les yeux mi-clos, sa vieille pipe noirâtre fumante, il faisait la sieste, ou “ r'cie ” comme on disait encore. Il ne dormait pas vraiment, mais somnolait à la manière des chats, et poursuivait une conversation intérieure, ralentie par la digestion. Un mot parfois émergeait, une bribe de phrase. Je pense qu'il avait contracté cette habitude de se reposer menton appuyé sur les mains croisées, debout ou assis peu importe, dans les tranchées de la Grande guerre.
Une de ses taquineries préférées était d'évoquer dans ses moments de somnolence digestive, son avenir après la mort de Grand-mère, devant elle naturellement. Il n'ouvrait pas les yeux, et faisait un peu comme s'il parlait en rêvant : “ oui ma vieille, quand tu s'ras morte, j'en choisirai une autre, bien plus jeune que toi ; elle m'engueulera jamais, celle-là… oui ma vieille, une plus jeune que toi… ”
Ça ne ratait jamais : Grand-mère haussait les épaules, prenait un air triste et malheureux : “ dire que ça a un pied dans la tombe, et que ça dit des choses pareilles ! Mon Yeu si c'est possible ! T'as pas honte de dire des choses comme ça ? C'est en enfer que t'iras, voilà où t'iras ! ”
En fait, ce qui rendait réellement Grand-mère malheureuse (à moins qu'elle ne fît semblant), ce n'était pas tellement la menace de se voir remplacée, c'est qu'elle croyait réellement qu'avec de tels propos, Grand-père était en train de se damner ; or elle s'était donnée comme mission de le sauver malgré lui. Non, ca se ratait jamais. Grand-père soulevait alors une paupière, me lançait une petite flamme amusée, un clin d'œil rigolard, l'air de dire : “ hein, t'as vu ? Ça marche ! ”. Alors il était heureux ; il épointait l'extrémité de ses moustaches, en les vrillant, l'une, puis l'autre, et il souriait et répétait sans se lasser : “ oui… ma vieille… ”. Grand-mère, vaincue, ne disait plus rien. Je pense qu'elle priait en silence pour que Dieu soit si possible, et momentanément, le temps que durait la déraison de Grand-père, atteint de surdité…
Je dois confesser aussi qu'il avait ramené des tranchées une autre mauvaise habitude ; celle de chiquer. En fait, quand il ne fumait pas la pipe ; il tirait sur d'informes cigarettes qu'il roulait lui-même dans du papier “ Le Zouave ”, et il mâchonnait autant qu'il fumait. Cela le faisait beaucoup saliver, et temps à autre il lui fallait bien expurger une partie du trop-plein en un long jet puissant qu'il faisait passer, je ne sais comment, entre ses dents, par une rapide poussée de la langue. Le liquide jaunâtre décrivait dans la cuisine une courbe tendue qui n'était pas sans rappeler celle du glorieux 75 qui nous donna la victoire, et allait exploser à quatre mètres du tireur, à l'endroit précis qu'il avait choisi. La cuisine se trouvait ainsi rapidement ponctué de points d'impact, taches pisseuses, âcres et nicotineuses. A chaque tir, Grand-mère criait : “ Vieux sale ! T'est pas dans une écurie ici ! Qui c'est qui va laver ça après ? Sûrement pas toi ”. Grand-père ne répondait jamais sur ce sujet. Il avait acquis une fois pour toutes en quatre ans de guerre l'habitude saine de ne pas sortir pour cracher, en raison des Germains d'en face qui n'attendait que cela, et, Germains ou pas, il n'allait pas changer d'habitude, quitter sa chaise, surtout pas après le repas ouvrir la porte …Non, tout cela était exclu, et si évident que Grand-père ne répondait pas. Il ne restait plus à Grand-mère, plusieurs fois par jour, qu'à s'armer du seau et de la serpillière et à nettoyer le champ de bataille de ses fientes jaunâtres.
C'était un ménage bruyant, du fait surtout de Grand-père, qui avait un caractère prompt, le rire et l'éclat de colère sans cesse à fleur de bouche. Le moindre contretemps, la plus petite déconvenue le plongeaient dans tous ses états. Que la moissonneuse-lieuse se mette à ne plus lier, le voilà tournant autour, jurant et sacrant, sans même chercher la cause de l'avarie. De toutes façons, il était imparfaitement impropre au bricolage, étranger à la mécanique, et sa colère l'incitait plutôt à rechercher des causes psychologiques que techniques : “ Sacré bon Yeu de nom de Dieu d'putain d'machine ! On n'a pas idée… ça coûte hors de prix et quand on en a besoin, ça “n'veut” pas marcher ! ”.
Grand-père jurait d'ailleurs pour un oui ou un non. Encore la Grande guerre je suppose. C'était un voisin sur qui il comptait, et qu'il n'avait pas trouvé ; il revenait à la maison tout rouge, furieux et ulcéré par ce manque de compréhension… C'était le chat qui devait sortir, et se refusait à prendre la porte ; Grand-père le pourchassait avec la queue du balai, la bête terrorisée se réfugiait dans des endroits impossibles, sous le poêle, puis derrières le bahut ; pratiquement hors du rayon d'action du manche à balai : “ Non de Dieu d'chat ! Dehors ! Dehors ! Chat ! Chat ! Bon Dieu d'chat ”. Et Grand-mère de gémir : “ Dire que c'est près de mourir, et qu'ça jure le Bon Yeu coumme un païen ”. Alors, pour que cessent les blasphèmes, elle s'y mettait aussi, et criait d'une voix aiguë : Chat ! Chat ! Combien de fois m'est-il arrivé, revenant de l'école, d'entendre ainsi mes bons vieux pousser leurs cris de guerre au félin si fort que la moitié du village pouvait suivre les phases de la chasse au chat.
Oui, c'était un ménage bruyant, et toute la rue en profitait. Il faut dire aussi que c'était un des rares couples, peut-être le seul du village, à vire transparent, à ne pas cacher, à ne pas se cacher. En été, la porte restait ouverte toute la journée, et chacun pouvait voir Grand-mère faire son ménage, préparer le repas, et Grand-père se “ débarbouiller ”, oh, le bout du nez, se raser, torse nu et bretelles pendantes, le visage tout mousseux, tout blanc comme une grosse barbe-à-papa, le rasoir-couteau préalablement affûté à un ceinturon, et brandi comme un sabre.
Le soir, tous les deux s'asseyaient sur le banc, devant la maison, sous la treille, et regardaient en silence tomber la nuit. Grand-père tirait sur sa pipe. Grand-mère tricotait, ou se tournait les pouces (au sens propre), songeuse. Il faisait frais agréables ; en juin, l'air du soir, nonchalant, promenait avec lui le parfum sucré des sureaux en fleur, puis du tilleul. Quelqu'un, revenant un peu tard des champs, passait parfois devant la maison. C'était alors le sempiternel : “ Vous êtes bien, là, mieux qu'à midi, hein ? C'est qu'à midi, il aurait pas fait bon rester là ! ”. Ou bien : “ Alors, c'est-y que vous prenez le frais, à c’t'heure ? ” Grand-père retirait la pipe de sa bouche, et lançait toujours une réponse goguenarde ; il se payait la tête de la plupart des gens qui passaient, déformait leur nom, appelait le père Turpin “ Pintur ”, ou le père Moreau “ Les Entrailles ”, parce que ce Moreau-là avait parlé un jour d'entrailles, ce qui avait paru à Grand-père du plus grand comique, quand il est si facile de dire tripes, comme tout le monde. Un autre Moreau avait été menuiser, ensuite parce qu'il importait de ne pas confondre les Moreau, vu qu'ils étaient trois familles à porter le même nom. La troisième famille Moreau était une “ Lumpen-tribu ” que Grand-père avait naturellement affectée de l'épithète “ la-Misère ”. Nous avions ainsi Moreau-les-Entrailles, Moreau-la-Varlope, et Moreau-la-Misère. Oui, Grand-père se payait la tête de tous les gens qui passaient, mais tout le monde en souriait, car s'était simple jeu, simple blague amicale, et cela se sentait très bien au ton qu'y mettait Grand-père.
Je suis sûr, quand je pense ainsi à mes deux vieux, que leur ménage était profondément uni malgré sa disparité. J'étais en tout cas en parfaite communion avec l'un comme l'autre, avec Edouard-le-Bruyant comme avec Suzanne-la-Silencieuse.
Une de ses taquineries préférées était d'évoquer dans ses moments de somnolence digestive, son avenir après la mort de Grand-mère, devant elle naturellement. Il n'ouvrait pas les yeux, et faisait un peu comme s'il parlait en rêvant : “ oui ma vieille, quand tu s'ras morte, j'en choisirai une autre, bien plus jeune que toi ; elle m'engueulera jamais, celle-là… oui ma vieille, une plus jeune que toi… ”
Ça ne ratait jamais : Grand-mère haussait les épaules, prenait un air triste et malheureux : “ dire que ça a un pied dans la tombe, et que ça dit des choses pareilles ! Mon Yeu si c'est possible ! T'as pas honte de dire des choses comme ça ? C'est en enfer que t'iras, voilà où t'iras ! ”
En fait, ce qui rendait réellement Grand-mère malheureuse (à moins qu'elle ne fît semblant), ce n'était pas tellement la menace de se voir remplacée, c'est qu'elle croyait réellement qu'avec de tels propos, Grand-père était en train de se damner ; or elle s'était donnée comme mission de le sauver malgré lui. Non, ca se ratait jamais. Grand-père soulevait alors une paupière, me lançait une petite flamme amusée, un clin d'œil rigolard, l'air de dire : “ hein, t'as vu ? Ça marche ! ”. Alors il était heureux ; il épointait l'extrémité de ses moustaches, en les vrillant, l'une, puis l'autre, et il souriait et répétait sans se lasser : “ oui… ma vieille… ”. Grand-mère, vaincue, ne disait plus rien. Je pense qu'elle priait en silence pour que Dieu soit si possible, et momentanément, le temps que durait la déraison de Grand-père, atteint de surdité…
Je dois confesser aussi qu'il avait ramené des tranchées une autre mauvaise habitude ; celle de chiquer. En fait, quand il ne fumait pas la pipe ; il tirait sur d'informes cigarettes qu'il roulait lui-même dans du papier “ Le Zouave ”, et il mâchonnait autant qu'il fumait. Cela le faisait beaucoup saliver, et temps à autre il lui fallait bien expurger une partie du trop-plein en un long jet puissant qu'il faisait passer, je ne sais comment, entre ses dents, par une rapide poussée de la langue. Le liquide jaunâtre décrivait dans la cuisine une courbe tendue qui n'était pas sans rappeler celle du glorieux 75 qui nous donna la victoire, et allait exploser à quatre mètres du tireur, à l'endroit précis qu'il avait choisi. La cuisine se trouvait ainsi rapidement ponctué de points d'impact, taches pisseuses, âcres et nicotineuses. A chaque tir, Grand-mère criait : “ Vieux sale ! T'est pas dans une écurie ici ! Qui c'est qui va laver ça après ? Sûrement pas toi ”. Grand-père ne répondait jamais sur ce sujet. Il avait acquis une fois pour toutes en quatre ans de guerre l'habitude saine de ne pas sortir pour cracher, en raison des Germains d'en face qui n'attendait que cela, et, Germains ou pas, il n'allait pas changer d'habitude, quitter sa chaise, surtout pas après le repas ouvrir la porte …Non, tout cela était exclu, et si évident que Grand-père ne répondait pas. Il ne restait plus à Grand-mère, plusieurs fois par jour, qu'à s'armer du seau et de la serpillière et à nettoyer le champ de bataille de ses fientes jaunâtres.
C'était un ménage bruyant, du fait surtout de Grand-père, qui avait un caractère prompt, le rire et l'éclat de colère sans cesse à fleur de bouche. Le moindre contretemps, la plus petite déconvenue le plongeaient dans tous ses états. Que la moissonneuse-lieuse se mette à ne plus lier, le voilà tournant autour, jurant et sacrant, sans même chercher la cause de l'avarie. De toutes façons, il était imparfaitement impropre au bricolage, étranger à la mécanique, et sa colère l'incitait plutôt à rechercher des causes psychologiques que techniques : “ Sacré bon Yeu de nom de Dieu d'putain d'machine ! On n'a pas idée… ça coûte hors de prix et quand on en a besoin, ça “n'veut” pas marcher ! ”.
Grand-père jurait d'ailleurs pour un oui ou un non. Encore la Grande guerre je suppose. C'était un voisin sur qui il comptait, et qu'il n'avait pas trouvé ; il revenait à la maison tout rouge, furieux et ulcéré par ce manque de compréhension… C'était le chat qui devait sortir, et se refusait à prendre la porte ; Grand-père le pourchassait avec la queue du balai, la bête terrorisée se réfugiait dans des endroits impossibles, sous le poêle, puis derrières le bahut ; pratiquement hors du rayon d'action du manche à balai : “ Non de Dieu d'chat ! Dehors ! Dehors ! Chat ! Chat ! Bon Dieu d'chat ”. Et Grand-mère de gémir : “ Dire que c'est près de mourir, et qu'ça jure le Bon Yeu coumme un païen ”. Alors, pour que cessent les blasphèmes, elle s'y mettait aussi, et criait d'une voix aiguë : Chat ! Chat ! Combien de fois m'est-il arrivé, revenant de l'école, d'entendre ainsi mes bons vieux pousser leurs cris de guerre au félin si fort que la moitié du village pouvait suivre les phases de la chasse au chat.
Oui, c'était un ménage bruyant, et toute la rue en profitait. Il faut dire aussi que c'était un des rares couples, peut-être le seul du village, à vire transparent, à ne pas cacher, à ne pas se cacher. En été, la porte restait ouverte toute la journée, et chacun pouvait voir Grand-mère faire son ménage, préparer le repas, et Grand-père se “ débarbouiller ”, oh, le bout du nez, se raser, torse nu et bretelles pendantes, le visage tout mousseux, tout blanc comme une grosse barbe-à-papa, le rasoir-couteau préalablement affûté à un ceinturon, et brandi comme un sabre.
Le soir, tous les deux s'asseyaient sur le banc, devant la maison, sous la treille, et regardaient en silence tomber la nuit. Grand-père tirait sur sa pipe. Grand-mère tricotait, ou se tournait les pouces (au sens propre), songeuse. Il faisait frais agréables ; en juin, l'air du soir, nonchalant, promenait avec lui le parfum sucré des sureaux en fleur, puis du tilleul. Quelqu'un, revenant un peu tard des champs, passait parfois devant la maison. C'était alors le sempiternel : “ Vous êtes bien, là, mieux qu'à midi, hein ? C'est qu'à midi, il aurait pas fait bon rester là ! ”. Ou bien : “ Alors, c'est-y que vous prenez le frais, à c’t'heure ? ” Grand-père retirait la pipe de sa bouche, et lançait toujours une réponse goguenarde ; il se payait la tête de la plupart des gens qui passaient, déformait leur nom, appelait le père Turpin “ Pintur ”, ou le père Moreau “ Les Entrailles ”, parce que ce Moreau-là avait parlé un jour d'entrailles, ce qui avait paru à Grand-père du plus grand comique, quand il est si facile de dire tripes, comme tout le monde. Un autre Moreau avait été menuiser, ensuite parce qu'il importait de ne pas confondre les Moreau, vu qu'ils étaient trois familles à porter le même nom. La troisième famille Moreau était une “ Lumpen-tribu ” que Grand-père avait naturellement affectée de l'épithète “ la-Misère ”. Nous avions ainsi Moreau-les-Entrailles, Moreau-la-Varlope, et Moreau-la-Misère. Oui, Grand-père se payait la tête de tous les gens qui passaient, mais tout le monde en souriait, car s'était simple jeu, simple blague amicale, et cela se sentait très bien au ton qu'y mettait Grand-père.
Je suis sûr, quand je pense ainsi à mes deux vieux, que leur ménage était profondément uni malgré sa disparité. J'étais en tout cas en parfaite communion avec l'un comme l'autre, avec Edouard-le-Bruyant comme avec Suzanne-la-Silencieuse.
Edouard, Suzanne et leurs deux filles, sans doute de retour de la guerre ?
Je n'ai pas connu mon grand-père paternel, mort assez jeune. C'était paraît-il un homme calme et doux. Mon grand-père maternel en était donc la contrepartie, non qu'il ne fût pas doux, il l'était à sa manière, mais il était surtout bruyant. C'est lui qui assurait le vacarme humain d'un village qui en son absence eût été d'une incroyable tristesse. Il “ animait ” en quelque sorte Briez, et détonait au milieu des autres villageois comme une grosse tache d'encre dans la page d'écriture d'un bon élève. Il était la bouffée d'air pur et gai dans l'atmosphère austère de Briez. Pourquoi Edouard Charrault était-il si différent. Est-ce parce que les Charrault n'étaient pas originaires du village ? Peut-être, mais ce n'est pas sûr : la souche était toute proche, mes ancêtres maternels au 18ème siècle étaient tuiliers à un vingtaine de kilomètres de Briez. Vers 1840, la famille Charrault ne devait pas être très riche, mais elle était prolifique : mon aïeul Louis n'avait pas moins de trois frères et de deux sœurs. Il avait appris le métier de sabotier. Il était hors de question que les six frères et sœurs continuent à vivre et travailler les quelques bosselées de terre qu'ils possédaient. Aussi mon trisaïeul Louis mit-il un beau matin dans un bissac, d'un côté ses outils de sabotier, ça n'allait pas loin, et dans l'autre poche un peu de pain ; et c'est avec ce seul bien qu'il arriva à Briez. Il trouva à louer, d'abord à crédit, une pièce minuscule dont il fit son atelier, puis il se maria. Je le suppose habile et travailleur, probablement très économe. Ce qui est certain, c'est qu'à sa mort il possédait quatre maisons, les unes achetées, les autres nouvellement construites, une trentaine d'arpents de terre, une belle petite propriété pour l'époque.
Son fils, Françis, mon arrière-grand-père donc, reprit l'affaire par la suite, non pas l'telier de sabotier d'où était sortie la petite fortune, mais les terres, et il ouvrit en plus un café.
Grand-père se souvenait très bien de l'ancêtre Louis, et il m'a raconté à son sujet plusieurs fois une anecdote qui me plaisait bien. Devenu veuf, Louis Charrault venait souvent rendre visite à sa belle-fille Adélaïde qui tenait le café pendant que son mari travaillait aux champs. Un jour, Louis entre au café, désert, sans apercevoir mon grand-père, un gamin de sept-huit ans à l'époque, caché dans un coin sombre de la salle. Le vieux se racle la gorge, pas trop fort. Rien ne bouge. Il tousse cette fois, très fort. Toujours rien. Troisième semonce :
— Y a personne, ici ?
Pas de réponse. Grand-père, accroupi dans son coin, ne bougeait “ ni pieds ni pattes ”. Alors le trisaïeul Louis, complètement assuré cette fois d'être seul, se dirige vers le placard aux alcools, se sert une grande rasade de marc, et, après un dernier coup d'œil circulaire, l'enfile d'un seul trait. Soixante ans plus tard, non grand-père racontait encore en riant comment il avait surpris le petit vice de son grand-père ; il trouvait qu'il lui avait fait une bonne farce.
A l'âge de quatorze ans, on plaça Grand-père en apprentissage à “ L'Ecu de France ”, un hôtel-restaurant de Pouilly-sur-Loire, pour en faire un cuisinier. A cette époque, les apprentis cuisiniers devaient fournir en arrivant tout un assortiment de linges divers, de serviettes qu'ils laissaient au patron à la fin de leur apprentissage. C'est un oncle, célibataire, qui avait acheté ce trousseau pour Grand-père.
Il revint au village trois ou quatre ans plus tard, puis partit au service militaire. A son retour il épousa Grand-mère Suzanne, et exerça deux métiers, celui d'agriculteur et celui de cuisinier.
Je ne sais pas s'il faut attacher beaucoup de crédit au récit que me fit Grand-mère de sa demande en mariage, mais comme Grand-mère n'a jamais menti une seule fois dans sa vie, je la crois.
La scène se situe en 1903 ; Grand-mère gardait la vache de ses grands-parents en “ Ferçiau ”, et celui qui allait être mon grand-père revenait du service militaire, à pied depuis Cosne-sur-Loire (seize kilomètres), et la première personne de son village qu'il vit fut précisément ma future grand-mère.
— Bonjour, Suzanne ! Eh bien, as-tu “ bon temps ” ?
C'est ainsi qu'on s'adressait, presque rituellement, aux gardiens de troupeaux. Cela voulait dire : tes bêtes sont-elles sages, ne t'ennuies-tu pas, etc. Et Grand-père d'enchaîner aussitôt :
— Tu vois, je reviens de mon service militaire. J'ai un bon métier, et je compte m'installer maintenant à mon compte. Veux-tu devenir ma femme ?
Grand-mère m'a toujours assuré qu'il avait été aussi expéditif, et, ma foi, qu'elle n'avait pas hésité une seconde à répondre, tout aussi simplement, oui.
Je voue à Grand-mère un sentiment qui confine à la vénération. Ce fut, dans mon enfance et mon adolescence, et jusqu'à sa mort, l'être avec lequel je m'accordais le mieux, sans avoir besoin de parler. Je ne me souviens pas avoir eu avec elle de conversations intimes, et j'ai très rarement abordé de grands sujets. Ce n'était pas nécessaire, et nous communiquions par nos êtres, nos deux personnalités jumelles. Un regard rapidement échangé, un soupir, un haussement d'épaules ont souvent suffi à nous dire que nous pensions et sentions la même chose.
Grand-mère était d'une nature douce, un peu triste. Elle était aussi d'une extraordinaire sensibilité et d'une grande intelligence. Sa mère, Sidonie, était morte en couches, en 1880 ; son père avait suivi sa femme deux ans plus tard. Ma grand-mère avait été élevée par ses grands-parents maternels, qu'elle voyait chaque jour pleurer la mort de leur fille. De là vint peut-être qu'elle traversa la vie avec le même visage un peu triste, même dans les bons moments. Je ne l'ai jamais vue rire aux éclats, mais parfois je l'ai surprise à se retenir : elle pouffait alors en baissant le regard, comme fautive. Elle était d'une intelligence distinguée ; je veux dire par là que cette paysanne accédait naturellement aux spéculations élevées, et qu'il lui suffisait souvent d'un mot pour exprimer l'état de ses réflexions. C'était le cas, par exemple, en matière de croyance. Grand-mère était très dévote, mais en rien bigote, et je sais, par trois ou quatre mots tout au plus, qu'elle avait fait le tour du problème de la foi, et qu'elle agissait par raison, non, comme beaucoup d'autres femmes du village, par tradition.
Elle aurait pu faire de “ brillantes ” études secondaires après son Certificat d'études, et ses maîtres sont bien des fois venus supplier ses grands-parents pour cela. Malheureusement, il n'en était pas question à cette époque (nous étions en 1892-93), car mes trisaïeux, sans être pauvres, vivaient dans un état de grande austérité. J'ai retrouvé le livre de comptes de l'aïeul charron, j'y ai relevé quelques factures. Il note par exemple en 1871 : “ une journée pour faire une brouette à Rolland : 1,50 F ”.
Son fils, Françis, mon arrière-grand-père donc, reprit l'affaire par la suite, non pas l'telier de sabotier d'où était sortie la petite fortune, mais les terres, et il ouvrit en plus un café.
Grand-père se souvenait très bien de l'ancêtre Louis, et il m'a raconté à son sujet plusieurs fois une anecdote qui me plaisait bien. Devenu veuf, Louis Charrault venait souvent rendre visite à sa belle-fille Adélaïde qui tenait le café pendant que son mari travaillait aux champs. Un jour, Louis entre au café, désert, sans apercevoir mon grand-père, un gamin de sept-huit ans à l'époque, caché dans un coin sombre de la salle. Le vieux se racle la gorge, pas trop fort. Rien ne bouge. Il tousse cette fois, très fort. Toujours rien. Troisième semonce :
— Y a personne, ici ?
Pas de réponse. Grand-père, accroupi dans son coin, ne bougeait “ ni pieds ni pattes ”. Alors le trisaïeul Louis, complètement assuré cette fois d'être seul, se dirige vers le placard aux alcools, se sert une grande rasade de marc, et, après un dernier coup d'œil circulaire, l'enfile d'un seul trait. Soixante ans plus tard, non grand-père racontait encore en riant comment il avait surpris le petit vice de son grand-père ; il trouvait qu'il lui avait fait une bonne farce.
A l'âge de quatorze ans, on plaça Grand-père en apprentissage à “ L'Ecu de France ”, un hôtel-restaurant de Pouilly-sur-Loire, pour en faire un cuisinier. A cette époque, les apprentis cuisiniers devaient fournir en arrivant tout un assortiment de linges divers, de serviettes qu'ils laissaient au patron à la fin de leur apprentissage. C'est un oncle, célibataire, qui avait acheté ce trousseau pour Grand-père.
Il revint au village trois ou quatre ans plus tard, puis partit au service militaire. A son retour il épousa Grand-mère Suzanne, et exerça deux métiers, celui d'agriculteur et celui de cuisinier.
Je ne sais pas s'il faut attacher beaucoup de crédit au récit que me fit Grand-mère de sa demande en mariage, mais comme Grand-mère n'a jamais menti une seule fois dans sa vie, je la crois.
La scène se situe en 1903 ; Grand-mère gardait la vache de ses grands-parents en “ Ferçiau ”, et celui qui allait être mon grand-père revenait du service militaire, à pied depuis Cosne-sur-Loire (seize kilomètres), et la première personne de son village qu'il vit fut précisément ma future grand-mère.
— Bonjour, Suzanne ! Eh bien, as-tu “ bon temps ” ?
C'est ainsi qu'on s'adressait, presque rituellement, aux gardiens de troupeaux. Cela voulait dire : tes bêtes sont-elles sages, ne t'ennuies-tu pas, etc. Et Grand-père d'enchaîner aussitôt :
— Tu vois, je reviens de mon service militaire. J'ai un bon métier, et je compte m'installer maintenant à mon compte. Veux-tu devenir ma femme ?
Grand-mère m'a toujours assuré qu'il avait été aussi expéditif, et, ma foi, qu'elle n'avait pas hésité une seconde à répondre, tout aussi simplement, oui.
Je voue à Grand-mère un sentiment qui confine à la vénération. Ce fut, dans mon enfance et mon adolescence, et jusqu'à sa mort, l'être avec lequel je m'accordais le mieux, sans avoir besoin de parler. Je ne me souviens pas avoir eu avec elle de conversations intimes, et j'ai très rarement abordé de grands sujets. Ce n'était pas nécessaire, et nous communiquions par nos êtres, nos deux personnalités jumelles. Un regard rapidement échangé, un soupir, un haussement d'épaules ont souvent suffi à nous dire que nous pensions et sentions la même chose.
Grand-mère était d'une nature douce, un peu triste. Elle était aussi d'une extraordinaire sensibilité et d'une grande intelligence. Sa mère, Sidonie, était morte en couches, en 1880 ; son père avait suivi sa femme deux ans plus tard. Ma grand-mère avait été élevée par ses grands-parents maternels, qu'elle voyait chaque jour pleurer la mort de leur fille. De là vint peut-être qu'elle traversa la vie avec le même visage un peu triste, même dans les bons moments. Je ne l'ai jamais vue rire aux éclats, mais parfois je l'ai surprise à se retenir : elle pouffait alors en baissant le regard, comme fautive. Elle était d'une intelligence distinguée ; je veux dire par là que cette paysanne accédait naturellement aux spéculations élevées, et qu'il lui suffisait souvent d'un mot pour exprimer l'état de ses réflexions. C'était le cas, par exemple, en matière de croyance. Grand-mère était très dévote, mais en rien bigote, et je sais, par trois ou quatre mots tout au plus, qu'elle avait fait le tour du problème de la foi, et qu'elle agissait par raison, non, comme beaucoup d'autres femmes du village, par tradition.
Elle aurait pu faire de “ brillantes ” études secondaires après son Certificat d'études, et ses maîtres sont bien des fois venus supplier ses grands-parents pour cela. Malheureusement, il n'en était pas question à cette époque (nous étions en 1892-93), car mes trisaïeux, sans être pauvres, vivaient dans un état de grande austérité. J'ai retrouvé le livre de comptes de l'aïeul charron, j'y ai relevé quelques factures. Il note par exemple en 1871 : “ une journée pour faire une brouette à Rolland : 1,50 F ”.
Mariage d'Edouard et Suzanne, ou financailles ? Mais pourquoi en noir ?
On ne pouvait guère imaginer caractères aussi différents que ceux des deux jeunes gens qui se sont mariés en 1904, et sont devenus mes grands-parents maternels. Mon grand-père avait suivi distraitement ses études primaires, excellant surtout dans la farce et le dessin. Aussi avouait-il sans gêne ne pas très bien comprendre la construction des phrases, et n'être jamais parvenu à maîtriser la ponctuation : “ Quand je trouve que j'en ai “mis” assez long, je te fous un point et quelques virgules là-dedans, et je continue ” disait-il parfois. Et cela le faisait beaucoup rire.
Aussitôt après le mariage, Grand-père a acheté une maison qui avait été construite en 1870 ; il l'avait choisie vaste (pour l'époque, et par comparaison avec les autres), avait fait aménager deux pièces au rez-de-chaussée, une vaste cuisine où l'on se tenait la plus grande partie de la journée, et, à côté, une autre salle, vaste aussi, qu'il avait voulue chaude et accueillante. Il y avait fait installer une cheminée de marbre, à la surprise réprobatrice des autres Briezois, et même de son père : comment peut-on gaspiller ainsi l'argent ?
Cette pièce était la chambre à coucher de mes grands-parents, mais aussi la salle à manger des grandes occasions, et, luxe inouï dans le village à cette époque, la pièce où Grand-père et Grand-mère veillaient en hiver. Le dîner du soir terminé, ils “ passaient à côté ”, expression et action totalement inconnues à Briez. Grand-mère avait allumé le feu, dans un délicieux petit poêle cylindrique peint en noir. On fermait la porte de la cuisine, on s'installait. Grand-père dans un fauteuil, avec son journal, “ L'Aurore ” auquel il ne s'abonnait que six mois de l'année, pendant la mauvaise saison, où les soirées sont longues et où il avait le temps de lire, Grand-mère sur une chaise, en général avec un tricot. Grand-père allumait sa pipe avec une braise prise au foyer du poêle, et nous passions deux heures délicieuses, silencieuses (je restais souvent une partie de l'hiver chez eux), deux heures occupées seulement à recharger le poêle, à tisonner les braises, deux heures pendant lesquelles le temps aurait paru aboli s'il n'avait continué à être rythmé par la comtoise qui occupait un angle de la pièce.
Grand-père aimait tout ce que la vie peut donner de bon aux hommes, et ce n'est pas pour faire comme les bourgeois qu'il avait voulu une cheminée de marbre, une salle agréable, deux chambres au premier étage. C'était sa sagesse à lui, ce goût de la vie qui l'accompagna jusqu'au bout.
Il était tellement différent des autres Briezois que ceux-ci, tout en le désignant familièrement par un diminutif, “ Douard ”, l'enviaient ; certains poussaient même une espèce de jalousie jusqu'à se moquer de ce qu'ils prenaient pour de la bonasserie. Mais sous son air rigolard, avec ses façons narquoises de prendre les choses de la vie, et aussi les gens, Grand-père cachait un grand cœur sérieux, et beaucoup de sagesse. Simplement, si chez Grand-mère, la sagesse se traduisait par un peu de tristesse, elle se manifestait chez Grand-père par un parti pris de bonne humeur. Il avait fait la Grande guerre (ma mère se souvient l'avoir vu pleurer en cachette à la déclaration de guerre), il avait été blessé deux fois, la seconde grièvement, le 3 novembre 1918. Un gros éclat d'obus au poumon. Il avait passé une nuit entière couché sur les dalles glaciales d'une église du Nord, à-demi conscient. La blessure avait déclenché une pleurésie purulente, et il était passé très près de la mort. Il lui avait fallu plusieurs années pour s'en remettre. Aussi Grand-père savait-il le prix de la vie ; c'est un peu pour cela, je pense, qu'il introduisait dans chaque minute de la sienne la petite parcelle de bonheur qu'il faut pour atteindre la suivante et en jouir. Les autre paysans, yeux rivés sur leur récolte et leur maigre argent, ne pouvaient pas comprendre cela, accéder à cette sagesse.
Aussitôt après le mariage, Grand-père a acheté une maison qui avait été construite en 1870 ; il l'avait choisie vaste (pour l'époque, et par comparaison avec les autres), avait fait aménager deux pièces au rez-de-chaussée, une vaste cuisine où l'on se tenait la plus grande partie de la journée, et, à côté, une autre salle, vaste aussi, qu'il avait voulue chaude et accueillante. Il y avait fait installer une cheminée de marbre, à la surprise réprobatrice des autres Briezois, et même de son père : comment peut-on gaspiller ainsi l'argent ?
Cette pièce était la chambre à coucher de mes grands-parents, mais aussi la salle à manger des grandes occasions, et, luxe inouï dans le village à cette époque, la pièce où Grand-père et Grand-mère veillaient en hiver. Le dîner du soir terminé, ils “ passaient à côté ”, expression et action totalement inconnues à Briez. Grand-mère avait allumé le feu, dans un délicieux petit poêle cylindrique peint en noir. On fermait la porte de la cuisine, on s'installait. Grand-père dans un fauteuil, avec son journal, “ L'Aurore ” auquel il ne s'abonnait que six mois de l'année, pendant la mauvaise saison, où les soirées sont longues et où il avait le temps de lire, Grand-mère sur une chaise, en général avec un tricot. Grand-père allumait sa pipe avec une braise prise au foyer du poêle, et nous passions deux heures délicieuses, silencieuses (je restais souvent une partie de l'hiver chez eux), deux heures occupées seulement à recharger le poêle, à tisonner les braises, deux heures pendant lesquelles le temps aurait paru aboli s'il n'avait continué à être rythmé par la comtoise qui occupait un angle de la pièce.
Grand-père aimait tout ce que la vie peut donner de bon aux hommes, et ce n'est pas pour faire comme les bourgeois qu'il avait voulu une cheminée de marbre, une salle agréable, deux chambres au premier étage. C'était sa sagesse à lui, ce goût de la vie qui l'accompagna jusqu'au bout.
Il était tellement différent des autres Briezois que ceux-ci, tout en le désignant familièrement par un diminutif, “ Douard ”, l'enviaient ; certains poussaient même une espèce de jalousie jusqu'à se moquer de ce qu'ils prenaient pour de la bonasserie. Mais sous son air rigolard, avec ses façons narquoises de prendre les choses de la vie, et aussi les gens, Grand-père cachait un grand cœur sérieux, et beaucoup de sagesse. Simplement, si chez Grand-mère, la sagesse se traduisait par un peu de tristesse, elle se manifestait chez Grand-père par un parti pris de bonne humeur. Il avait fait la Grande guerre (ma mère se souvient l'avoir vu pleurer en cachette à la déclaration de guerre), il avait été blessé deux fois, la seconde grièvement, le 3 novembre 1918. Un gros éclat d'obus au poumon. Il avait passé une nuit entière couché sur les dalles glaciales d'une église du Nord, à-demi conscient. La blessure avait déclenché une pleurésie purulente, et il était passé très près de la mort. Il lui avait fallu plusieurs années pour s'en remettre. Aussi Grand-père savait-il le prix de la vie ; c'est un peu pour cela, je pense, qu'il introduisait dans chaque minute de la sienne la petite parcelle de bonheur qu'il faut pour atteindre la suivante et en jouir. Les autre paysans, yeux rivés sur leur récolte et leur maigre argent, ne pouvaient pas comprendre cela, accéder à cette sagesse.
Edouard jeune conscrit.
Mais il était aussi cuisinier. Il était surtout, seulement cuisinier. Et cela, du vendredi au lundi. Il ne vivait réellement d'ailleurs que quatre jours de la semaine. Après son mariage, il aurait aimé prendre à son compte un restaurant, quelque part au long de la Nationale 7, à Cosne ou à Pouilly. Mais il n'avait rien eu à faire pour convaincre Grand-mère, qu'il n'avait en effet rien d'une commerçante accueillant les clients, faisant la conversation et minaudant. Grand-père avait donc été contraint de tracer un trait sur sa vocation, mais, têtu, il l'avait fait en pointillé, et avait commencé à préparer repas de noces et banquet d'abord aux environs immédiats du village, puis, sa renommée s'étant très vite et très loin répandue, il avait fini par monopoliser cette activité dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Il avait acheté tout le matériel nécessaire, fourneaux à charbon de bois, marmites immenses, soupières, assiettes, couvert, de sorte que les clients n'avaient rien à fournir, si ce n'est la matière première : viande, légumes, beurre, etc… Mon grand-père menait double vie. Attention, comprenez-moi bien. Je veux dire qu'il exerçait deux métiers. Du mardi au jeudi, il était paysan. Il possédait une belle petite propriété pour l'époque (une quinzaine d'hectares) que son grand-père le sabotier avait patiemment rassemblés, bosselée après bosselée, sabot après sabot. Mais mon grand-père était un paysan raté. Il haïssait la terre, ou plus exactement, le travail de la terre. Aussi maugréât il en permanence, du mardi au jeudi, derrière la charrue ou la herse, sur la moissonneuse-lieuse-farçeuse comme à l'arrachage des betteraves. Aucun des travaux des champs ne lui plaisait, et il faisait tout sans entrain, excepté peut-être l'entretien de sa vigne. Mais il le faisait convenablement. Son grand espoir était que ses deux petits-enfants, (ma cousine et moi) échappent à ce qu'il considérait comme un esclavage, et il répétait souvent : “ Va, si vous pouviez faire des études, être autre chose que paysan, je n'sais pas, moi, maître d'école par exemple, je montrais tout ça (et il désignait son matériel agricole) aux Ch'tis Bouchis (une petite hauteur où il avait planté sa vigne), je f'rais un grand bûcher de sarments, je foutrais tout ça par-dessus, et je f'rais brûler ces outils de souffrance ! Oh que je s'rais content de voir brûler tout ça ! ”. Hélas, Grand-père est parti avant de pouvoir allumer son feu de joie.
Edouard Chef de cuisine.
Les clients, c'est-à-dire les parents du jeune marié ou de la jeune mariée, c'était selon, venaient voir mon grand-père chez lui, bien longtemps avant la noce. Je revois encore ces couples, presque tous semblables. Lui, en général maigre, roule sa casquette dans ses mains rouges, aux doigts “ gourds ”, ankylosés par les travaux des champs. Visage osseux, tanné par le vent et le soleil. Il s'est “ rapropi ” pour la circonstance, il a enfilé son pantalon du dimanche, à rayures, et sa chemise à carreaux. Il est intimidé. Entré derrière elle, il la suit. Elle, ce n'est pas ce qu'elle soit plus rassurée. Elle est aussi maladroite, et d'ordinaire aussi timide. Mais dans les grandes circonstances comme celle-ci, elle s'avance, le sac à main au bras, et pour une fois (à moins que ce soit la règle du ménage), elle prend les choses en main. Elle est souvent opulente, elle étouffe dans sa gaine et robe trop étroite la rend mal à l'aise. C'est que, vers la cinquantaine, voyez-vous, on prend du poids. Elle transpire, suffoquée par une bouffée de chaleur, et parce qu'elle sait que l'épreuve sera dure. C'est tout de même elle qui commence :
— Vous savez sûrement, Douard (ou Monsieur Charrault, selon qu'il s'agisse de personnes bien connues de Grand-père, ou totalement étrangères), vous avez sûrement appris qu'on marie nout'fille…
Regard au mari. La casquette tourne plus vite dans les mains. Il ne s'attendait pas à être ainsi pris à témoin. Il sourit gauchement, l'air de s'excuser. Grand-père hoche la tête, et son sourire acquiesce :
— C'est-y avec un gars d'la région, qu'vous la mariez, vout'fumelle ?
— Oh oui ! Vous connaissez p’t'être… c'est l'gars au Barriau d'la Grande Brosse… Vous savez, vous avez déjà marié la fille, ça fait trois ans à c’t'heure.
Car Grand-père “ mariait ” littéralement les jeunes gens, au moins au même titre que le maire et le curé. Plus, même, un curé ou un maire, c'est interchangeable. Mais le Douard, lui, était irremplaçable.
— Alors, on a dit comme ça, avec les Barriau, faut aller voir l'Douard…
Ça y est. Les pourparlers sont engagés. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses.
— Ça fera un grosse noce, demande Grand-père ? La femme hésite. Regard au mari : ce n'est pas le moment de faire une fausse manœuvre. Il ne faudrait pas que le Douard aie l'impression qu'on est riches, qu'on a “ des moyens ”. Déjà qu'il ne passe pas pour “ les attacher avec de saucisses ”… C'est qu'il a la réputation d'être exigeant, de “ prendre ” plus cher que les autre, d'être un invraisemblable consommateur de beurre et de crème… Il se dit même qu'il en rapporte chez lui, en cachette, pour donner à sa fille, qui est à Paris…
— Oh, vous voyez ben … Avec toute la famille qu'on est… Et puis les Barriau, autant de leur côté. Ça a vite fait de monter. On s'ra dans les cent-vingt, quoi…
C'était une moyenne à la campagne ; une noce réunissait rarement moins de quatre-vingts invités. Au-dessous, vous étiez pratiquement classé dans les pauvres.
— Vous savez sûrement, Douard (ou Monsieur Charrault, selon qu'il s'agisse de personnes bien connues de Grand-père, ou totalement étrangères), vous avez sûrement appris qu'on marie nout'fille…
Regard au mari. La casquette tourne plus vite dans les mains. Il ne s'attendait pas à être ainsi pris à témoin. Il sourit gauchement, l'air de s'excuser. Grand-père hoche la tête, et son sourire acquiesce :
— C'est-y avec un gars d'la région, qu'vous la mariez, vout'fumelle ?
— Oh oui ! Vous connaissez p’t'être… c'est l'gars au Barriau d'la Grande Brosse… Vous savez, vous avez déjà marié la fille, ça fait trois ans à c’t'heure.
Car Grand-père “ mariait ” littéralement les jeunes gens, au moins au même titre que le maire et le curé. Plus, même, un curé ou un maire, c'est interchangeable. Mais le Douard, lui, était irremplaçable.
— Alors, on a dit comme ça, avec les Barriau, faut aller voir l'Douard…
Ça y est. Les pourparlers sont engagés. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses.
— Ça fera un grosse noce, demande Grand-père ? La femme hésite. Regard au mari : ce n'est pas le moment de faire une fausse manœuvre. Il ne faudrait pas que le Douard aie l'impression qu'on est riches, qu'on a “ des moyens ”. Déjà qu'il ne passe pas pour “ les attacher avec de saucisses ”… C'est qu'il a la réputation d'être exigeant, de “ prendre ” plus cher que les autre, d'être un invraisemblable consommateur de beurre et de crème… Il se dit même qu'il en rapporte chez lui, en cachette, pour donner à sa fille, qui est à Paris…
— Oh, vous voyez ben … Avec toute la famille qu'on est… Et puis les Barriau, autant de leur côté. Ça a vite fait de monter. On s'ra dans les cent-vingt, quoi…
C'était une moyenne à la campagne ; une noce réunissait rarement moins de quatre-vingts invités. Au-dessous, vous étiez pratiquement classé dans les pauvres.
Recto Verso du menu du 5 juin 1949
— Vous pensez-t-y pouvoir nous faire ça ? Ce s'rait pour le mois de septembre, après les moissons…
Regard à l'homme. Il écarte les mains, air de dire : bien oui, c'est comme ça, il faut bien avoir fini les moissons…
Grand-père se dirige alors vers le bahut, prend un grand registre, sa plume, son encrier, chausse ses lunettes, fait asseoir son monde autour de la table de la cuisine, s'installe lui-même et ouvre le registre.
— Et qu'est-ce que vous voudriez que j'vous fasse ? Son regard scrute la femme, par dessus les lunettes. Grand-père m'impressionnait toujours, quand il mettait ses lunettes, cela lui arrivait si rarement, seulement quand il prenait les commandes, et en hiver, le soir, pour lire “ L'Aurore ”.
Il fallait en général mettre au point le déjeuner du samedi midi, le dîner, et le déjeuner du lendemain. Cela représentait des quantités fantastiques de victuailles à rassembler. Nouveau regard de la femme au mari : “ On a pensé, comme cela, pour l'entrée, à la tête de veau en vinaigrette ”. Ou alors, ce pouvaient être les vol-au-vent sauce financière, ou la galantine. Puis venait le premier plat de viande, obligatoirement en sauce, puis le second plat de viande, rôtie cette fois. Les deux plats de viande étaient indispensables pour une famille qui se respecte.
— Et puis, pour le soir, si vous pouviez nous faire votre colin… Si c'était pas trop cher, bien entendu… Vous savez, les Barriau sont pas près d'oublier celui qu'vous avez fait pour la noce à leur fille.
Et c'est vrai que le chef-d'œuvre de Grand-père, son morceau de bravoure, c'était le colin accommode d'une sauce que lui seul connaissait, et qu'on avait baptisée dans la région “ sauce Charrault ”. Il l'a toujours tenue jalousement secrète, jusqu'à la fin de ses jours où il me l'a transmise. J'en suis aujourd'hui le seul et pieux dépositaire, et qu'on ne compte pas sur moi pour la dévoiler. Que l'on sache seulement qu'elle demande pour sa préparation de l'échalote grise, du vinaigre, du sel, du beurre et de la crème, et surtout, le tour de main, au bon moment, faute de quoi elle ressemble à tout, sauf à la sauce Charrault, dont seule la chair délicate du colin était et reste digne.
Venait le moment du verdict. L'heure de vérité. Grand-père, un coude sur le genou, regardant toujours les époux par-dessus les lunettes, commençait à énumérer les dizaines de poulets, les quinzaines de lapins, les kilos de beurre, les litres de crèmes qu'il fallait réunir. Je lisais alors sur les visages ravagés des malheureux les progrès de la panique. La face des femmes en particulier se décomposait un peu plus à mesure que Grand-père parlait. L'homme restait d'apparence plus insensible, se contentant de consulter sa femme du regard. Elle finissait invariablement par geindre. Parfois, les visages se butaient. On était au bord de la rupture.
— Evidemment, on peut faire à moins, si c'est le prix qui vous fait peur, concédait Grand-père. Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous offrir le colin, on peut le supprimer, ou le remplacer par autre chose… C'est à vous de voir. Tout dépend de ce qu'on veut… Vous pouvez même demander à quelqu'un d'autre… Vous trouverez toujours bien un tambouilleur pour “ faire manger ” vos invités…
Grand-père disait cela sur un ton égal, sans se départir de sa bonne humeur, sûr de son effet. Soupir de la femme. Regard résigné au mari : il faut y passer, quoi. Et que penseraient les voisins ? Une noce sans Charrault ? Mais ce n'est pas une noce, et les mariés ne seraient pas vraiment mariés. On dirait de nous que nous sommes “ regardants ”, ou, pire, que nous n'avons pas les moyens de marier dignement nos enfants. Non, décidément, il faut passer par les volontés du père Charrault. Le mari écarte encore une fois les mains. Il ne prononce pas un mot. Cela veut dire : comment faire autrement ? On ne peut plus reculer…
Grand-père, qui régnait ainsi sur toute la contrée, attendait tranquillement la fin du muet conciliabule.
— Alors, ce s'ra comme vous voudrez, père Charrault. Après tout, vous vous y connaissez mieux que nous, vous avez ben l'habitude, vous…
Grand-père les attendait là. Il trempait sa plume dans l'encrier, et cette fois, sans plus les consulter, énumérait d'une voix sûre, tout en écrivant, ce qui lui paraissait indispensable pour réussir un “ vrai ” festin, cependant que le couple, à la fois résigné et un peu soulagé, attendait la fin du supplice. Grand-père scellait l'accord en allant chercher au collier une bouteille de son “ vin bouché ”, du “ gamay ” qu'il récoltait aux Ch'tis Bouchis, un vin ginguet, râpeux et rude comme la terre, comme les hommes de chez nous, un vin authentique qui vous fouaillait les papilles aux limites du supportable, mais laissait ensuite et pour longtemps au palais la saveur délicieuse du raisin que l'on croque à la grappe.
Maintenant, un peu plus détendu, peut-être un peu échauffé par le vin, l'homme se hasarde à quelques paroles : “ on n'a qu'une fille, alors… on veut qu'les choses soient bien faites… ”
Il n'a pas dit dix mois en tout. Mais tout à l'heure, quand ils seront sortis, ils discuteront longtemps pour savoir si l'Douard ne les a pas roulés. Et après la noce même, quand tous les invités, qui s'alimentent tout au long de l'année de pommes de terre accommodées de lard, d'œufs, parfois d'un lapin mal bouilli ou d'une volaille mal réussie, seront repartis, satisfaits, rotant et pétant, les clients de Grand-père, au moment de payer, auront encore des doutes et quelques regrets…
C'est donc le vendredi que Grand-père commençait réellement à vivre. Levé plus tôt que les autres jours, il revêtait sa tenue de cuisinier, pantalon et veste à petits carreaux bleus et blancs, et grand tablier blanc. Il bourrait son four de fagots, un magnifique four de briques installé dans une petite pièce toute noire, la “ chambre à four ”, et pendant que le four chauffait, il préparait dans une autre maison du bourg, à cinquante mètres de là, sa pâtisserie, car il faisait lui-même la pâtisserie, du moins les tartes, allumettes et feuilletés, qu'on appelle en Nivernais des “ galettes ”. Je le vois encore, descendant la rue et portant à bout de bras ses tôles chargées de tartes grosses comme des roues de charrette, je revois son visage rond, épanoui, rouge carmin ses yeux moqueurs et son petit nez, son ventre replet ceint du tablier blanc. Il coiffait rarement la toque des grands chefs, mais quand il se rendait au four, il avait l'allure des grands maîtres de la gastronomie, et le roi Dumaine lui-même n'était pas son cousin : ces jours-là, Grand-père était proprement impérial, que Bocuse et Haeberlin me pardonnent !
Il partait le samedi matin à l'aube pour le village où se déroulait la noce. Il emmenait avec lui “ ses femmes ”, je veux dire tout le personnel dont il avait besoin, tant pour l'aider à la cuisine que pour servir, des personnes qu'il avait formées lui-même. Il se mettait alors à ses fourneaux, et ne les quittait plus jusqu'au dimanche midi, revenait le dimanche dans l'après-midi à Briez, un peu fatigué, et repartait le lundi pour compter sa vaisselle, la ranger dans de grandes caisses de bois et la rapporter. Mais la fête était finie ; il avait déjà troqué son costume de cuisinier contre les vêtements de paysan. Grand-père était redevenu “ comme tout le monde ”.
Son pouvoir sur les plaisirs de la bouche était unanimement reconnu, par les adultes qui ne manquaient pas de venir rôder près de la chambre à four au bon moment, quand Grand-père, armé de sa pelle de bois au long manche, allait chercher au fond du four les “ galettes ” bien montées, dorées et odorantes, les tartes couleur de miel, les allumettes croquantes, au léger goût de soufre ; il était bien connu des enfants aussi, qui venaient au “ feuillot ”. Le “ feuillot ”, c'était une sorte de privilège réservé aux enfants, une coutume qui leur donnait le droit de se présenter aux cuisines, le jour de la noce, et de recevoir un bon casse-croûte. Grand-père leur taillait un grand morceau de pain, le fendait en deux et y plaçait une tranche de gigot, une aile de poulet ou une patte de lapin.
Manger était pour Grand-père un acte quasi religieux. Non pas qu'à la maison il fît chaque jour bonne chère ; en fait, lorsqu'il travaillait aux noces, il mangeait fort peu, et toujours rapidement, et chez lui, il ne touchait jamais aux casseroles, laissant à Grand-mère le soin de préparer tous les repas, même les repas de famille, les jours de fête. Il n'est qu'un seul repas qu'il tenait à se préparer lui-même : le petit déjeuner. J'ai bien dit que c'était un repas. Grand-père commençait en général par finir la soupe de la veille, puis passait au café au lait, accompagné de façon diverse, selon les jours, mais toujours très copieux. C'était tantôt deux œufs au plat, tantôt un hareng frais rôti directement sur la braise du poêle. Mais, aussi simple que fût le repas, c'était toujours pour Grand-père une messe, qu'il célébrait lui-même et seul, lentement, respectueusement. Grand-mère mangeait pour vivre, rapidement, frugalement, sans y prendre apparemment plaisir. Grand-père mangeait d'abord pour jouir de la vie, et il savait toujours trouver, dans le plus humble mets, le petit quelque chose qui donne le plaisir.
Mais c'est dans les repas de famille que la messe atteignait les sommets du cérémonial, et devenait une concélébration. Grand-mère cuisinait fort bien, en général civet de lapin (mais quel civet !), et poulet rôti. Grand-père ne touchait à rien, se contentant de préparer les vins, et de découper le poulet. Pour cela, au beau milieu du repas, il s'emparait d'une planche très épaisse et d'un énorme couperet de boucher, se mettait à quatre pattes, et abattait à plusieurs reprises le couperet sur le malheureux poulet, avec des “ han ” puissants, comme s'il s'attaquait à un chêne. Puis il se relevait, posait le poulet sur la table et prononçait une formule rituelle, qui était son “ Orate, fratres ” : et maintenant, mangez ! Et ne nous pressons pas, nous avons le temps aujourd'hui, c'est la fête. Faisons comme les bourgeois ! Prenons notre temps !
Oui, ça, c'étaient des repas de famille !
Il ne faudrait pas prendre pour autant Grand-père pour un sybarite sans principe, un matérialiste ordinaire ou un fruste jouisseur. Non, la table et ses plaisirs n'occupaient pas toute sa vie. Il avait aussi quelques principes en matière de religion, et surtout de violentes passions politiques. C'est d'ailleurs à table, à chaque repas de famille, au moment où les femmes apportaient la crème à la vanille, qu'il exposait ses opinions, si l'on peut parler d'opinions et d'exposition. Qu'il assénait ses convictions, devrais-je dire.
Regard à l'homme. Il écarte les mains, air de dire : bien oui, c'est comme ça, il faut bien avoir fini les moissons…
Grand-père se dirige alors vers le bahut, prend un grand registre, sa plume, son encrier, chausse ses lunettes, fait asseoir son monde autour de la table de la cuisine, s'installe lui-même et ouvre le registre.
— Et qu'est-ce que vous voudriez que j'vous fasse ? Son regard scrute la femme, par dessus les lunettes. Grand-père m'impressionnait toujours, quand il mettait ses lunettes, cela lui arrivait si rarement, seulement quand il prenait les commandes, et en hiver, le soir, pour lire “ L'Aurore ”.
Il fallait en général mettre au point le déjeuner du samedi midi, le dîner, et le déjeuner du lendemain. Cela représentait des quantités fantastiques de victuailles à rassembler. Nouveau regard de la femme au mari : “ On a pensé, comme cela, pour l'entrée, à la tête de veau en vinaigrette ”. Ou alors, ce pouvaient être les vol-au-vent sauce financière, ou la galantine. Puis venait le premier plat de viande, obligatoirement en sauce, puis le second plat de viande, rôtie cette fois. Les deux plats de viande étaient indispensables pour une famille qui se respecte.
— Et puis, pour le soir, si vous pouviez nous faire votre colin… Si c'était pas trop cher, bien entendu… Vous savez, les Barriau sont pas près d'oublier celui qu'vous avez fait pour la noce à leur fille.
Et c'est vrai que le chef-d'œuvre de Grand-père, son morceau de bravoure, c'était le colin accommode d'une sauce que lui seul connaissait, et qu'on avait baptisée dans la région “ sauce Charrault ”. Il l'a toujours tenue jalousement secrète, jusqu'à la fin de ses jours où il me l'a transmise. J'en suis aujourd'hui le seul et pieux dépositaire, et qu'on ne compte pas sur moi pour la dévoiler. Que l'on sache seulement qu'elle demande pour sa préparation de l'échalote grise, du vinaigre, du sel, du beurre et de la crème, et surtout, le tour de main, au bon moment, faute de quoi elle ressemble à tout, sauf à la sauce Charrault, dont seule la chair délicate du colin était et reste digne.
Venait le moment du verdict. L'heure de vérité. Grand-père, un coude sur le genou, regardant toujours les époux par-dessus les lunettes, commençait à énumérer les dizaines de poulets, les quinzaines de lapins, les kilos de beurre, les litres de crèmes qu'il fallait réunir. Je lisais alors sur les visages ravagés des malheureux les progrès de la panique. La face des femmes en particulier se décomposait un peu plus à mesure que Grand-père parlait. L'homme restait d'apparence plus insensible, se contentant de consulter sa femme du regard. Elle finissait invariablement par geindre. Parfois, les visages se butaient. On était au bord de la rupture.
— Evidemment, on peut faire à moins, si c'est le prix qui vous fait peur, concédait Grand-père. Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous offrir le colin, on peut le supprimer, ou le remplacer par autre chose… C'est à vous de voir. Tout dépend de ce qu'on veut… Vous pouvez même demander à quelqu'un d'autre… Vous trouverez toujours bien un tambouilleur pour “ faire manger ” vos invités…
Grand-père disait cela sur un ton égal, sans se départir de sa bonne humeur, sûr de son effet. Soupir de la femme. Regard résigné au mari : il faut y passer, quoi. Et que penseraient les voisins ? Une noce sans Charrault ? Mais ce n'est pas une noce, et les mariés ne seraient pas vraiment mariés. On dirait de nous que nous sommes “ regardants ”, ou, pire, que nous n'avons pas les moyens de marier dignement nos enfants. Non, décidément, il faut passer par les volontés du père Charrault. Le mari écarte encore une fois les mains. Il ne prononce pas un mot. Cela veut dire : comment faire autrement ? On ne peut plus reculer…
Grand-père, qui régnait ainsi sur toute la contrée, attendait tranquillement la fin du muet conciliabule.
— Alors, ce s'ra comme vous voudrez, père Charrault. Après tout, vous vous y connaissez mieux que nous, vous avez ben l'habitude, vous…
Grand-père les attendait là. Il trempait sa plume dans l'encrier, et cette fois, sans plus les consulter, énumérait d'une voix sûre, tout en écrivant, ce qui lui paraissait indispensable pour réussir un “ vrai ” festin, cependant que le couple, à la fois résigné et un peu soulagé, attendait la fin du supplice. Grand-père scellait l'accord en allant chercher au collier une bouteille de son “ vin bouché ”, du “ gamay ” qu'il récoltait aux Ch'tis Bouchis, un vin ginguet, râpeux et rude comme la terre, comme les hommes de chez nous, un vin authentique qui vous fouaillait les papilles aux limites du supportable, mais laissait ensuite et pour longtemps au palais la saveur délicieuse du raisin que l'on croque à la grappe.
Maintenant, un peu plus détendu, peut-être un peu échauffé par le vin, l'homme se hasarde à quelques paroles : “ on n'a qu'une fille, alors… on veut qu'les choses soient bien faites… ”
Il n'a pas dit dix mois en tout. Mais tout à l'heure, quand ils seront sortis, ils discuteront longtemps pour savoir si l'Douard ne les a pas roulés. Et après la noce même, quand tous les invités, qui s'alimentent tout au long de l'année de pommes de terre accommodées de lard, d'œufs, parfois d'un lapin mal bouilli ou d'une volaille mal réussie, seront repartis, satisfaits, rotant et pétant, les clients de Grand-père, au moment de payer, auront encore des doutes et quelques regrets…
C'est donc le vendredi que Grand-père commençait réellement à vivre. Levé plus tôt que les autres jours, il revêtait sa tenue de cuisinier, pantalon et veste à petits carreaux bleus et blancs, et grand tablier blanc. Il bourrait son four de fagots, un magnifique four de briques installé dans une petite pièce toute noire, la “ chambre à four ”, et pendant que le four chauffait, il préparait dans une autre maison du bourg, à cinquante mètres de là, sa pâtisserie, car il faisait lui-même la pâtisserie, du moins les tartes, allumettes et feuilletés, qu'on appelle en Nivernais des “ galettes ”. Je le vois encore, descendant la rue et portant à bout de bras ses tôles chargées de tartes grosses comme des roues de charrette, je revois son visage rond, épanoui, rouge carmin ses yeux moqueurs et son petit nez, son ventre replet ceint du tablier blanc. Il coiffait rarement la toque des grands chefs, mais quand il se rendait au four, il avait l'allure des grands maîtres de la gastronomie, et le roi Dumaine lui-même n'était pas son cousin : ces jours-là, Grand-père était proprement impérial, que Bocuse et Haeberlin me pardonnent !
Il partait le samedi matin à l'aube pour le village où se déroulait la noce. Il emmenait avec lui “ ses femmes ”, je veux dire tout le personnel dont il avait besoin, tant pour l'aider à la cuisine que pour servir, des personnes qu'il avait formées lui-même. Il se mettait alors à ses fourneaux, et ne les quittait plus jusqu'au dimanche midi, revenait le dimanche dans l'après-midi à Briez, un peu fatigué, et repartait le lundi pour compter sa vaisselle, la ranger dans de grandes caisses de bois et la rapporter. Mais la fête était finie ; il avait déjà troqué son costume de cuisinier contre les vêtements de paysan. Grand-père était redevenu “ comme tout le monde ”.
Son pouvoir sur les plaisirs de la bouche était unanimement reconnu, par les adultes qui ne manquaient pas de venir rôder près de la chambre à four au bon moment, quand Grand-père, armé de sa pelle de bois au long manche, allait chercher au fond du four les “ galettes ” bien montées, dorées et odorantes, les tartes couleur de miel, les allumettes croquantes, au léger goût de soufre ; il était bien connu des enfants aussi, qui venaient au “ feuillot ”. Le “ feuillot ”, c'était une sorte de privilège réservé aux enfants, une coutume qui leur donnait le droit de se présenter aux cuisines, le jour de la noce, et de recevoir un bon casse-croûte. Grand-père leur taillait un grand morceau de pain, le fendait en deux et y plaçait une tranche de gigot, une aile de poulet ou une patte de lapin.
Manger était pour Grand-père un acte quasi religieux. Non pas qu'à la maison il fît chaque jour bonne chère ; en fait, lorsqu'il travaillait aux noces, il mangeait fort peu, et toujours rapidement, et chez lui, il ne touchait jamais aux casseroles, laissant à Grand-mère le soin de préparer tous les repas, même les repas de famille, les jours de fête. Il n'est qu'un seul repas qu'il tenait à se préparer lui-même : le petit déjeuner. J'ai bien dit que c'était un repas. Grand-père commençait en général par finir la soupe de la veille, puis passait au café au lait, accompagné de façon diverse, selon les jours, mais toujours très copieux. C'était tantôt deux œufs au plat, tantôt un hareng frais rôti directement sur la braise du poêle. Mais, aussi simple que fût le repas, c'était toujours pour Grand-père une messe, qu'il célébrait lui-même et seul, lentement, respectueusement. Grand-mère mangeait pour vivre, rapidement, frugalement, sans y prendre apparemment plaisir. Grand-père mangeait d'abord pour jouir de la vie, et il savait toujours trouver, dans le plus humble mets, le petit quelque chose qui donne le plaisir.
Mais c'est dans les repas de famille que la messe atteignait les sommets du cérémonial, et devenait une concélébration. Grand-mère cuisinait fort bien, en général civet de lapin (mais quel civet !), et poulet rôti. Grand-père ne touchait à rien, se contentant de préparer les vins, et de découper le poulet. Pour cela, au beau milieu du repas, il s'emparait d'une planche très épaisse et d'un énorme couperet de boucher, se mettait à quatre pattes, et abattait à plusieurs reprises le couperet sur le malheureux poulet, avec des “ han ” puissants, comme s'il s'attaquait à un chêne. Puis il se relevait, posait le poulet sur la table et prononçait une formule rituelle, qui était son “ Orate, fratres ” : et maintenant, mangez ! Et ne nous pressons pas, nous avons le temps aujourd'hui, c'est la fête. Faisons comme les bourgeois ! Prenons notre temps !
Oui, ça, c'étaient des repas de famille !
Il ne faudrait pas prendre pour autant Grand-père pour un sybarite sans principe, un matérialiste ordinaire ou un fruste jouisseur. Non, la table et ses plaisirs n'occupaient pas toute sa vie. Il avait aussi quelques principes en matière de religion, et surtout de violentes passions politiques. C'est d'ailleurs à table, à chaque repas de famille, au moment où les femmes apportaient la crème à la vanille, qu'il exposait ses opinions, si l'on peut parler d'opinions et d'exposition. Qu'il assénait ses convictions, devrais-je dire.
J'ai déjà dit qu'il s'abonnait à “ L'Aurore ”, en hiver seulement, parce qu'en été il n'avait pas le temps de lire. Revenu, comme beaucoup de poilus, un peu anarchisant et politiquement désemparé de la guerre 14-18, il avait été vite conquis par les principes d'une droite bien traditionaliste, non extrémiste mais lourdement assise sur nos “ valeurs ”. Son grand homme avait été Raymond Poincaré, pas tellement le Président de la République du temps de guerre, mais le Président du Conseil qui avait “ restauré ” le franc (ou fait semblant de) dans les années 25-26. Grand-père était pour le travail honnête, qui permet comme chacun sait l'épargne, donne la sécurité, et assure la jouissance de biens acquis à la sueur du front, et donc ne doivent rien à personne. Homme de bonne foi, il ne se rendait pas compte que les quelques milliers de francs mis péniblement de côté en prévision des vieux jours lui étaient méthodiquement volés par ceux-là même en qui il voyait les défenseurs de la petite propriété honnêtement constituée.
L'ennui était aussi qu'il rencontrait dans les repas de famille des parangons de ceux qu'il aurait volontiers pendus (du moins en paroles, car Grand-père, chacun le sait, n'était pas méchant), oui, Grand-père avait à affronter deux communistes, ou peu s'en faut, mon oncle Cyprien, cheminot, responsable C.G.T. à la gare d'Austerlitz, et mon autre oncle, Rodolphe, son propre gendre, lui aussi cheminot, lui aussi adhérent à la C.G.T. et fortement sympathisant communiste.
Grand-père aimait beaucoup son gendre Rodolphe. Sauf au moment de la crème à la vanille. Il était inévitable qu'on aborde vers la fin du repas les questions politiques. Il y avait la guerre de Corée ; il y avait la bombe atomique, la guerre froide, il y avait la politique désastreuse pour tout le monde (enfin, tous ceux qui étaient à cette table) des gouvernements du temps. Et puis, je me demande si Grand-père ne recherchait pas systématiquement le conflit, histoire de se donner l'occasion de crier, de mettre un peu d'ambiance et d'embêter les femmes.
Les premières escarmouches ne venaient jamais de mes oncles, gens calmes, qui connaissaient bien Grand-père et savaient pertinemment et d'expérience qu'il était inutile (et d'ailleurs impossible) de discuter politique avec lui. Non, je dois l'avouer, c'est Grand-père qui cherchait la dispute. Les thèmes ne lui manquaient pas, fournis par “ L'Aurore ”. Mais s'il en est un qui avait le don de le faire sortir de ses gonds, c'était bien celui de la grève. Il ne pouvait admettre que des cheminots, des fonctionnaires, et plus généralement des ouvriers “ s'arrogent ” le droit de piller l'économie, de mettre la France en danger par des grèves non fondées, inadmissibles, etc… Il y voyait là le résultat tangible de l'action de Moscou, et regrettait amèrement l'époque où Clémenceau, “ premier flic de France ”, chargeait les grévistes, et où Poincaré, “ un homme, celui-là ”, pas un politicien, conduisait sagement la France sur les flots tranquilles d'une prospérité que rien ne semblait devoir interrompre. Oui, en somme, tout allait mal depuis la mort de Poincaré, et depuis que les communistes étaient devenus assez forts pour fourrer leur nez étranger dans nos affaires.
— Les communistes ! On devrait…on devrait… je ne sais pas, moi…
C'est qu'il y avait le gendre, que Grand-père aimait bien, et que les foudres exterminatrices qu'il invoquait devraient épargner… Mais Grand-père se lançaient à l'eau :
— On devrait tous les arrêter !
— Je vous ferai très poliment remarquer que c'est exactement ce que le gouvernement de Vichy et les Allemands ont essayé de faire, il n'y a pas très longtemps.
L'oncle Cyprien avait dit cela très calmement, sans quitter des yeux son assiette de crème à la vanille, dans laquelle il faisait mouvoir, songeusement, sa cuillère.
On approchait du paroxysme de l'orage. Chacun regardait obstinément le contenu jaunâtre de son assiette. Les femmes sentaient leur gorge se serrer. Quelques unes essuyaient en cachette une larme, d'un coin de serviette. Grand-mère Suzanne surveillait d'une mine inquiète et réprobatrice l'évolution de la congestion faciale de son mari. Elle craignait surtout que tout cela finisse sur un coup de sang, et que Grand-père ne nous quitte prématurément, comme cela, sans avoir reçu le sacrement de l'extrême-onction, sans même avoir eu le temps d'aller à confesse, avec, en conséquence, le châtiment divin qui ne manquerait pas de frapper et priverait le pauvre vieux des félicités éternelles ; Grand-mère ne pensait pas que Dieu, dans Sa sage justice, prendrait en considération les opinions politiques du pécheur, en quoi j'espère elle ne se trompait pas. C'est que, bien que votant probablement “ modéré ” ou “ conservateur ” comme on disait pudiquement à cette époque, elle était d'un esprit trop fin et nuancé pour ne pas avoir compris que la vérité n'était pas toute d'un côté, et pour ne pas discerner, dans le discours de mes deux oncles, quelques éléments de bien-fondé. Et elle comprenait fort bien que la véhémente passion de Grand-père cachait mal un raisonnement qui n'était pas sans failles.
L'atmosphère, dans ces secondes qui suivaient l'intervention de l'oncle Cyprien, devenait oppressante. Le silence autour de la table était épais, on suffoquait, comme avant le premier coup de tonnerre et les premières gouttes de pluie libératrices.
Grand-père, aux paroles de Cyprien, avait cessé de déglutir. Il était resté deux ou trois secondes, bouche ouverte, et son visage, d'ordinaire toujours très coloré, était devenu presque violet.
— Ton “ Humanité ” ! ! Ton “ Humanité ” !… Grand-père cherchait la réplique. Il avait abattu violemment le poing sur la table. Les femmes avaient sursauté, la crème à la vanille frémi dans les assiettes.
— Ton “ Humanité ”, j'en voudrais pas… même pour me torcher le cul !
Et c'est en général sur cet argument imparable que Grand-père concluait ses discussions politiques.
Il fallait ensuite réparer le mal, et faire en sorte que le repas se termine dans la réconciliation. C'est à quoi s'efforçait en général ma mère :
— C'est toujours la même chose, pleurnichait-elle, on est assis là, tranquillement, en famille, et à chaque fois ça se finit comme cela. C'est de ta faute (elle s'en prenait à Grand-père), c'est toujours toi qui commences !
Mes tantes, de leur côté, faisaient semblant de réprimander leur mari, pour que les parts de reproche soient équilibrées, et les torts apparemment partagés. Les hommes se taisaient, et quelques minutes difficiles suivaient, où chacun cherchait un sujet de conversation neutre, qui permît de sortir honorablement du conflit. Le café, et surtout le marc qui l'accompagnait, permettaient en général de sortir de l'impasse. De toutes façons, le moment le plus difficile, celui de la crème à la vanille était passé.
J'ai gardé, depuis ce temps, une tendresse particulière pour la crème à la vanille. Chacun sa madeleine…
Si Grand-père avait en politique des idées arrêtées, stricto sensu, depuis trente ans, il était en revanche beaucoup plus circonspect en matière religieuse, et les rôles étaient presque inversés : c'est Grand-mère qui faisait preuve de convictions. Tranquilles. Grand-mère, on le sait, n'était pas une bigote. Je sais, pour avoir évoqué ces choses avec elle, que si elle donnait l'impression d'une chrétienne ferme et déterminée (et elle l'était en effet), elle ne laissait pas cependant de se poser des questions à l'égard de la foi et de la pratique religieuse. La foi et la pratique de Grand-mère étaient donc rien moins que routinières.
Tout autre était Grand-père sur ce sujet. Sa foi, si l'on peut dire, me semblait tiède et bien pragmatique. Il n'en avait semble-t-il pas toujours été ainsi. Je crois savoir qu'il était parti à la Grande guerre avec, je dirai, des vues conformes à celles de la moyenne des hommes du village : une croyance qu'on ne remettait pas en question, et en même temps une certaine réserve vis-à-vis des curés. Dans mon village, la plupart des hommes pratiquaient, et, je pense, croyaient. Mais leur pratique consistait seulement à suivre cinq cérémonies dans l'année : au Jour de l'An, aux Rameaux, à Pâques, au Quinze août et à Noël. Aucun ne communiait. Pas même à Pâques. Ou alors c'était l'exception que citaient à leur mari, en exemple, toutes les femmes.
L'ennui était aussi qu'il rencontrait dans les repas de famille des parangons de ceux qu'il aurait volontiers pendus (du moins en paroles, car Grand-père, chacun le sait, n'était pas méchant), oui, Grand-père avait à affronter deux communistes, ou peu s'en faut, mon oncle Cyprien, cheminot, responsable C.G.T. à la gare d'Austerlitz, et mon autre oncle, Rodolphe, son propre gendre, lui aussi cheminot, lui aussi adhérent à la C.G.T. et fortement sympathisant communiste.
Grand-père aimait beaucoup son gendre Rodolphe. Sauf au moment de la crème à la vanille. Il était inévitable qu'on aborde vers la fin du repas les questions politiques. Il y avait la guerre de Corée ; il y avait la bombe atomique, la guerre froide, il y avait la politique désastreuse pour tout le monde (enfin, tous ceux qui étaient à cette table) des gouvernements du temps. Et puis, je me demande si Grand-père ne recherchait pas systématiquement le conflit, histoire de se donner l'occasion de crier, de mettre un peu d'ambiance et d'embêter les femmes.
Les premières escarmouches ne venaient jamais de mes oncles, gens calmes, qui connaissaient bien Grand-père et savaient pertinemment et d'expérience qu'il était inutile (et d'ailleurs impossible) de discuter politique avec lui. Non, je dois l'avouer, c'est Grand-père qui cherchait la dispute. Les thèmes ne lui manquaient pas, fournis par “ L'Aurore ”. Mais s'il en est un qui avait le don de le faire sortir de ses gonds, c'était bien celui de la grève. Il ne pouvait admettre que des cheminots, des fonctionnaires, et plus généralement des ouvriers “ s'arrogent ” le droit de piller l'économie, de mettre la France en danger par des grèves non fondées, inadmissibles, etc… Il y voyait là le résultat tangible de l'action de Moscou, et regrettait amèrement l'époque où Clémenceau, “ premier flic de France ”, chargeait les grévistes, et où Poincaré, “ un homme, celui-là ”, pas un politicien, conduisait sagement la France sur les flots tranquilles d'une prospérité que rien ne semblait devoir interrompre. Oui, en somme, tout allait mal depuis la mort de Poincaré, et depuis que les communistes étaient devenus assez forts pour fourrer leur nez étranger dans nos affaires.
— Les communistes ! On devrait…on devrait… je ne sais pas, moi…
C'est qu'il y avait le gendre, que Grand-père aimait bien, et que les foudres exterminatrices qu'il invoquait devraient épargner… Mais Grand-père se lançaient à l'eau :
— On devrait tous les arrêter !
— Je vous ferai très poliment remarquer que c'est exactement ce que le gouvernement de Vichy et les Allemands ont essayé de faire, il n'y a pas très longtemps.
L'oncle Cyprien avait dit cela très calmement, sans quitter des yeux son assiette de crème à la vanille, dans laquelle il faisait mouvoir, songeusement, sa cuillère.
On approchait du paroxysme de l'orage. Chacun regardait obstinément le contenu jaunâtre de son assiette. Les femmes sentaient leur gorge se serrer. Quelques unes essuyaient en cachette une larme, d'un coin de serviette. Grand-mère Suzanne surveillait d'une mine inquiète et réprobatrice l'évolution de la congestion faciale de son mari. Elle craignait surtout que tout cela finisse sur un coup de sang, et que Grand-père ne nous quitte prématurément, comme cela, sans avoir reçu le sacrement de l'extrême-onction, sans même avoir eu le temps d'aller à confesse, avec, en conséquence, le châtiment divin qui ne manquerait pas de frapper et priverait le pauvre vieux des félicités éternelles ; Grand-mère ne pensait pas que Dieu, dans Sa sage justice, prendrait en considération les opinions politiques du pécheur, en quoi j'espère elle ne se trompait pas. C'est que, bien que votant probablement “ modéré ” ou “ conservateur ” comme on disait pudiquement à cette époque, elle était d'un esprit trop fin et nuancé pour ne pas avoir compris que la vérité n'était pas toute d'un côté, et pour ne pas discerner, dans le discours de mes deux oncles, quelques éléments de bien-fondé. Et elle comprenait fort bien que la véhémente passion de Grand-père cachait mal un raisonnement qui n'était pas sans failles.
L'atmosphère, dans ces secondes qui suivaient l'intervention de l'oncle Cyprien, devenait oppressante. Le silence autour de la table était épais, on suffoquait, comme avant le premier coup de tonnerre et les premières gouttes de pluie libératrices.
Grand-père, aux paroles de Cyprien, avait cessé de déglutir. Il était resté deux ou trois secondes, bouche ouverte, et son visage, d'ordinaire toujours très coloré, était devenu presque violet.
— Ton “ Humanité ” ! ! Ton “ Humanité ” !… Grand-père cherchait la réplique. Il avait abattu violemment le poing sur la table. Les femmes avaient sursauté, la crème à la vanille frémi dans les assiettes.
— Ton “ Humanité ”, j'en voudrais pas… même pour me torcher le cul !
Et c'est en général sur cet argument imparable que Grand-père concluait ses discussions politiques.
Il fallait ensuite réparer le mal, et faire en sorte que le repas se termine dans la réconciliation. C'est à quoi s'efforçait en général ma mère :
— C'est toujours la même chose, pleurnichait-elle, on est assis là, tranquillement, en famille, et à chaque fois ça se finit comme cela. C'est de ta faute (elle s'en prenait à Grand-père), c'est toujours toi qui commences !
Mes tantes, de leur côté, faisaient semblant de réprimander leur mari, pour que les parts de reproche soient équilibrées, et les torts apparemment partagés. Les hommes se taisaient, et quelques minutes difficiles suivaient, où chacun cherchait un sujet de conversation neutre, qui permît de sortir honorablement du conflit. Le café, et surtout le marc qui l'accompagnait, permettaient en général de sortir de l'impasse. De toutes façons, le moment le plus difficile, celui de la crème à la vanille était passé.
J'ai gardé, depuis ce temps, une tendresse particulière pour la crème à la vanille. Chacun sa madeleine…
Si Grand-père avait en politique des idées arrêtées, stricto sensu, depuis trente ans, il était en revanche beaucoup plus circonspect en matière religieuse, et les rôles étaient presque inversés : c'est Grand-mère qui faisait preuve de convictions. Tranquilles. Grand-mère, on le sait, n'était pas une bigote. Je sais, pour avoir évoqué ces choses avec elle, que si elle donnait l'impression d'une chrétienne ferme et déterminée (et elle l'était en effet), elle ne laissait pas cependant de se poser des questions à l'égard de la foi et de la pratique religieuse. La foi et la pratique de Grand-mère étaient donc rien moins que routinières.
Tout autre était Grand-père sur ce sujet. Sa foi, si l'on peut dire, me semblait tiède et bien pragmatique. Il n'en avait semble-t-il pas toujours été ainsi. Je crois savoir qu'il était parti à la Grande guerre avec, je dirai, des vues conformes à celles de la moyenne des hommes du village : une croyance qu'on ne remettait pas en question, et en même temps une certaine réserve vis-à-vis des curés. Dans mon village, la plupart des hommes pratiquaient, et, je pense, croyaient. Mais leur pratique consistait seulement à suivre cinq cérémonies dans l'année : au Jour de l'An, aux Rameaux, à Pâques, au Quinze août et à Noël. Aucun ne communiait. Pas même à Pâques. Ou alors c'était l'exception que citaient à leur mari, en exemple, toutes les femmes.
Rodolphe, "Nonon"
Car les Briezoises, dans leur immense majorité, assistaient régulièrement à la messe du dimanche, et communiaient à Pâques. On peut même dire que dans une grande mesure les curés dirigeaient les familles, et les rapports du couple, jusqu'au lit, par la femme.
Grand-père, comme tout le monde donc, prenait le chemin de l'église cinq fois l'an, et en plus à l'occasion des enterrements. Je me souviens l'avoir vu exécuter à la messe les gestes rituels, mais il ne me donnait pas l'impression d'être vraiment à ce qu'il faisait.
J'ai retrouvé une lettre que son curé lui avait écrite pendant la guerre. C'est une réponse à un mot que Grand-père lui avait envoyé des tranchées. Comme je regrette de ne pas le posséder, et de n'en connaître que la réponse ! Mais cette réponse permet de deviner la nature des propos que tenait Grand-père, et son état d'esprit pendant la guerre. Voici donc ce que lui écrivait son curé, le 7 septembre 1916 :
“ Mon cher Edouard
Eh ! oui, j'ai éprouvé le plus grand plaisir à vous lire. Il y avait si longtemps que je l'avais fait. Et à votre dernière permission vous aviez tant l'horrible cafard ! ! ! J'en étais d'autant plus peiné pour vous que m'unissant de tout cœur à vos héroïques sacrifices et souffrances depuis deux ans j'étais consterné de vous entendre dire des choses… énormes… Vous qui en temps de paix faisiez preuve de réelle clairvoyance dans les choses et les hommes.
Il est vrai que les fatigues endurées et les dangers courus expliquent bien des attitudes. Quand vous nous reviendrez après la Victoire vous verrez combien l'épreuve aura mûri votre jugement et vous aidera à voir le sens réel de la vie. Nos poilus qui ont sauvé le pays pendant la guerre le sauveront encore après. J'ai l'intime confiance qu'ils ne se laisseront plus berner et duper par les politiciens sans aveu avec les grands mots de Capitalisme… Pacifisme… Internationalisme… Désarmement… Socialisme… Fraternité des peuples, etc…
Malheureusement dans l'horrible fléau qui met toutes les familles en deuil il y a trop d'innocents qui paient pour les coupables.
En attendant nous vivons des heures bien tragiques et le pays allait aux abîmes. Mais je me laisse aller… Ce n'est pas le moment de discuter ou de récriminer. L'essentiel est pour le moment de chasser les Boches pour reprendre la liberté de vivre en France sous le sole de Dieu.
Et vraisemblablement nous sommes entrés dans la période définitive de la guerre. Combien durera-t-elle ? C'est le secret d'En Haut. Mais j'estime que L'Allemagne sera réduite. Croyez-le bien, le filet européen se resserre autour d'elle. La bête est traquée… Qu'elle nous donne encore des coups de tête violents… c'est possible… c'est certain, mais elle cédera. Dieu le veuille, et que ce soit bientôt…
A bientôt le plaisir de vous voir.
Bien cordialement vôtre,
X, curé de Briez.
P.S. Trois nouvelles bien tristes cette semaine : X tué le 17 août, Y, de Ravières tué, Z, du cachot tué également. ”
Toute l'entre-deux guerres, les Ligues et les thèmes de l'Action Française et du pétainisme sont déjà contenus dans cette lettre qui se voulait réconfortante. J'ignore si elle le fut, et j'en doute surtout à la lecture du post-scriptum… Il est en tous cas certain que cette guerre a profondément ébranlé Grand-père, surtout en matière religieuse. Et c'était, je l'ai déjà dit, le grand désespoir de ma grand-mère. Elle avait décidé que son devoir de chrétienne était de “ sauver ” son époux, et elle en avait fait sa tâche quotidienne. Aussi ne manquait-elle pas une occasion de tarabuster Grand-père et de lui faire peur. Au moindre juron (les occasions ne manquaient pas), à la moindre alerte de santé, elle, d'habitude si douce et réservée, agressait littéralement le pauvre vieux, et faisait montrer de mauvaise humeur :
— Ça tousse, ça a un pied dans la tombe, et ça ne veut pas aller se confesser.
Ou bien :
— Ça jure, c'est couvert de péchés, et c'est tout près de mourir !
Les assauts redoublaient dans les semaines qui précédaient Pâques. En vain. Grand-père restait souriant mais inébranlable, et répondait presque invariablement :
— Oui ma vieille, je sais bien ce que j'ai à faire… Fous-moi donc la paix. D'abord, j'ai pas fait de péché. Quel péché tu veux que Dieu me reproche ? J'ai fait la guerre : j'ai même pas tué un Allemand, ça, j'en suis sûr. Alors ? Fais-moi donc pas “ agouiller ” mon temps !
Je crois que Grand-père ne disait pas cela pour irriter ma grand-mère, mais qu'il était effectivement persuadé d'être en état de grâce, ou peu s'en faut : “ t'en fais pas, ma vieille, quand j'sentirai le moment arriver, je f'rai ce qu'il faut. Mais pour l'instant, fous moi la paix… Je l'sentirai bien, quand je s'rai près de mourir. Il sera toujours temps de voir à ce moment-là… ”
Grand-mère baissait les bras, découragée.
Grand-père, comme tout le monde donc, prenait le chemin de l'église cinq fois l'an, et en plus à l'occasion des enterrements. Je me souviens l'avoir vu exécuter à la messe les gestes rituels, mais il ne me donnait pas l'impression d'être vraiment à ce qu'il faisait.
J'ai retrouvé une lettre que son curé lui avait écrite pendant la guerre. C'est une réponse à un mot que Grand-père lui avait envoyé des tranchées. Comme je regrette de ne pas le posséder, et de n'en connaître que la réponse ! Mais cette réponse permet de deviner la nature des propos que tenait Grand-père, et son état d'esprit pendant la guerre. Voici donc ce que lui écrivait son curé, le 7 septembre 1916 :
“ Mon cher Edouard
Eh ! oui, j'ai éprouvé le plus grand plaisir à vous lire. Il y avait si longtemps que je l'avais fait. Et à votre dernière permission vous aviez tant l'horrible cafard ! ! ! J'en étais d'autant plus peiné pour vous que m'unissant de tout cœur à vos héroïques sacrifices et souffrances depuis deux ans j'étais consterné de vous entendre dire des choses… énormes… Vous qui en temps de paix faisiez preuve de réelle clairvoyance dans les choses et les hommes.
Il est vrai que les fatigues endurées et les dangers courus expliquent bien des attitudes. Quand vous nous reviendrez après la Victoire vous verrez combien l'épreuve aura mûri votre jugement et vous aidera à voir le sens réel de la vie. Nos poilus qui ont sauvé le pays pendant la guerre le sauveront encore après. J'ai l'intime confiance qu'ils ne se laisseront plus berner et duper par les politiciens sans aveu avec les grands mots de Capitalisme… Pacifisme… Internationalisme… Désarmement… Socialisme… Fraternité des peuples, etc…
Malheureusement dans l'horrible fléau qui met toutes les familles en deuil il y a trop d'innocents qui paient pour les coupables.
En attendant nous vivons des heures bien tragiques et le pays allait aux abîmes. Mais je me laisse aller… Ce n'est pas le moment de discuter ou de récriminer. L'essentiel est pour le moment de chasser les Boches pour reprendre la liberté de vivre en France sous le sole de Dieu.
Et vraisemblablement nous sommes entrés dans la période définitive de la guerre. Combien durera-t-elle ? C'est le secret d'En Haut. Mais j'estime que L'Allemagne sera réduite. Croyez-le bien, le filet européen se resserre autour d'elle. La bête est traquée… Qu'elle nous donne encore des coups de tête violents… c'est possible… c'est certain, mais elle cédera. Dieu le veuille, et que ce soit bientôt…
A bientôt le plaisir de vous voir.
Bien cordialement vôtre,
X, curé de Briez.
P.S. Trois nouvelles bien tristes cette semaine : X tué le 17 août, Y, de Ravières tué, Z, du cachot tué également. ”
Toute l'entre-deux guerres, les Ligues et les thèmes de l'Action Française et du pétainisme sont déjà contenus dans cette lettre qui se voulait réconfortante. J'ignore si elle le fut, et j'en doute surtout à la lecture du post-scriptum… Il est en tous cas certain que cette guerre a profondément ébranlé Grand-père, surtout en matière religieuse. Et c'était, je l'ai déjà dit, le grand désespoir de ma grand-mère. Elle avait décidé que son devoir de chrétienne était de “ sauver ” son époux, et elle en avait fait sa tâche quotidienne. Aussi ne manquait-elle pas une occasion de tarabuster Grand-père et de lui faire peur. Au moindre juron (les occasions ne manquaient pas), à la moindre alerte de santé, elle, d'habitude si douce et réservée, agressait littéralement le pauvre vieux, et faisait montrer de mauvaise humeur :
— Ça tousse, ça a un pied dans la tombe, et ça ne veut pas aller se confesser.
Ou bien :
— Ça jure, c'est couvert de péchés, et c'est tout près de mourir !
Les assauts redoublaient dans les semaines qui précédaient Pâques. En vain. Grand-père restait souriant mais inébranlable, et répondait presque invariablement :
— Oui ma vieille, je sais bien ce que j'ai à faire… Fous-moi donc la paix. D'abord, j'ai pas fait de péché. Quel péché tu veux que Dieu me reproche ? J'ai fait la guerre : j'ai même pas tué un Allemand, ça, j'en suis sûr. Alors ? Fais-moi donc pas “ agouiller ” mon temps !
Je crois que Grand-père ne disait pas cela pour irriter ma grand-mère, mais qu'il était effectivement persuadé d'être en état de grâce, ou peu s'en faut : “ t'en fais pas, ma vieille, quand j'sentirai le moment arriver, je f'rai ce qu'il faut. Mais pour l'instant, fous moi la paix… Je l'sentirai bien, quand je s'rai près de mourir. Il sera toujours temps de voir à ce moment-là… ”
Grand-mère baissait les bras, découragée.
Septembre 1953
La conversion du Douard
Bien des fois Grand-père avait évoqué, en ma présence la vieillesse et la mort. Ces pensées sont de vieilles compagnes des paysans. Quand ils passent de longues journées dans la seule compagnie des bêtes, le silence et la méditation emportent leurs songes plus loin qu'on imagine : oserai-je dire, presque aussi loin que s'ils étaient de “ vrais ” philosophes ? J'ai souvent été surpris par leurs réflexions sur la vie, la mort, toutes ces choses si simples et si impénétrables.
C'est entre hommes que mes paysans parlent parfois de cela : les femmes, je veux dire celles de ma campagne, gâtent les interrogations métaphysiques car elles balaient le doute à coups de vérités révélées. C'est aux champs, en plein travail, ou bien même au café que, au détour d'une conversation anodine, j'ai entendu les hommes de la terre livrer le fond de leur être, et, pudiquement, aborder aux graves questions.
Je dois dire que Grand-père ne s'est jamais prononcé, devant moi, sur l'Au-delà ; il était là-dessus d'une sage circonspection. Il ne craignait point tellement la mort, mais plutôt la vieillesse et les infirmités : “ Moi, si un jour je ne peux plus manger et boire à mon aise, je préférerai m'en aller. Je ne veux pas me voir traîner comme une vieille bête inutile, à la charge de sa famille. Et surtout, je veux profiter jusqu'à la fin de tout ce que la vie a de bon ! ”
Il disait cela de sa voix tranquille, un peu grasseyante. Il fut presque exaucé.
Les premiers troubles commencèrent au mois de septembre perte de mémoire, difficulté d'élocution, sorte de paralysie momentanée et très partielle. Le diagnostic du médecin nous laissa sans espoir : “ C'est une artériosclérose… très avancée : ses artères sont aussi dures que des tuyaux de pipe, le cœur fatigué… d'un moment à l'autre un vaisseau peut éclater, au cerveau, entraînant soit une paralysie définitive, soit la mort. ” Tout ce qu'on pouvait espérer était une prolongation de quelques mois, avec force médicaments, et surtout un régime draconien qui supprimait tout ce que Grand-père aimait. Autant dire qu'il fallait renoncer d'emblée à réaliser cette deuxième condition. Quant aux causes de la maladie, les médecins s'en soucient peu… Inch Allah ! Hérédité, terrain propice, etc… Il semble que les gaz dégagés par les fourneaux à charbon de bois que Grand-père utilisait, n'ont pas été étrangers à la dégradation de sa santé. Pour le reste, et en dépit de son métier, il n'avait jamais fait d'excès de table, il était gourmet, et non goinfre.
Il se remit de cette première alerte. Mais il était affaibli, son moral affecté, sa belle humeur partie. S'il dut renoncer à tout travail, s'il abandonna, sauf une ou deux fois, la tenue de cuisinier, son four et ses marmites, il nous fut bien impossible de le persuader de se passer de beurre, de crème, et surtout de sel. Je me souviens l'avoir surpris en train d'en dérober dans le placard, en cachette de Grand-mère, pour en faire une provision clandestine.
Un répit de près de deux mois suivit. Nous commencions à vouloir oublier les paroles du docteur. Après tout, Grand-père n'était pas si âgé, soixante-douze ans, et il semblait se remettre.
Le docteur ne s'était hélas pas trompé, et une seconde attaque, en novembre, mit fin à nos illusions. Grand-père se plaignit pendant quelques jours de violents maux de tête. Il ne se souvenait plus de rien, et évoquait des événements vieux de plus de vingt ans comme s'ils s'étaient passés quelques mois plus tôt. Il dut s'aliter. Nous faisions cercle autour du lit, atterrés par cette sorte de délire, ces paroles où s'enchevêtrait toute une vie chronologiquement déchirée, bousculée, d'où émergeaient des souvenirs de la petite enfance, des évocations incompréhensibles de nous tous, sauf de Grand-mère, parfois.
Brusquement, Grand-père rejeta le drap qui le couvrait, voulut se lever, tituba et fit quelques pas.
— Où vas-tu, mon Douard, demanda doucement Grand-mère ?
— Ben, j’m'en vas chez nous, fit Grand-père qui tentait de gagner la porte, s'appuyant au lit, puis à l'armoire, à la table. “ Chez nous ”, cela voulait dire au café, où il était né.
— Mais c'est ici, chez nous, dit Grand-mère, qui le prit par la main et réussit à le ramener au lit, à le coucher comme un enfant.
C'était la première fois que je voyais un grand malade, et je découvrais avec stupéfaction comment un homme qui avait derrière lui toute une vie d'autonomie pouvait devenir dépendant et faible, comment, à la fin des jours, nous nous rapprochons de l'état d'enfance. Beaucoup plus tard, je devais faire la même constatation avec Grand-mère, et je tins sa pauvre vieille main, dans les ultimes minutes de lucidité, comme j'aurais tenu celle d'un enfant ; je lui parlais comme à un enfant. Le rapport des générations avait totalement basculé : j'étais l'adulte, elle était une pauvre petite chose souffrante qu'on aurait voulu prendre dans ses bras et bercer.
Grand-père surmonta encore cette attaque ; au bout de quelques jours le mal s'apaisa, il put se lever ; il retrouva sa mémoire, à tel point qu'il nous semblait avoir rêvé, fait un mauvais cauchemar. Mais à partir de ce moment les crises se firent de plus en plus rapprochées. Grand-père lui aussi se prenait à espérer, entre deux rechutes, tout en se voyant diminuer. C'était pour nous un crève-cœur.
L'hiver passa ainsi, avec ses alternances d'angoisses et d'espoir. Vers la fin de la mauvaise saison, il nous sembla que les forces montantes de la vie, qui commençaient à s'éveiller, allaient aider l'organisme de Grand-père à surmonter la maladie. Notre Douard remit sa grosse veste de velours, qu'il n'avait plus endossée depuis l'automne, et il commença à sortir, à se hasarder à des promenades de plus en plus longues dans la campagne, rôdant dans les chemins creux au bord des haies ou se gonflaient les bourgeons, s'asseyant sur les talus pour profiter du soleil de mars qui faisait éclore les premières violettes. Il se remit même à rire et à plaisanter avec les gens qu'il rencontrait.
La dernière personne qu'il mit en boîte était sa voisine, “ la Biennassée ”. Une vieille demoiselle, parfaitement étrange au village et à ses habitants, née dans une famille de la bonne bourgeoisie du Havre, une famille d'armateurs. Elle avait reçu une éducation très raffinée, parlait un langage d'une richesse et d'une précision étonnante à Briez, et avec le plus grand naturel. De plus, excellente musicienne ; le dimanche, à l'église, elle se lançait dans des improvisations qu'elle était probablement seule à apprécier.
Mais l'ère de la splendeur était close pour elle depuis bien longtemps, et elle vivait dans un dénuement qu'elle cachait à grand-peine. Son père avait fait faillite, je n'ai jamais su dans quelles circonstances, mais c'était avant la première guerre mondiale, je crois. Peut-être avait-il été une “ victime ” de l'emprunt russe ? La famille avait en tout cas été ruinée, et la demoiselle Biennassée s'était retrouvée, je ne sais comment, la bonne, et surtout l'égérie du curé de Briez ; elle n'avait sauvé du désastre que son éducation, quelques cuillères d'argent, et deux vieux tapis qu'elle vendit d'ailleurs dans les dernières années pour subsister, ou plus exactement, je crois, pour s'acheter les litres de gros rouge qu'elle consommait exagérément.
Le curé était mort depuis longtemps ; un autre, plus jeune, l'avait remplacé, et il s'était empressé d'écarter la demoiselle Biennassée du presbytère et de la sacristie ; la pauvre avait ainsi perdu le pouvoir occulte, mais réel, qu'elle exerçait sur le village par l'intermédiaire du vieux curé. Il ne lui restait plus que l'usage de l'harmonium. On l'appelait à Briez “ la Biennassée ”. Cet article placé devant le nom n'était pas d'un usage habituel au village. Il introduisait toujours une nuance péjorative. Je ne sais pas exactement ce qui avait valu à la vieille demoiselle cette sorte d'animosité agacée que traduisait l'article. Evidemment, elle était, à sa manière, marginale par son éducation, sa culture, et on la trouvait d'une piété trop ostentatoire, suspecte. On avait l'impression qu'elle avait mené le brave vieux curé par le bout du nez, et c'est cette influence qu'en fait on ne lui pardonnait pas.
A l'époque de la maladie de Grand-père, “ la Biennassée ” était descendue de quelques degrés encore dans la misère, elle vivait seule dans une petite pièce mal éclairée, jamais aérée. Le corps s'était tassé, desséché, le visage était allongé, osseux, jaune et maladif, ravagé de rides profondes et crasseuses : elle rassemblait en elle tous les traits de la vieille fille confite en dévotion, jusqu'à la caricature. Seul, le langage était resté vif et précis. C'était une pauvre vieille presque en guenilles, qui terminait dans la solitude une longue vie sans joie.
Grand-père aimait bien la taquiner. Mais il le faisait très gentiment, comme pour la distraire, et je crois qu'elle se laissait faire avec un plaisir coupable, comme une gamine qui aime se faire conter des gaudrioles. Un jour, je trouvai Douard d'excellente humeur. Il était hilare. Je n'étais plus habitué à voir ainsi pétiller son regard, et j'en éprouvai une grande joie.
— Tu ne sais pas ce que vient de me dire la Biennassée ? Je ne sais même pas comment c'est venu dans la conversation… Elle m'a dit : “ Vous me croirez si vous voulez, Monsieur Charrault, mais je n'ai jamais, à mon âge, vu un homme nu ! ”
— Alors moi, naturellement, que voulais-tu que je lui réponde ? Je lui ai dit que s'il le fallait, et que s'il n'y avait que ça pour lui faire plaisir, je voulais bien me dévouer.
Grand-père se tapa sur la cuisse en riant de plus belle.
— Ah si t'avais vu la tête qu'elle faisait ! Son visage s'est encore allongé, elle a arrondi la bouche en cul de poule, et m'a fait un : “ oh, monsieur Charrault ! ”… Mais j'crois bien qu'elle était pas si fâchée qu'elle voulait le faire croire !
Grand-père se remit à rire.
Ce fut une de ses dernières plaisanteries. Quelques jours plus tard, entre les Rameaux et Pâques, il dit à Grand-mère, avec un peu de gêne dans la voix, du bougonnement et de la tristesse aussi :
— Dis donc, ma vieille, prépare-moi donc une tenue propre.
— Pourquoi veux-tu une tenue propre ? On est en milieu de semaine…
— J'vais aller m'confesser, ma vieille…
Grand-mère l'avait pourtant laissé tranquille sur ce point depuis le début de la maladie. Elle baissa la tête, sortit le pantalon de velours des jours de fête, une chemise, un gilet et une veste propres. Elle regarda Grand-père enfiler ses vêtements, essuya une larme, mais ne dit pas un mot.
Grand-père sortit sur le pas de la porte, et à ce moment-là se retourna :
— Tu sais, j'vais passer derrière l'église, pour que l'père Milet ne m'voie pas. Il me d'mandrait où j'vas, et il se fouterait de moi.
Dans la famille, personne ne pensa à se moquer. Nous avions trop présente à la mémoire sa réplique : “ T'en fais pas, ma vieille, quand j'sentirai que l'moment est venu… ”
Ainsi, le moment était donc venu. Et il le savait.
La conversion du Douard
Bien des fois Grand-père avait évoqué, en ma présence la vieillesse et la mort. Ces pensées sont de vieilles compagnes des paysans. Quand ils passent de longues journées dans la seule compagnie des bêtes, le silence et la méditation emportent leurs songes plus loin qu'on imagine : oserai-je dire, presque aussi loin que s'ils étaient de “ vrais ” philosophes ? J'ai souvent été surpris par leurs réflexions sur la vie, la mort, toutes ces choses si simples et si impénétrables.
C'est entre hommes que mes paysans parlent parfois de cela : les femmes, je veux dire celles de ma campagne, gâtent les interrogations métaphysiques car elles balaient le doute à coups de vérités révélées. C'est aux champs, en plein travail, ou bien même au café que, au détour d'une conversation anodine, j'ai entendu les hommes de la terre livrer le fond de leur être, et, pudiquement, aborder aux graves questions.
Je dois dire que Grand-père ne s'est jamais prononcé, devant moi, sur l'Au-delà ; il était là-dessus d'une sage circonspection. Il ne craignait point tellement la mort, mais plutôt la vieillesse et les infirmités : “ Moi, si un jour je ne peux plus manger et boire à mon aise, je préférerai m'en aller. Je ne veux pas me voir traîner comme une vieille bête inutile, à la charge de sa famille. Et surtout, je veux profiter jusqu'à la fin de tout ce que la vie a de bon ! ”
Il disait cela de sa voix tranquille, un peu grasseyante. Il fut presque exaucé.
Les premiers troubles commencèrent au mois de septembre perte de mémoire, difficulté d'élocution, sorte de paralysie momentanée et très partielle. Le diagnostic du médecin nous laissa sans espoir : “ C'est une artériosclérose… très avancée : ses artères sont aussi dures que des tuyaux de pipe, le cœur fatigué… d'un moment à l'autre un vaisseau peut éclater, au cerveau, entraînant soit une paralysie définitive, soit la mort. ” Tout ce qu'on pouvait espérer était une prolongation de quelques mois, avec force médicaments, et surtout un régime draconien qui supprimait tout ce que Grand-père aimait. Autant dire qu'il fallait renoncer d'emblée à réaliser cette deuxième condition. Quant aux causes de la maladie, les médecins s'en soucient peu… Inch Allah ! Hérédité, terrain propice, etc… Il semble que les gaz dégagés par les fourneaux à charbon de bois que Grand-père utilisait, n'ont pas été étrangers à la dégradation de sa santé. Pour le reste, et en dépit de son métier, il n'avait jamais fait d'excès de table, il était gourmet, et non goinfre.
Il se remit de cette première alerte. Mais il était affaibli, son moral affecté, sa belle humeur partie. S'il dut renoncer à tout travail, s'il abandonna, sauf une ou deux fois, la tenue de cuisinier, son four et ses marmites, il nous fut bien impossible de le persuader de se passer de beurre, de crème, et surtout de sel. Je me souviens l'avoir surpris en train d'en dérober dans le placard, en cachette de Grand-mère, pour en faire une provision clandestine.
Un répit de près de deux mois suivit. Nous commencions à vouloir oublier les paroles du docteur. Après tout, Grand-père n'était pas si âgé, soixante-douze ans, et il semblait se remettre.
Le docteur ne s'était hélas pas trompé, et une seconde attaque, en novembre, mit fin à nos illusions. Grand-père se plaignit pendant quelques jours de violents maux de tête. Il ne se souvenait plus de rien, et évoquait des événements vieux de plus de vingt ans comme s'ils s'étaient passés quelques mois plus tôt. Il dut s'aliter. Nous faisions cercle autour du lit, atterrés par cette sorte de délire, ces paroles où s'enchevêtrait toute une vie chronologiquement déchirée, bousculée, d'où émergeaient des souvenirs de la petite enfance, des évocations incompréhensibles de nous tous, sauf de Grand-mère, parfois.
Brusquement, Grand-père rejeta le drap qui le couvrait, voulut se lever, tituba et fit quelques pas.
— Où vas-tu, mon Douard, demanda doucement Grand-mère ?
— Ben, j’m'en vas chez nous, fit Grand-père qui tentait de gagner la porte, s'appuyant au lit, puis à l'armoire, à la table. “ Chez nous ”, cela voulait dire au café, où il était né.
— Mais c'est ici, chez nous, dit Grand-mère, qui le prit par la main et réussit à le ramener au lit, à le coucher comme un enfant.
C'était la première fois que je voyais un grand malade, et je découvrais avec stupéfaction comment un homme qui avait derrière lui toute une vie d'autonomie pouvait devenir dépendant et faible, comment, à la fin des jours, nous nous rapprochons de l'état d'enfance. Beaucoup plus tard, je devais faire la même constatation avec Grand-mère, et je tins sa pauvre vieille main, dans les ultimes minutes de lucidité, comme j'aurais tenu celle d'un enfant ; je lui parlais comme à un enfant. Le rapport des générations avait totalement basculé : j'étais l'adulte, elle était une pauvre petite chose souffrante qu'on aurait voulu prendre dans ses bras et bercer.
Grand-père surmonta encore cette attaque ; au bout de quelques jours le mal s'apaisa, il put se lever ; il retrouva sa mémoire, à tel point qu'il nous semblait avoir rêvé, fait un mauvais cauchemar. Mais à partir de ce moment les crises se firent de plus en plus rapprochées. Grand-père lui aussi se prenait à espérer, entre deux rechutes, tout en se voyant diminuer. C'était pour nous un crève-cœur.
L'hiver passa ainsi, avec ses alternances d'angoisses et d'espoir. Vers la fin de la mauvaise saison, il nous sembla que les forces montantes de la vie, qui commençaient à s'éveiller, allaient aider l'organisme de Grand-père à surmonter la maladie. Notre Douard remit sa grosse veste de velours, qu'il n'avait plus endossée depuis l'automne, et il commença à sortir, à se hasarder à des promenades de plus en plus longues dans la campagne, rôdant dans les chemins creux au bord des haies ou se gonflaient les bourgeons, s'asseyant sur les talus pour profiter du soleil de mars qui faisait éclore les premières violettes. Il se remit même à rire et à plaisanter avec les gens qu'il rencontrait.
La dernière personne qu'il mit en boîte était sa voisine, “ la Biennassée ”. Une vieille demoiselle, parfaitement étrange au village et à ses habitants, née dans une famille de la bonne bourgeoisie du Havre, une famille d'armateurs. Elle avait reçu une éducation très raffinée, parlait un langage d'une richesse et d'une précision étonnante à Briez, et avec le plus grand naturel. De plus, excellente musicienne ; le dimanche, à l'église, elle se lançait dans des improvisations qu'elle était probablement seule à apprécier.
Mais l'ère de la splendeur était close pour elle depuis bien longtemps, et elle vivait dans un dénuement qu'elle cachait à grand-peine. Son père avait fait faillite, je n'ai jamais su dans quelles circonstances, mais c'était avant la première guerre mondiale, je crois. Peut-être avait-il été une “ victime ” de l'emprunt russe ? La famille avait en tout cas été ruinée, et la demoiselle Biennassée s'était retrouvée, je ne sais comment, la bonne, et surtout l'égérie du curé de Briez ; elle n'avait sauvé du désastre que son éducation, quelques cuillères d'argent, et deux vieux tapis qu'elle vendit d'ailleurs dans les dernières années pour subsister, ou plus exactement, je crois, pour s'acheter les litres de gros rouge qu'elle consommait exagérément.
Le curé était mort depuis longtemps ; un autre, plus jeune, l'avait remplacé, et il s'était empressé d'écarter la demoiselle Biennassée du presbytère et de la sacristie ; la pauvre avait ainsi perdu le pouvoir occulte, mais réel, qu'elle exerçait sur le village par l'intermédiaire du vieux curé. Il ne lui restait plus que l'usage de l'harmonium. On l'appelait à Briez “ la Biennassée ”. Cet article placé devant le nom n'était pas d'un usage habituel au village. Il introduisait toujours une nuance péjorative. Je ne sais pas exactement ce qui avait valu à la vieille demoiselle cette sorte d'animosité agacée que traduisait l'article. Evidemment, elle était, à sa manière, marginale par son éducation, sa culture, et on la trouvait d'une piété trop ostentatoire, suspecte. On avait l'impression qu'elle avait mené le brave vieux curé par le bout du nez, et c'est cette influence qu'en fait on ne lui pardonnait pas.
A l'époque de la maladie de Grand-père, “ la Biennassée ” était descendue de quelques degrés encore dans la misère, elle vivait seule dans une petite pièce mal éclairée, jamais aérée. Le corps s'était tassé, desséché, le visage était allongé, osseux, jaune et maladif, ravagé de rides profondes et crasseuses : elle rassemblait en elle tous les traits de la vieille fille confite en dévotion, jusqu'à la caricature. Seul, le langage était resté vif et précis. C'était une pauvre vieille presque en guenilles, qui terminait dans la solitude une longue vie sans joie.
Grand-père aimait bien la taquiner. Mais il le faisait très gentiment, comme pour la distraire, et je crois qu'elle se laissait faire avec un plaisir coupable, comme une gamine qui aime se faire conter des gaudrioles. Un jour, je trouvai Douard d'excellente humeur. Il était hilare. Je n'étais plus habitué à voir ainsi pétiller son regard, et j'en éprouvai une grande joie.
— Tu ne sais pas ce que vient de me dire la Biennassée ? Je ne sais même pas comment c'est venu dans la conversation… Elle m'a dit : “ Vous me croirez si vous voulez, Monsieur Charrault, mais je n'ai jamais, à mon âge, vu un homme nu ! ”
— Alors moi, naturellement, que voulais-tu que je lui réponde ? Je lui ai dit que s'il le fallait, et que s'il n'y avait que ça pour lui faire plaisir, je voulais bien me dévouer.
Grand-père se tapa sur la cuisse en riant de plus belle.
— Ah si t'avais vu la tête qu'elle faisait ! Son visage s'est encore allongé, elle a arrondi la bouche en cul de poule, et m'a fait un : “ oh, monsieur Charrault ! ”… Mais j'crois bien qu'elle était pas si fâchée qu'elle voulait le faire croire !
Grand-père se remit à rire.
Ce fut une de ses dernières plaisanteries. Quelques jours plus tard, entre les Rameaux et Pâques, il dit à Grand-mère, avec un peu de gêne dans la voix, du bougonnement et de la tristesse aussi :
— Dis donc, ma vieille, prépare-moi donc une tenue propre.
— Pourquoi veux-tu une tenue propre ? On est en milieu de semaine…
— J'vais aller m'confesser, ma vieille…
Grand-mère l'avait pourtant laissé tranquille sur ce point depuis le début de la maladie. Elle baissa la tête, sortit le pantalon de velours des jours de fête, une chemise, un gilet et une veste propres. Elle regarda Grand-père enfiler ses vêtements, essuya une larme, mais ne dit pas un mot.
Grand-père sortit sur le pas de la porte, et à ce moment-là se retourna :
— Tu sais, j'vais passer derrière l'église, pour que l'père Milet ne m'voie pas. Il me d'mandrait où j'vas, et il se fouterait de moi.
Dans la famille, personne ne pensa à se moquer. Nous avions trop présente à la mémoire sa réplique : “ T'en fais pas, ma vieille, quand j'sentirai que l'moment est venu… ”
Ainsi, le moment était donc venu. Et il le savait.
Papa avec le poulain qu'il avait sauvé, en lui faisant régurgiter une pomme coincée dans sa gorge.
Juillet 1954
Le baudet d'humilité.
C'est quelques mois plus tard que j'ai eu ma dernière conversation avec Grand-père. C'était le jour de la fête du village, qui “ tombait ” chaque année le premier dimanche de juillet, et, sans chercher à honorer quoi que ce soit (on l'appelait tout simplement la Fête de Briez), encostumait toute la population mâle et femelle, des enfants aux vieilles personnes, et attirait aussi les jeunes de toute la région. Un jour noir pour les poulets et les lapins, qu'on abattait passivement ; chaque famille se réunissait autour d'un repas qui durait trois ou quatre heures, et dont le menu ne variait guère d'une maison à l'autre : escargots de bourgogne en entrée ou tête de veau vinaigrette, civet de lapin, rôti de poulet. Parfois une salade. Jamais de fromage : “ j'en mangeons toute la semaine, on va pas en mettre sur la table le dimanche ! ”. On terminait donc de façon abrupte sur “ quelque chose de sucré ”, surtout pour les femmes.
Après cela, les hommes mariés descendaient aux cafés (Briez en comptait alors trois), et la politesse exigeait qu'ils les visitent tous. Ils se lançaient dans d'interminables parties de coinchées qu'ils poursuivaient jusque vers deux heures du matin, puis rentraient plus ou moins tanguants à la maison où les femmes les attendaient. La fête n'était pas pour elles, elles avaient occupé la journée comme elles pouvaient, et on ne leur demandait rien d'autre ce jour-là que préparer le repas, faire la vaisselle, attendre sagement le retour des hommes et se taire, même s'ils revenaient plus que mûrs.
Depuis ce temps, beaucoup de choses ont changé. Des générations de la “ Fête de Briez ” sont montées aux Terres Rouges, et la Fête a perdu avec elles sa raison d'être. Plus de repas de famille pantagruéliques, plus de coinchées ; plus beaucoup de jeunesse surtout. Depuis quelques années, la municipalité a voulu la revigorer ; elle lui a donné justification en l'élevant à la dignité de “ Fête des moissons ”, et prétexte à rassemblement en organisant une course cycliste. Rien à voir avec la “ Fête de Briez ”. D'ailleurs on ne sacrifie plus les poulets, puisque les quelques fermiers qui restent se sont débarrassés depuis longtemps de tout ce qui “ prenait du temps ” et rapportait peu, à commencer par les arbres fruitiers et la basse-cour. On ne prépare plus les escargots ; ils ont succombé à l'arrachage des haies et aux désherbants. La “ Fête de la Moisson ” s'est citadinisée aussi sur le plan culinaire : c'est le Supermarché qui fournit le pâté “ de campagne ” et le rosbeef. Seul progrès : on a introduit le “ plateau de fromage ”.
La “ Fête de Briez ”originelle vivait donc ses derniers instants en ce dimanche de juillet 1954. C'était au début de l'après-midi, la fête foraine n'avait pas encore vraiment commencé ; la place était presque vide et seuls quelques petits groupes de “ domestiques ” s'agglutinaient autour des stands. On appelait “ domestiques ” les ouvriers agricoles qui “ se louaient ” deux fois l'an aux “ Fouées aux Courtes-oreilles ”, à Couloutre à la Saint-Jean (c'était la Mouille-bec bien nommée) et à la Saint-Martin à Donzy. De pauvres gars, le plus souvent de l'Assistance Publique, qui gagnaient deux mille francs par an, nourris et logés. On les reconnaissait facilement à leur costume bleu-pétrole, leur cravate violette ou rouge-coquelicot. La veille, le coiffeur les avait abondamment brillantinés, et leur chevelure ondulait en grandes vagues durablement fixées par une abondante couche de cosmétique. Un beau garçon, dans les années cinquante, se devait d'avoir des cheveux bouclés, à la Charles Trenet. Cette fête, c'était pour eux une courte rupture dans leurs travaux, juste avant le grand coup de collier de la moisson, et qui sait, peut-être, le soir, la possibilité de “ sortir ” une fille ? Pour l'instant, ils tuaient le temps en descendant à la carabine des fleurs artificielles qu'ils accrochaient au revers de leur veston : une chance supplémentaire pour la chasse aux filles. Quelques unes, allant par paires, commençaient d'ailleurs à virevolter autour des groupes de garçons comme guêpes autour du miel ; elles passaient et repassaient, dans leur corsage à fleur et leur jupe bouffante, chuchotaient entre elles et montraient les garçons du doigt, pouffaient de rire pour attirer leur attention par ce manège provoquant. Les gamins faisaient leur premiers tours de chevaux de bois.
Je traversais cette “ fête ” que je trouvais bien triste ; j'étais seul, désoeuvré, je ne parvenais pas à trouver ma place dans cette partie où chacun jouait un jeu qui me semblait bien futile. J'étais à l'âge nigaud, bien évidemment trop grand pour monter sur les manèges, trop jeune pour me mêler aux joueurs de cartes. Quant aux filles, je ne savais pas comment les intéresser. Elles m'attiraient et m'intimidaient à la fois, tellement, à âge égal elles me paraissaient plus dégourdies que moi. Je me sentais gauche et me croyais ridicule avec mes cheveux raides et mes mèches rebelles qu'aucune pommade ne réussissait à maîtriser. Mes chances étaient nulles, je n'étais pas du tout au goût du jour…
Le café du village, près du ruisseau, à l'ombre des tilleuls qui entourent l'église, commençait à s'emplir. On entendait déjà résonner sur les tables les gros poings des paysans : “ belote ! ”, “ Re ! ”, “ Je coinche ! ”… Non, décidément, je n'avais rien à faire sur cette fête.
— Eh Jean !
J'ai reconnu la voix : Grand-père m'appelait, sur la porte du café : “ Vins donc te siéter un moment, j'suis tout seul ! ”
Que cela n'était donc pas dans ses habitudes… Avant sa maladie, il était toujours mêlé aux groupes de manilleurs, il criait et riait plus fort que tous, coinchait si violemment sur la table que verres et bouteilles tremblaient. C'était un joueur passionné, avant… Je le trouvais aujourd'hui, attablé devant un demi de bière. Seul.
Je me suis assis en face de lui, et il a commandé un autre demi pour moi. Il me regardait en silence ; je sentais qu'il avait besoin de ma compagnie, qu'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas par où commencer.
— Ça n'a pas tellement changé, finit-il par dire en regardant son verre qu'il faisait tourner lentement dans la main.
— Quoi donc, Grand-père ?
— Ben, ici. Tu vois, quand j'étais gamin, c'est déjà dans cette salle que mon père et ma mère tenaient leur bistrot. Il y avait les mêmes tables, les mêmes bancs. Il n'y a que la peinture qui a changé, et qu'on a refaite, quand mes parents ont mis le commerce en gérance. Soixante-dix ans, et pas de changement ! Si ça pouvait être pareil pour nous !… Tu vois, à côté, c'était déjà la cuisine, qui donne sur cette salle et sur une chambre. Et puis, en haut, il y a encore trois chambres. Oh, une belle maison ! Y'en a pas beaucoup comme celle-là, dans le bourg…
Grand-père parlait d'une voix rêveuse, le regard toujours fixé sur son verre : “ Tiens, je revois mon grand-père Louis, le sabotier. Il habitait juste à côté. C'est lui qui a gagné tout ça, avec ses sabots… Il venait “ des fois ” s'enfiler en douce une petite gorgée de goutte ; je le vois encore, comme si c'était hier… il s'essuyait les moustaches, “ du rvint du rva ”, deux coups de manche, replaçait en vitesse la bouteille, fermait la porte, “ ni vu ni connu, j’t'embrouille ” !…
Grand-père souriait, en pensant à l'aïeul Louis.
— Le “ pour vieux ”, tu sais comment il est mort ? J'étais chez lui quand c'est arrivé. On était tous les deux “ sietes ” devant le feu de cheminée. On le voyait “ baisser ” depuis quelque temps, et mes parents, pas tranquilles, m'envoyaient tous les soirs lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'il se couche. Tout d'un coup, vlan, il s'abat de tout son long en avant, sans un mot, et tombe en plein dans le feu. J'ai appelé mes parents. Quand on l'a relevé, tout le visage était déjà carbonisé, mais il était mort sur le coup, avant de tomber, heureusement pour lui…Une belle mort… Il a pas souffert, lui…
J'aurais voulu dire quelque chose ; je savais que Grand-père pensait surtout à sa maladie. Je savais qu'il était revenu aujourd'hui dans ce café, seul, pour revivre son enfance et sa jeunesse, et peut-être leur dire un dernier adieu… mais que dire ? Il m'avait appelé comme on appelle une grande personne pour se confier, pouvoir parler à voix haute.
Dehors, les manèges tournaient ; on entendait siruper la voix de Tino Rossi : “ Marinella, ah reste encore entre mes bras… ”, les coups de feu des carabines, les cris des filles.
— Ça fait soixante-dix ans, et rien n'a changé, répéta Grand-père. Il eut un petit sourire triste. Tout ce qui a changé, c'est nous. Y a bien longtemps que le grand-père Louis et mes parents sont là-haut, au “ cémtie ”… On m'a fait faire la guerre. J'en suis revenu, avec deux décorations. De la chance. T'as vu sur le Monument aux morts, les “ ceusses ” qui n'sont pas revenus ? Et pourquoi ? Moi, j'étais comme les autres, j'croyais que c'était la dernière… Même mon curé me l'écrivait, quand j'étais au front… Ah, j’t'en fous, oui, il était pas plus malin que nous, il se trompait bien, lui aussi ! La preuve, en 39, il a fallu repartir… enfin, pas moi, j'étais trop vieux, mais ton père… Alors, nous, ça n'avait servi à rien ?
Le baudet d'humilité.
C'est quelques mois plus tard que j'ai eu ma dernière conversation avec Grand-père. C'était le jour de la fête du village, qui “ tombait ” chaque année le premier dimanche de juillet, et, sans chercher à honorer quoi que ce soit (on l'appelait tout simplement la Fête de Briez), encostumait toute la population mâle et femelle, des enfants aux vieilles personnes, et attirait aussi les jeunes de toute la région. Un jour noir pour les poulets et les lapins, qu'on abattait passivement ; chaque famille se réunissait autour d'un repas qui durait trois ou quatre heures, et dont le menu ne variait guère d'une maison à l'autre : escargots de bourgogne en entrée ou tête de veau vinaigrette, civet de lapin, rôti de poulet. Parfois une salade. Jamais de fromage : “ j'en mangeons toute la semaine, on va pas en mettre sur la table le dimanche ! ”. On terminait donc de façon abrupte sur “ quelque chose de sucré ”, surtout pour les femmes.
Après cela, les hommes mariés descendaient aux cafés (Briez en comptait alors trois), et la politesse exigeait qu'ils les visitent tous. Ils se lançaient dans d'interminables parties de coinchées qu'ils poursuivaient jusque vers deux heures du matin, puis rentraient plus ou moins tanguants à la maison où les femmes les attendaient. La fête n'était pas pour elles, elles avaient occupé la journée comme elles pouvaient, et on ne leur demandait rien d'autre ce jour-là que préparer le repas, faire la vaisselle, attendre sagement le retour des hommes et se taire, même s'ils revenaient plus que mûrs.
Depuis ce temps, beaucoup de choses ont changé. Des générations de la “ Fête de Briez ” sont montées aux Terres Rouges, et la Fête a perdu avec elles sa raison d'être. Plus de repas de famille pantagruéliques, plus de coinchées ; plus beaucoup de jeunesse surtout. Depuis quelques années, la municipalité a voulu la revigorer ; elle lui a donné justification en l'élevant à la dignité de “ Fête des moissons ”, et prétexte à rassemblement en organisant une course cycliste. Rien à voir avec la “ Fête de Briez ”. D'ailleurs on ne sacrifie plus les poulets, puisque les quelques fermiers qui restent se sont débarrassés depuis longtemps de tout ce qui “ prenait du temps ” et rapportait peu, à commencer par les arbres fruitiers et la basse-cour. On ne prépare plus les escargots ; ils ont succombé à l'arrachage des haies et aux désherbants. La “ Fête de la Moisson ” s'est citadinisée aussi sur le plan culinaire : c'est le Supermarché qui fournit le pâté “ de campagne ” et le rosbeef. Seul progrès : on a introduit le “ plateau de fromage ”.
La “ Fête de Briez ”originelle vivait donc ses derniers instants en ce dimanche de juillet 1954. C'était au début de l'après-midi, la fête foraine n'avait pas encore vraiment commencé ; la place était presque vide et seuls quelques petits groupes de “ domestiques ” s'agglutinaient autour des stands. On appelait “ domestiques ” les ouvriers agricoles qui “ se louaient ” deux fois l'an aux “ Fouées aux Courtes-oreilles ”, à Couloutre à la Saint-Jean (c'était la Mouille-bec bien nommée) et à la Saint-Martin à Donzy. De pauvres gars, le plus souvent de l'Assistance Publique, qui gagnaient deux mille francs par an, nourris et logés. On les reconnaissait facilement à leur costume bleu-pétrole, leur cravate violette ou rouge-coquelicot. La veille, le coiffeur les avait abondamment brillantinés, et leur chevelure ondulait en grandes vagues durablement fixées par une abondante couche de cosmétique. Un beau garçon, dans les années cinquante, se devait d'avoir des cheveux bouclés, à la Charles Trenet. Cette fête, c'était pour eux une courte rupture dans leurs travaux, juste avant le grand coup de collier de la moisson, et qui sait, peut-être, le soir, la possibilité de “ sortir ” une fille ? Pour l'instant, ils tuaient le temps en descendant à la carabine des fleurs artificielles qu'ils accrochaient au revers de leur veston : une chance supplémentaire pour la chasse aux filles. Quelques unes, allant par paires, commençaient d'ailleurs à virevolter autour des groupes de garçons comme guêpes autour du miel ; elles passaient et repassaient, dans leur corsage à fleur et leur jupe bouffante, chuchotaient entre elles et montraient les garçons du doigt, pouffaient de rire pour attirer leur attention par ce manège provoquant. Les gamins faisaient leur premiers tours de chevaux de bois.
Je traversais cette “ fête ” que je trouvais bien triste ; j'étais seul, désoeuvré, je ne parvenais pas à trouver ma place dans cette partie où chacun jouait un jeu qui me semblait bien futile. J'étais à l'âge nigaud, bien évidemment trop grand pour monter sur les manèges, trop jeune pour me mêler aux joueurs de cartes. Quant aux filles, je ne savais pas comment les intéresser. Elles m'attiraient et m'intimidaient à la fois, tellement, à âge égal elles me paraissaient plus dégourdies que moi. Je me sentais gauche et me croyais ridicule avec mes cheveux raides et mes mèches rebelles qu'aucune pommade ne réussissait à maîtriser. Mes chances étaient nulles, je n'étais pas du tout au goût du jour…
Le café du village, près du ruisseau, à l'ombre des tilleuls qui entourent l'église, commençait à s'emplir. On entendait déjà résonner sur les tables les gros poings des paysans : “ belote ! ”, “ Re ! ”, “ Je coinche ! ”… Non, décidément, je n'avais rien à faire sur cette fête.
— Eh Jean !
J'ai reconnu la voix : Grand-père m'appelait, sur la porte du café : “ Vins donc te siéter un moment, j'suis tout seul ! ”
Que cela n'était donc pas dans ses habitudes… Avant sa maladie, il était toujours mêlé aux groupes de manilleurs, il criait et riait plus fort que tous, coinchait si violemment sur la table que verres et bouteilles tremblaient. C'était un joueur passionné, avant… Je le trouvais aujourd'hui, attablé devant un demi de bière. Seul.
Je me suis assis en face de lui, et il a commandé un autre demi pour moi. Il me regardait en silence ; je sentais qu'il avait besoin de ma compagnie, qu'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas par où commencer.
— Ça n'a pas tellement changé, finit-il par dire en regardant son verre qu'il faisait tourner lentement dans la main.
— Quoi donc, Grand-père ?
— Ben, ici. Tu vois, quand j'étais gamin, c'est déjà dans cette salle que mon père et ma mère tenaient leur bistrot. Il y avait les mêmes tables, les mêmes bancs. Il n'y a que la peinture qui a changé, et qu'on a refaite, quand mes parents ont mis le commerce en gérance. Soixante-dix ans, et pas de changement ! Si ça pouvait être pareil pour nous !… Tu vois, à côté, c'était déjà la cuisine, qui donne sur cette salle et sur une chambre. Et puis, en haut, il y a encore trois chambres. Oh, une belle maison ! Y'en a pas beaucoup comme celle-là, dans le bourg…
Grand-père parlait d'une voix rêveuse, le regard toujours fixé sur son verre : “ Tiens, je revois mon grand-père Louis, le sabotier. Il habitait juste à côté. C'est lui qui a gagné tout ça, avec ses sabots… Il venait “ des fois ” s'enfiler en douce une petite gorgée de goutte ; je le vois encore, comme si c'était hier… il s'essuyait les moustaches, “ du rvint du rva ”, deux coups de manche, replaçait en vitesse la bouteille, fermait la porte, “ ni vu ni connu, j’t'embrouille ” !…
Grand-père souriait, en pensant à l'aïeul Louis.
— Le “ pour vieux ”, tu sais comment il est mort ? J'étais chez lui quand c'est arrivé. On était tous les deux “ sietes ” devant le feu de cheminée. On le voyait “ baisser ” depuis quelque temps, et mes parents, pas tranquilles, m'envoyaient tous les soirs lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'il se couche. Tout d'un coup, vlan, il s'abat de tout son long en avant, sans un mot, et tombe en plein dans le feu. J'ai appelé mes parents. Quand on l'a relevé, tout le visage était déjà carbonisé, mais il était mort sur le coup, avant de tomber, heureusement pour lui…Une belle mort… Il a pas souffert, lui…
J'aurais voulu dire quelque chose ; je savais que Grand-père pensait surtout à sa maladie. Je savais qu'il était revenu aujourd'hui dans ce café, seul, pour revivre son enfance et sa jeunesse, et peut-être leur dire un dernier adieu… mais que dire ? Il m'avait appelé comme on appelle une grande personne pour se confier, pouvoir parler à voix haute.
Dehors, les manèges tournaient ; on entendait siruper la voix de Tino Rossi : “ Marinella, ah reste encore entre mes bras… ”, les coups de feu des carabines, les cris des filles.
— Ça fait soixante-dix ans, et rien n'a changé, répéta Grand-père. Il eut un petit sourire triste. Tout ce qui a changé, c'est nous. Y a bien longtemps que le grand-père Louis et mes parents sont là-haut, au “ cémtie ”… On m'a fait faire la guerre. J'en suis revenu, avec deux décorations. De la chance. T'as vu sur le Monument aux morts, les “ ceusses ” qui n'sont pas revenus ? Et pourquoi ? Moi, j'étais comme les autres, j'croyais que c'était la dernière… Même mon curé me l'écrivait, quand j'étais au front… Ah, j’t'en fous, oui, il était pas plus malin que nous, il se trompait bien, lui aussi ! La preuve, en 39, il a fallu repartir… enfin, pas moi, j'étais trop vieux, mais ton père… Alors, nous, ça n'avait servi à rien ?
Eugène laboure.
Grand-père se tut un moment. Il me regardait fixement sans attendre vraiment de réponse à ses questions.
— D'ailleurs, j'y ai rien compris à cette guerre de 39. Les Boches, fallait les chasser, c'est sûr. Mais ces jeunes qui ont voulu jouer au soldat, et qui s'cachaient dans les bois… J'ai pas bien compris. C'était pas du tout comme nous : nous, on avait les Boches en face de nous, à cinquante mètres, des fois moins. C'était clair. C'était eux ou nous. Mais les résistants ? Y'en avait-y-pas qui en profitaient pour faire autre chose ?
La Résistance n'avait jamais été bien comprise dans la région, ni bien admise. Les paysans se méfiaient… est-ce qu'on sait ? Des Rouges, qui sait ce qu'ils ont derrière la tête ? On était contre les Boches, ça c'est sûr. Contre Pétain aussi, en tout cas Grand-père l'était. Pour la libération, bien sûr. Mais il y avait pour cela les Américains et les Anglais. Alors, la Résistance… Et même le “ Grand Charles ”… Pas clair tout ça. Un seul n'était pas discuté, parce qu'il “ était propre, lui ”, c'était Leclerc. Les autres… méfiance.
— Et me v'là, “ sieté ” là, sur ce banc, exactement où j'étais voilà soixante-dix ans. Mais à c’t'heure, c'est la fin… Ça rime à quoi, tout ça ? J'veux dire, toute cette vie… Et encore, j'ai eu de bons moments. Je crois que j'en ai profité autant qu'un paysan peut profiter de la vie… Mais quand même, à quoi ça rime ?
Il ne me posait pas vraiment la question, et je regardais, embarrassé. Il reprit :
— Et Massery qui s'est pendu ? Et Edith qui se dessèche, toute seule dans sa grande maison ? Et la Biennassée qui n'a que son harmonium et ses bouteilles de rouge ? Y a-t-y un sens à ça ? C'est ça que je voudrais qu'on m'explique. Mais j'vois bien que j'vas partir, pas plus avancé que quand j'suis venu, ici, dans cette maison…
Je l'écoutais parler sans rien dire, hochant parfois la tête, soit pour l'approuver, soit pour essayer de lui dire : mais non, tu exagères, parle donc d'autre chose…
Grand-père sembla réfléchir à tout ce qu'il venait de dire. Le silence, entre nous, me parut interminable. Il ne quittait pas des yeux son verre de bière, attentif semblait-il aux petites bulles gazeuses qui montaient dans le liquide et venaient crever sous la mousse. Il était perdu dans son passé, sourd aux bruits de la fête, aux éclats de voix des joueurs de cartes, de plus en plus bruyants à mesure que s'accumulaient sur le bord des tables les chopines vides…
— Mais toi, t'es moins bête que moi. Tu fais des études… Tu comprendras peut-être tout ça, tout ce que j'ai pas compris…
Douard parlait d'une voix hésitante ; avec des arrêts.
— Mais tout instruit que tu s'ras, faudra pas “ que tu te croies ”… Y en a qui ont honte de leurs parents, quand ils sont instruits… Misère ! Tu s'ras pas comme eux, dis ?
Je souris un peu, l'air de dire : non mais, qu'est-ce que tu vas imaginer là ?
La porte du café était grande ouverte. L'après-midi s'avançait, des couples commençaient à se former ; nous les voyons passer et se diriger vers le bal qui s'ouvrait. Ils jetaient un coup d'œil à l'intérieur du bistrot, et poursuivaient leur chemin, enlacés et riants.
Une silhouette noire passa devant la porte, un peu courbée ; elle avançait d'un pas lent et régulier. C'était le père Reboulleau, avec ses grosses moustaches blanches à la Vercingétorix. Comme chaque soir, il était allé chercher son âne dans “ éance ”, et le ramenait à l'écurie. La bête suivait son maître, de la même allure tranquille et régulière, hochant la tête à chaque pas, comme un métronome, un sourire de vieux sage aux lèvres.
Grand-père avait suivi mon regard :
— Tu vois le baudet à Reboulleau. Il dit rien, mais il suit son maître et sourit, l'air de dire : faire ça ou autre chose… je pourrais fort bien désobéir, aller brouter les fleurs à Angéline Tavard, ou donner un coup de pied au père Picarnon qui passe et qui n'vaut pas la corde pour le pendre… Mais non. Cela n'aurait aucun sens. Alors, je suis sagement le père Reboulleau mon maître, sans rien dire. Il sait même pas que je pense…
Grand-père s'arrêta un instant, et me regarda bien droit dans les yeux, en ajoutant :
— Y'a une chose que j'ai comprise depuis quelques temps… enfin, j'crois… c'est qu'faut pas s'en “ faire en croire ”. Faut rester simple. La vie, c'est pas “ grand choue ”… Faire c'qui plaît, et qui n'fait de mal à personne, c'est tout… La vie, faut la traverser comme le baudet à Reboulleau traverse la place en c'moment, j'sais pas comment dire, moi…
— Avec humilité, Grand-père, c'est ça que tu veux dire ? Faut pas être orgueilleux, quoi ?
— C'est ça, avec humilité, t'as trouvé l'mot. Jean, mon garçon, c'que j'voudrais, c'est que tu restes simple… un baudet d'humilité, comme tu dis …
— D'ailleurs, j'y ai rien compris à cette guerre de 39. Les Boches, fallait les chasser, c'est sûr. Mais ces jeunes qui ont voulu jouer au soldat, et qui s'cachaient dans les bois… J'ai pas bien compris. C'était pas du tout comme nous : nous, on avait les Boches en face de nous, à cinquante mètres, des fois moins. C'était clair. C'était eux ou nous. Mais les résistants ? Y'en avait-y-pas qui en profitaient pour faire autre chose ?
La Résistance n'avait jamais été bien comprise dans la région, ni bien admise. Les paysans se méfiaient… est-ce qu'on sait ? Des Rouges, qui sait ce qu'ils ont derrière la tête ? On était contre les Boches, ça c'est sûr. Contre Pétain aussi, en tout cas Grand-père l'était. Pour la libération, bien sûr. Mais il y avait pour cela les Américains et les Anglais. Alors, la Résistance… Et même le “ Grand Charles ”… Pas clair tout ça. Un seul n'était pas discuté, parce qu'il “ était propre, lui ”, c'était Leclerc. Les autres… méfiance.
— Et me v'là, “ sieté ” là, sur ce banc, exactement où j'étais voilà soixante-dix ans. Mais à c’t'heure, c'est la fin… Ça rime à quoi, tout ça ? J'veux dire, toute cette vie… Et encore, j'ai eu de bons moments. Je crois que j'en ai profité autant qu'un paysan peut profiter de la vie… Mais quand même, à quoi ça rime ?
Il ne me posait pas vraiment la question, et je regardais, embarrassé. Il reprit :
— Et Massery qui s'est pendu ? Et Edith qui se dessèche, toute seule dans sa grande maison ? Et la Biennassée qui n'a que son harmonium et ses bouteilles de rouge ? Y a-t-y un sens à ça ? C'est ça que je voudrais qu'on m'explique. Mais j'vois bien que j'vas partir, pas plus avancé que quand j'suis venu, ici, dans cette maison…
Je l'écoutais parler sans rien dire, hochant parfois la tête, soit pour l'approuver, soit pour essayer de lui dire : mais non, tu exagères, parle donc d'autre chose…
Grand-père sembla réfléchir à tout ce qu'il venait de dire. Le silence, entre nous, me parut interminable. Il ne quittait pas des yeux son verre de bière, attentif semblait-il aux petites bulles gazeuses qui montaient dans le liquide et venaient crever sous la mousse. Il était perdu dans son passé, sourd aux bruits de la fête, aux éclats de voix des joueurs de cartes, de plus en plus bruyants à mesure que s'accumulaient sur le bord des tables les chopines vides…
— Mais toi, t'es moins bête que moi. Tu fais des études… Tu comprendras peut-être tout ça, tout ce que j'ai pas compris…
Douard parlait d'une voix hésitante ; avec des arrêts.
— Mais tout instruit que tu s'ras, faudra pas “ que tu te croies ”… Y en a qui ont honte de leurs parents, quand ils sont instruits… Misère ! Tu s'ras pas comme eux, dis ?
Je souris un peu, l'air de dire : non mais, qu'est-ce que tu vas imaginer là ?
La porte du café était grande ouverte. L'après-midi s'avançait, des couples commençaient à se former ; nous les voyons passer et se diriger vers le bal qui s'ouvrait. Ils jetaient un coup d'œil à l'intérieur du bistrot, et poursuivaient leur chemin, enlacés et riants.
Une silhouette noire passa devant la porte, un peu courbée ; elle avançait d'un pas lent et régulier. C'était le père Reboulleau, avec ses grosses moustaches blanches à la Vercingétorix. Comme chaque soir, il était allé chercher son âne dans “ éance ”, et le ramenait à l'écurie. La bête suivait son maître, de la même allure tranquille et régulière, hochant la tête à chaque pas, comme un métronome, un sourire de vieux sage aux lèvres.
Grand-père avait suivi mon regard :
— Tu vois le baudet à Reboulleau. Il dit rien, mais il suit son maître et sourit, l'air de dire : faire ça ou autre chose… je pourrais fort bien désobéir, aller brouter les fleurs à Angéline Tavard, ou donner un coup de pied au père Picarnon qui passe et qui n'vaut pas la corde pour le pendre… Mais non. Cela n'aurait aucun sens. Alors, je suis sagement le père Reboulleau mon maître, sans rien dire. Il sait même pas que je pense…
Grand-père s'arrêta un instant, et me regarda bien droit dans les yeux, en ajoutant :
— Y'a une chose que j'ai comprise depuis quelques temps… enfin, j'crois… c'est qu'faut pas s'en “ faire en croire ”. Faut rester simple. La vie, c'est pas “ grand choue ”… Faire c'qui plaît, et qui n'fait de mal à personne, c'est tout… La vie, faut la traverser comme le baudet à Reboulleau traverse la place en c'moment, j'sais pas comment dire, moi…
— Avec humilité, Grand-père, c'est ça que tu veux dire ? Faut pas être orgueilleux, quoi ?
— C'est ça, avec humilité, t'as trouvé l'mot. Jean, mon garçon, c'que j'voudrais, c'est que tu restes simple… un baudet d'humilité, comme tu dis …
Septembre 1954.
La mort de Douard
Septembre aux promesses tenues…
Septembre est un fruit odorant, génial à craquer. Les chaumes embaument et craquettent sous le soleil encore chaud. L'air s'immobilise, doux et parfumé des senteurs des pommes et des noix tombantes;
L'été retient son souffle. Son dernier souffle avant de mourir. On entend, venu de très loin, le bruissement des hommes au travail. Des taches rousses enflamment la tignasse des érables, premières parures de la mort.
Septembre s'assoupit, satisfait et heureux, génitrice comblée, sur son ventre replet. Des fils à la vierge traversent lentement le ciel bleu laiteux. Calme et tranquillité.
Et puis brusquement, en quelques heures parfois, septembre tourne sans bruit sur lui-même, comme une porte-tambour, et l'été s'en va. C'est dans l'air, c'est dans les odeurs que quelque chose a changé. Quelque chose. On ne saurait trop dire quoi. Si, peut-être cette fraîcheur nouvelle qui sent un peu la fumée des cheminées et pique le nez ; peut-être cette inhabituelle pesanteur de l'air, juste avant les grands vents d'équinoxe ; peut-être ces gouttes de rosée, que chaque hampe d'herbe porte à son extrémité, et qui scintillent là, toute la journée ; peut-être le vol bas et nerveux des hirondelles, qui font leur dernière moisson d'insectes, en ménagères pressées par le départ.
La vie végétale a tourné là-bas, au coin du chemin, derrière ce roncier qui ploie sous les mûres…
Elle nous laisse seuls, nous les hommes et les animaux ; il faut se faire une raison. C'est ce moment précis que Grand-père a choisi pour lui prendre la main et partir avec elle.
Pourtant, le matin, je lui avais porté un panier de quetsches odorantes, violacées, veloutées d'une fine buée qui disparaît dès qu'on les touche. Je l'avais trouvé bien. Presque le Grand-père d'avant la maladie. Il achevait une toilette soignée, ce qui n'était pas son habitude, et m'avait accueilli en souriant, son long couteau-rasoir à la main. Il essuyait à la serviette les dernières traces de crème à raser, et riait encore, par petits gloussements, comme aux temps où il venait de faire une farce à Grand-mère.
— Ah mon Jean ! J'ai bien rigolé tout à l'heure. Tu sais, j'ai rencontré la Biennassée : elle ne marchait pas, elle volait. C'était tout de même un peu tôt pour que ce soit l'effet du rouge…
— Qu'est-ce qui vous arrive donc, Mademoiselle, que je lui ai-fait ?
— Mon bon Monsieur Charrault, si vous saviez comme je suis contente ! Mon harmonium, qui n'en pouvait plus, vient d'être réparé : il a retrouvé tout son souffle, comme s'il était tout neuf !
— Alors je lui ai fait : j'en suis bien content pour vous. Au moins, à c’t'heure, ça va faire un boucan du diable dans l'église !
— Si tu l'avais vue ! Elle a joint les mains. Elle m'a regardé, tout apeurée :
— Oh ! Monsieur Charrault ! Si le Bon Dieu vous entendait !
Grand-père gonfla les joues, comme autrefois, comme s'il voulait se retenir de rire, mais son bon rire fusa en cascades, et il répétait :
— Non mais, j'aurais voulu que tu la voies ! J'ai cru qu'elle allait faire le signe de la croix, pour éloigner le diable !
Ce même soir de septembre je gardais les vaches aux champs, je suivais des yeux le ballet des hirondelles ; rapides comme l'éclair, à ras du sol, elles zigzaguaient en d'incroyables voltiges, entre mes bêtes. Je rêvais. Est-ce que je pensais à Grand-père ? Je ne sais pas. Le souci m'occupait inconsciemment, sans doute.
J'ai vu monter vers moi le père Drain, notre journalier. Le brave vieux ne se pressait pas. J'ai compris tout de suite ; je savais ce qu'il allait me dire. Aussi, je l'ai laisser arriver jusqu'à moi, sans bouger. Je me contentais de suivre son approche des yeux : on peut repousser ainsi, de quelques secondes, le malheur, et le vieil homme était évidemment, en ce soir doux de septembre, le mauvais messager, dont il est inutile de prévenir ou de fuir la venue.
— C'est ton papa qui m'envoie. Il faut que je te remplace ici.
Le père Drain marquait un temps d'hésitation. Il attendait une question : je continuais seulement à le fixer.
— C'est que ton grand-père, tu vois, ça ne va pas très bien. Tes parents sont partis chez lui. Tu dois rentrer… Tu vas dîner, ton papa viendra te donner des nouvelles.
Le père Drain avait dit seulement : “ Ton grand-père, ça ne vas pas très bien ”. Mais au ton de la voix, je savais ce qu'il voulait me faire comprendre. Je savais aussi que mes parents ne tenaient pas à ce que j'aille moi-même, pour l'instant, à la maison de Grand-père. Cela suffisait.
J'ai fait ce que l'on me demandait. J'ai dîné, seul ; j'ai grignoté un peu de fromage et de pain, et à la nuit tombante, mon père est venu me donner des nouvelles. Non, ce n'était pas une alerte habituelle. Hémiplégie. Cela pouvait être la fin. Le médecin avait laissé peu d'espoir. Dans le meilleur des cas, Grand-père pouvait “ traîner ” quelques semaines, quelques mois. Il ne se remettrait de toutes façons jamais totalement… Pour l'instant, il était couché, inconscient. Oui, papa reviendrait s'il y avait “ du nouveau ”, mais il ne tenait pas à ce que j'aille le voir.
Je me suis couché. Je me suis endormi. Un mauvais sommeil, pire que l'insomnie. Grand-père apparaissait dans mes cauchemars. Je le voyais s'avancer dans le chemin qui conduit à notre maison. Il avait surmonté son attaque. Il restait très handicapé, mais il marchait tout de même, appuyé sur un bâton.
Papa est revenu à l'aube. Je l'ai entendu ouvrir la porte, s'approcher de ma chambre. Comme le veille, je ne suis pas allé au devant du malheur. Papa est entré, et il m'a regardé. Il ne m'a rien dit. Je ne lui ai rien demandé. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'ai eu envie de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai su, à ce moment même, que mon enfance venait de s'achever. Oui, c'était fini. A trois heures du matin. Sans souffrance. A aucun moment Grand-père n'était sorti du coma
Je me suis habillé, machinalement, et j'ai pris le chemin de “ sa ” maison, et je regardais d'un œil tout nouveau chaque arbre, chaque haie, chaque champ : la “ Châtaignaie-Bardot ”, les “ Champs-Pincot ”, le “ Petit Renfroumis des Lemains ”, tous ces champs familiers me semblaient à la fois différents, et en même temps j'étais choqué de les retrouver à leur place, comme si la mort de Grand-père ne les bouleversait pas, eux-aussi. J'en voulais presque aux choses de rester en dehors de notre malheur. Il me semblait que tout était changé. Or, aucun signe apparent, dans le village, dans la campagne, n'annonçait ce qui venait d'arriver. J'avais dix-sept ans, et je recevais en pleine face, tout d'un coup, cette révélation, ce risible cheminement de l'homme qui passe… On dit : c'est la vie… Et pourquoi pas la mort ? L'homme rit, souffre, travaille et procrée, il retourne la terre, année après année. Toujours la même terre. Il récolte, année après année, le foin, le blé, les pommes et les noix, aux mêmes arbres, et il finit par s'identifier à cette terre, à ces arbres. Il meurt : tout devrait mourir aussi. Mais non, la terre et les arbres attendent l'autre génération, qui refait les même gestes, et rien ne change. C'est peut-être bien ainsi.
On avait fermé les volets de la maison de Grand-père. Je suis entré dans la chambre où il “ reposait ”. Quel silence ! Quelle immobilité ! Grand-père gisait sur le lit, bien droit, le visage calme et comme transfiguré d'un étrange sourire. On eût dit le sourire de la Sagesse que l'on voit, mystérieux, aux visages des divinités hindoues.
Mon regard se posa sur les mains jointes du mort : elles tenaient un chapelet. C'était surprenant, déplacé presque. Grand-père n'avait sans doute jamais tenu de chapelet depuis sa première communion. Deux cierges allumés projetaient d'immenses ombres dans la pièce ; le visage semblait par instants s'animer à leur lueur tremblotante. On avait déposé sur la table de nuit un bol rempli d'eau bénite dans laquelle trempait un rameau de buis. On avait arrêté la vieille horloge à l'instant précis où Grand-père avait rendu le dernier soupiR;
Grand-mère était totalement désemparée. Elle ne pleurait pas, mais elle ne pouvait rester en place ; elle trottait de l'armoire au lit, du lit à la table, changeait de place un cierge, le bol, tapotait l'oreiller de Grand-père, et poussait de profonds soupirs. Je l'ai seulement entendue une fois dire en hochant la tête, bras ballants, impuissante :
— Mon “ pour ” petit ! Mon pauvre petit. Cette expression, dans ma tristesse, me frappa d'étonnement, et m'en apprit plus sur le couple qui venait de se briser que les dix-sept années pendant lesquelles je l'avais vu vivre.
La mort de Douard
Septembre aux promesses tenues…
Septembre est un fruit odorant, génial à craquer. Les chaumes embaument et craquettent sous le soleil encore chaud. L'air s'immobilise, doux et parfumé des senteurs des pommes et des noix tombantes;
L'été retient son souffle. Son dernier souffle avant de mourir. On entend, venu de très loin, le bruissement des hommes au travail. Des taches rousses enflamment la tignasse des érables, premières parures de la mort.
Septembre s'assoupit, satisfait et heureux, génitrice comblée, sur son ventre replet. Des fils à la vierge traversent lentement le ciel bleu laiteux. Calme et tranquillité.
Et puis brusquement, en quelques heures parfois, septembre tourne sans bruit sur lui-même, comme une porte-tambour, et l'été s'en va. C'est dans l'air, c'est dans les odeurs que quelque chose a changé. Quelque chose. On ne saurait trop dire quoi. Si, peut-être cette fraîcheur nouvelle qui sent un peu la fumée des cheminées et pique le nez ; peut-être cette inhabituelle pesanteur de l'air, juste avant les grands vents d'équinoxe ; peut-être ces gouttes de rosée, que chaque hampe d'herbe porte à son extrémité, et qui scintillent là, toute la journée ; peut-être le vol bas et nerveux des hirondelles, qui font leur dernière moisson d'insectes, en ménagères pressées par le départ.
La vie végétale a tourné là-bas, au coin du chemin, derrière ce roncier qui ploie sous les mûres…
Elle nous laisse seuls, nous les hommes et les animaux ; il faut se faire une raison. C'est ce moment précis que Grand-père a choisi pour lui prendre la main et partir avec elle.
Pourtant, le matin, je lui avais porté un panier de quetsches odorantes, violacées, veloutées d'une fine buée qui disparaît dès qu'on les touche. Je l'avais trouvé bien. Presque le Grand-père d'avant la maladie. Il achevait une toilette soignée, ce qui n'était pas son habitude, et m'avait accueilli en souriant, son long couteau-rasoir à la main. Il essuyait à la serviette les dernières traces de crème à raser, et riait encore, par petits gloussements, comme aux temps où il venait de faire une farce à Grand-mère.
— Ah mon Jean ! J'ai bien rigolé tout à l'heure. Tu sais, j'ai rencontré la Biennassée : elle ne marchait pas, elle volait. C'était tout de même un peu tôt pour que ce soit l'effet du rouge…
— Qu'est-ce qui vous arrive donc, Mademoiselle, que je lui ai-fait ?
— Mon bon Monsieur Charrault, si vous saviez comme je suis contente ! Mon harmonium, qui n'en pouvait plus, vient d'être réparé : il a retrouvé tout son souffle, comme s'il était tout neuf !
— Alors je lui ai fait : j'en suis bien content pour vous. Au moins, à c’t'heure, ça va faire un boucan du diable dans l'église !
— Si tu l'avais vue ! Elle a joint les mains. Elle m'a regardé, tout apeurée :
— Oh ! Monsieur Charrault ! Si le Bon Dieu vous entendait !
Grand-père gonfla les joues, comme autrefois, comme s'il voulait se retenir de rire, mais son bon rire fusa en cascades, et il répétait :
— Non mais, j'aurais voulu que tu la voies ! J'ai cru qu'elle allait faire le signe de la croix, pour éloigner le diable !
Ce même soir de septembre je gardais les vaches aux champs, je suivais des yeux le ballet des hirondelles ; rapides comme l'éclair, à ras du sol, elles zigzaguaient en d'incroyables voltiges, entre mes bêtes. Je rêvais. Est-ce que je pensais à Grand-père ? Je ne sais pas. Le souci m'occupait inconsciemment, sans doute.
J'ai vu monter vers moi le père Drain, notre journalier. Le brave vieux ne se pressait pas. J'ai compris tout de suite ; je savais ce qu'il allait me dire. Aussi, je l'ai laisser arriver jusqu'à moi, sans bouger. Je me contentais de suivre son approche des yeux : on peut repousser ainsi, de quelques secondes, le malheur, et le vieil homme était évidemment, en ce soir doux de septembre, le mauvais messager, dont il est inutile de prévenir ou de fuir la venue.
— C'est ton papa qui m'envoie. Il faut que je te remplace ici.
Le père Drain marquait un temps d'hésitation. Il attendait une question : je continuais seulement à le fixer.
— C'est que ton grand-père, tu vois, ça ne va pas très bien. Tes parents sont partis chez lui. Tu dois rentrer… Tu vas dîner, ton papa viendra te donner des nouvelles.
Le père Drain avait dit seulement : “ Ton grand-père, ça ne vas pas très bien ”. Mais au ton de la voix, je savais ce qu'il voulait me faire comprendre. Je savais aussi que mes parents ne tenaient pas à ce que j'aille moi-même, pour l'instant, à la maison de Grand-père. Cela suffisait.
J'ai fait ce que l'on me demandait. J'ai dîné, seul ; j'ai grignoté un peu de fromage et de pain, et à la nuit tombante, mon père est venu me donner des nouvelles. Non, ce n'était pas une alerte habituelle. Hémiplégie. Cela pouvait être la fin. Le médecin avait laissé peu d'espoir. Dans le meilleur des cas, Grand-père pouvait “ traîner ” quelques semaines, quelques mois. Il ne se remettrait de toutes façons jamais totalement… Pour l'instant, il était couché, inconscient. Oui, papa reviendrait s'il y avait “ du nouveau ”, mais il ne tenait pas à ce que j'aille le voir.
Je me suis couché. Je me suis endormi. Un mauvais sommeil, pire que l'insomnie. Grand-père apparaissait dans mes cauchemars. Je le voyais s'avancer dans le chemin qui conduit à notre maison. Il avait surmonté son attaque. Il restait très handicapé, mais il marchait tout de même, appuyé sur un bâton.
Papa est revenu à l'aube. Je l'ai entendu ouvrir la porte, s'approcher de ma chambre. Comme le veille, je ne suis pas allé au devant du malheur. Papa est entré, et il m'a regardé. Il ne m'a rien dit. Je ne lui ai rien demandé. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. J'ai eu envie de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai su, à ce moment même, que mon enfance venait de s'achever. Oui, c'était fini. A trois heures du matin. Sans souffrance. A aucun moment Grand-père n'était sorti du coma
Je me suis habillé, machinalement, et j'ai pris le chemin de “ sa ” maison, et je regardais d'un œil tout nouveau chaque arbre, chaque haie, chaque champ : la “ Châtaignaie-Bardot ”, les “ Champs-Pincot ”, le “ Petit Renfroumis des Lemains ”, tous ces champs familiers me semblaient à la fois différents, et en même temps j'étais choqué de les retrouver à leur place, comme si la mort de Grand-père ne les bouleversait pas, eux-aussi. J'en voulais presque aux choses de rester en dehors de notre malheur. Il me semblait que tout était changé. Or, aucun signe apparent, dans le village, dans la campagne, n'annonçait ce qui venait d'arriver. J'avais dix-sept ans, et je recevais en pleine face, tout d'un coup, cette révélation, ce risible cheminement de l'homme qui passe… On dit : c'est la vie… Et pourquoi pas la mort ? L'homme rit, souffre, travaille et procrée, il retourne la terre, année après année. Toujours la même terre. Il récolte, année après année, le foin, le blé, les pommes et les noix, aux mêmes arbres, et il finit par s'identifier à cette terre, à ces arbres. Il meurt : tout devrait mourir aussi. Mais non, la terre et les arbres attendent l'autre génération, qui refait les même gestes, et rien ne change. C'est peut-être bien ainsi.
On avait fermé les volets de la maison de Grand-père. Je suis entré dans la chambre où il “ reposait ”. Quel silence ! Quelle immobilité ! Grand-père gisait sur le lit, bien droit, le visage calme et comme transfiguré d'un étrange sourire. On eût dit le sourire de la Sagesse que l'on voit, mystérieux, aux visages des divinités hindoues.
Mon regard se posa sur les mains jointes du mort : elles tenaient un chapelet. C'était surprenant, déplacé presque. Grand-père n'avait sans doute jamais tenu de chapelet depuis sa première communion. Deux cierges allumés projetaient d'immenses ombres dans la pièce ; le visage semblait par instants s'animer à leur lueur tremblotante. On avait déposé sur la table de nuit un bol rempli d'eau bénite dans laquelle trempait un rameau de buis. On avait arrêté la vieille horloge à l'instant précis où Grand-père avait rendu le dernier soupiR;
Grand-mère était totalement désemparée. Elle ne pleurait pas, mais elle ne pouvait rester en place ; elle trottait de l'armoire au lit, du lit à la table, changeait de place un cierge, le bol, tapotait l'oreiller de Grand-père, et poussait de profonds soupirs. Je l'ai seulement entendue une fois dire en hochant la tête, bras ballants, impuissante :
— Mon “ pour ” petit ! Mon pauvre petit. Cette expression, dans ma tristesse, me frappa d'étonnement, et m'en apprit plus sur le couple qui venait de se briser que les dix-sept années pendant lesquelles je l'avais vu vivre.
Dans la soirée, les premiers voisins sont arrivés, pour “ jeter ” de l'eau bénite. Ils entraient sur la pointe des pieds, comme s'ils avaient craint de réveiller Grand-père. Tout le village défila et s'arrêta quelques minutes auprès du lit. Les hommes sont venus à la nuit, après les travaux ; ils s'étaient “ papropis ”, comme le dimanche, ils entraient silencieusement, gauchement, croisaient leurs grosses mains et faisaient semblant de se recueillir quelques minutes. Tous sont venus. Ceux qui aimaient bien Grand-père. Ceux qui l'aimaient moins aussi. Puis ils se retournaient, et cherchaient quelque chose à dire, à Grand-mère. C'étaient toujours de pauvres, mais si profondes banalités : C'que c'est quand même… on n'est pas “ grand choue ” sur terre… On le voyait bien baisser, mais on n'aurait jamais cru que ça irait si vite. Ou bien : il était pourtant pas tellement vieux… quel âge que ça lui faisait donc au juste ? Soixante douze ? C'est ben c'que je pensais… Les plus âgés calculaient combien, à ce prix, il leur restait encore à vivre… Enfin ! Ça pressait pourtant pas… Mais quand c'est l'heure, dame… Puis, d'une tout autre voix, très pratique celle-là : c'est pour quand l'enterrement ?
L'un d'eux, le père Milet justement, qui avait à peu près l'âge de Grand-père, a murmuré : t'en fais pas, mon pour vieux, j'vas bentout de r'joindre…
Et Grand-mère racontait presque à chaque nouvelle visite les derniers moments de lucidité de Grand-père, comme si elle eût voulu arrêter le temps à cet instant précis :
— On était à table, on venait de finir de manger. Il semblait aller bien, même un peu mieux depuis quelques jours. Comme toujours après chaque repas, il s'apprêtait à faire sa cigarette. Il avait sorti son paquet de tabac, placé sa feuille de papier à cigarette entre ses lèvres. Et puis, il ne bougeait plus. Je lui ait dit : eh bien, tu ne fais donc pas ta cigarette ? Il m'a regardée ; il m'a souri un peu. Je vous assure qu'il a souri. Mais il ne m'a pas répondu. Et puis sa main gauche est tombée le long du corps, le paquet de tabac a roulé par terre. J'ai appelé le voisin. On l'a couché… Et puis voilà… Il n'a plus dit un mot à partir de ce moment-là.
Grand-mère montrait même la feuille de papier à cigarette.
Ils sont venus par centaines, par milliers, je crois pour accompagner Grand-père aux Terres Rouges. Tous ceux que, au cours de cinquante ans de sacerdoce culinaire, il avait “ mariés ”. Autant dire toute la région, dans un rayon de vingt kilomètres. L'église, pourtant grande, ne pouvait pas contenir toute l'assistance. J'entendais, comme dans un rêve, les chants funèbres du prêtre : “ De profondis clamavit at te, Domine ”… Et l'harmonium de la Biennassée, qui avait retrouvé tout son souffle, faisait retentir sa plainte triste, pour la première fois depuis des mois, sous les voûtes de l'église.
— Ça va faire un boucan du diable, avait dit Grand-père trois jours plus tôt.
Tout cela était irréel, et pendant toute la durée du service je n'ai cessé de fixer le noir catafalque. Ce n'était pas possible. Grand-père devait encore jouer une farce. Il allait soulever le couvercle du cercueil, s'asseoir, bouger, parler. Je sais, c'est grotesque. Mais allez donc prétendre que vous n'avez pas, vous aussi, vécu, dans les mêmes circonstances les mêmes espoirs insensés. Non, l'office s'est déroulé inexorable, et aux derniers accords de l'harmonium il a fallu se lever, suivre le cercueil, porté par six anciens combattants de la Guerre 14-18.
Nous sommes sortis. La douce lumière de septembre nous a fait cligner des yeux. On a hissé le cercueil dans le corbillard, les hommes ont poussé un “ han ” puissant, incongru. Incongru aussi, ce soleil. Déchirant, le raclement du cercueil qu'on pousse dans le corbillard. Grossières, ces paroles entendues, tout près, dans mon dos :
— J'en mangerons pus, d'la bounne galette !
Elles avaient été prononcées très haut, et j'avais reconnu la voix, celle de ce grand gueulard de Jérôme Raclan. Je me souviens avoir été sur le moment péniblement choqué par l'exclamation déplacée. Je me suis retourné, j'ai foudroyé du regard cet homme qui, à ce moment, pensait à son estomac.
Je me demande aujourd'hui si ce n'était pas l'oraison funèbre que Grand-père eût précisément aimé entendre.
Le corbillard, traîné par un cheval, s'est ébranlé. Tout cela continuait pour moi à être irréel, comme si je vivais en rêve une scène qui ne me concernait pas vraiment, comme si c'était “ pour de rire ” comme nous disions dans nos jeux d'enfants. Mon attention se fixait uniquement sur des détails qu'en d'autres circonstances je n'aurais pas perçus : le crissement des roues cerclées de fer sur la route, les “ plof-plof ” bien tranquilles du cheval, la couleur des volets de la maison Picarnon…
Le cortège montait lentement vers les Terres Rouges. Derrière, très loin, un bruissement de voix commençait à s'élever : les gens devaient parler de leur récolte qui venait de se terminer, des regains, “ le r'vive ” qu'on commençait à faucher… Puis nous sommes passés devant la maison de Grand-père, devant la chambre à four où il cuisait sa pâtisserie, devant la cour où ma mère l'avait vu pleurer en 1914, à l'annonce de la déclaration de guerre. Et tout cela, qu'il avait animé cinquante années durant, le regarda passer pour la dernière fois sans le moindre frémissement.
La maison de mes grands-parents est aujourd'hui fermée. Fermée sur ses ombres.
J'entretiens les treilles chasselas que Douard avait plantées, et ainsi chaque année, aux dates que nous fixe la nature, je refais exactement les gestes qu'il accomplissait pour tailler le cep, le rajeunir et le modeler à volonté, pour rogner, soigner, et quand le généreux septembre revient, récolter les grappes blondes, bourdonnantes de guêpes. Moi vivant, le rite continuera, et la maison ne sera pas livrée aux barbares. On ne la bétonnera pas. On ne l'éventrera pas pour ouvrir dans ses murs des “ baies-larges-qui-laissent-mieux-entrer-la-lumière ”, on ne l'affublera pas de “ persiennes-métalliques qui-s'entretiennent-si-facilement ”. Elle reste fermée. Mais elle reste la maison de Grand-père.
L'un d'eux, le père Milet justement, qui avait à peu près l'âge de Grand-père, a murmuré : t'en fais pas, mon pour vieux, j'vas bentout de r'joindre…
Et Grand-mère racontait presque à chaque nouvelle visite les derniers moments de lucidité de Grand-père, comme si elle eût voulu arrêter le temps à cet instant précis :
— On était à table, on venait de finir de manger. Il semblait aller bien, même un peu mieux depuis quelques jours. Comme toujours après chaque repas, il s'apprêtait à faire sa cigarette. Il avait sorti son paquet de tabac, placé sa feuille de papier à cigarette entre ses lèvres. Et puis, il ne bougeait plus. Je lui ait dit : eh bien, tu ne fais donc pas ta cigarette ? Il m'a regardée ; il m'a souri un peu. Je vous assure qu'il a souri. Mais il ne m'a pas répondu. Et puis sa main gauche est tombée le long du corps, le paquet de tabac a roulé par terre. J'ai appelé le voisin. On l'a couché… Et puis voilà… Il n'a plus dit un mot à partir de ce moment-là.
Grand-mère montrait même la feuille de papier à cigarette.
Ils sont venus par centaines, par milliers, je crois pour accompagner Grand-père aux Terres Rouges. Tous ceux que, au cours de cinquante ans de sacerdoce culinaire, il avait “ mariés ”. Autant dire toute la région, dans un rayon de vingt kilomètres. L'église, pourtant grande, ne pouvait pas contenir toute l'assistance. J'entendais, comme dans un rêve, les chants funèbres du prêtre : “ De profondis clamavit at te, Domine ”… Et l'harmonium de la Biennassée, qui avait retrouvé tout son souffle, faisait retentir sa plainte triste, pour la première fois depuis des mois, sous les voûtes de l'église.
— Ça va faire un boucan du diable, avait dit Grand-père trois jours plus tôt.
Tout cela était irréel, et pendant toute la durée du service je n'ai cessé de fixer le noir catafalque. Ce n'était pas possible. Grand-père devait encore jouer une farce. Il allait soulever le couvercle du cercueil, s'asseoir, bouger, parler. Je sais, c'est grotesque. Mais allez donc prétendre que vous n'avez pas, vous aussi, vécu, dans les mêmes circonstances les mêmes espoirs insensés. Non, l'office s'est déroulé inexorable, et aux derniers accords de l'harmonium il a fallu se lever, suivre le cercueil, porté par six anciens combattants de la Guerre 14-18.
Nous sommes sortis. La douce lumière de septembre nous a fait cligner des yeux. On a hissé le cercueil dans le corbillard, les hommes ont poussé un “ han ” puissant, incongru. Incongru aussi, ce soleil. Déchirant, le raclement du cercueil qu'on pousse dans le corbillard. Grossières, ces paroles entendues, tout près, dans mon dos :
— J'en mangerons pus, d'la bounne galette !
Elles avaient été prononcées très haut, et j'avais reconnu la voix, celle de ce grand gueulard de Jérôme Raclan. Je me souviens avoir été sur le moment péniblement choqué par l'exclamation déplacée. Je me suis retourné, j'ai foudroyé du regard cet homme qui, à ce moment, pensait à son estomac.
Je me demande aujourd'hui si ce n'était pas l'oraison funèbre que Grand-père eût précisément aimé entendre.
Le corbillard, traîné par un cheval, s'est ébranlé. Tout cela continuait pour moi à être irréel, comme si je vivais en rêve une scène qui ne me concernait pas vraiment, comme si c'était “ pour de rire ” comme nous disions dans nos jeux d'enfants. Mon attention se fixait uniquement sur des détails qu'en d'autres circonstances je n'aurais pas perçus : le crissement des roues cerclées de fer sur la route, les “ plof-plof ” bien tranquilles du cheval, la couleur des volets de la maison Picarnon…
Le cortège montait lentement vers les Terres Rouges. Derrière, très loin, un bruissement de voix commençait à s'élever : les gens devaient parler de leur récolte qui venait de se terminer, des regains, “ le r'vive ” qu'on commençait à faucher… Puis nous sommes passés devant la maison de Grand-père, devant la chambre à four où il cuisait sa pâtisserie, devant la cour où ma mère l'avait vu pleurer en 1914, à l'annonce de la déclaration de guerre. Et tout cela, qu'il avait animé cinquante années durant, le regarda passer pour la dernière fois sans le moindre frémissement.
La maison de mes grands-parents est aujourd'hui fermée. Fermée sur ses ombres.
J'entretiens les treilles chasselas que Douard avait plantées, et ainsi chaque année, aux dates que nous fixe la nature, je refais exactement les gestes qu'il accomplissait pour tailler le cep, le rajeunir et le modeler à volonté, pour rogner, soigner, et quand le généreux septembre revient, récolter les grappes blondes, bourdonnantes de guêpes. Moi vivant, le rite continuera, et la maison ne sera pas livrée aux barbares. On ne la bétonnera pas. On ne l'éventrera pas pour ouvrir dans ses murs des “ baies-larges-qui-laissent-mieux-entrer-la-lumière ”, on ne l'affublera pas de “ persiennes-métalliques qui-s'entretiennent-si-facilement ”. Elle reste fermée. Mais elle reste la maison de Grand-père.
Sur le pas de leur porte, sous leur treille, la maison que mon frère et moi avons vendue.
Révolution chez les Tavard
Juillet 1955
Juillet est un mois de fête à Briez. Fête de la moisson, du labeur qui commence avant le lever du soleil et ne s'achève qu'au crépuscule. Fête de la peine et de la sueur, du corps brisé de fatigue, le soir. La fête de l'engrangement, enfin la fête d'un cycle qui finit, et qu'on avait inauguré près d'un an plus tôt, en octobre. D'octobre à juillet, on avait suivi avec inquiétude l'aventure chaque année recommencée du grain de blé : on avait attendu “ piquer ”, la petite lance verte qui, à l'automne, se fraie un passage dans les lourds sols bruns ; on avait tremblé aux gelées de février, quand jaunit le blé en herbe ; on avait épié, en mai, les premiers épis jaillissants de la feurre. “ Pas de mois de mai sans épie de blé ”, dit-on. Mais que de craintes encore avant de mettre à l'abri les lourdes gerbes ! Qu'il pleuve trop, et au mauvais moment, et “ la fleur se fait mal ”, les épis seront légers ; que des orages s'abattent sur la récolte au dernier moment, et tout est à nouveau compromis ; le blé “ verse ” et pourrit au sol…
Voilà pourquoi juillet est une fête. Celle qui marque la fin — ou presque — des tourments.
Dès les premiers jours du mois, quelque chose fourmillait dans nos membres. C'est pour quand ? Qui va commencer ? Et l'on surveillait, jour après jour, le passage du vert au jaune clair, puis au blond. Puis les épis, tous ensemble, se recourbent en crosse d'évêque au-dessus de leur hampe : ils inclinent la tête vers le sol, et attendent humblement le coup de faux. Dans l'air plane le chaud parfum du froment mur et de la paille sèche. Allons, c'est le moment ! Sors ta faux, demain tu commenceras, enfin, les premiers “ tours ”.
A cette époque, le remembrement défigurateur n'avait pas encore été effectué. Les champs étaient petits, enclos de haies, imbriqués les uns dans les autres. Aussi devions-nous, avant de faire donner la moissonneuse-lieuse, dégager un passage tout autour de la parcelle, à la faux. Nous appelions ce travail préparatoire “ les tours ”. Il prenait une bonne semaine, et nous travaillions dans les mêmes conditions que nos ancêtres cinquante ou cent ans plus tôt, et avec les mêmes outils.
Un matin, nous entendions, venu d'un point ou d'un autre du village : tap, tap, tap,… Cela sonnait, régulier comme le tic-tac de l'horloge :
— Tiens, voilà Ledin (ou Picarnon, ou Tavard) qui “ bat son dard ”. On va en faire autant, c'est le moment.
Mon père enfonçait alors en terre son enclumeau, s'asseyait à même le sol, jambes écartées, plaçait le fil de la faux sur la surface aplanie de la petite enclume, et de son marteau effilé aux deux extrémités, il battait à petits coups bien réguliers l'extrême bord de la lame. Il ne fallait pas frapper trop fort, ni au mauvais endroit, sinon la faux “ s'allongeait ”, ou se tordait, et devenait inutilisable. Cela demandait plus de deux heures.
Le travail terminé, mon père se relevait, portait la main à son dos :
— Aïe ! c'est complètement rouillé là-dedans !
Puis il adaptait à la faux le râteau que nous utilisions spécialement pour les tours, cinq grands doigts de bois, effilés et légèrement recourbés.
Nous partions le lendemain matin, de très bonne heure : le travail est moins pénible dans la fraîcheur matinale, et la faux mord mieux sur les tiges humides.
Juillet 1955
Juillet est un mois de fête à Briez. Fête de la moisson, du labeur qui commence avant le lever du soleil et ne s'achève qu'au crépuscule. Fête de la peine et de la sueur, du corps brisé de fatigue, le soir. La fête de l'engrangement, enfin la fête d'un cycle qui finit, et qu'on avait inauguré près d'un an plus tôt, en octobre. D'octobre à juillet, on avait suivi avec inquiétude l'aventure chaque année recommencée du grain de blé : on avait attendu “ piquer ”, la petite lance verte qui, à l'automne, se fraie un passage dans les lourds sols bruns ; on avait tremblé aux gelées de février, quand jaunit le blé en herbe ; on avait épié, en mai, les premiers épis jaillissants de la feurre. “ Pas de mois de mai sans épie de blé ”, dit-on. Mais que de craintes encore avant de mettre à l'abri les lourdes gerbes ! Qu'il pleuve trop, et au mauvais moment, et “ la fleur se fait mal ”, les épis seront légers ; que des orages s'abattent sur la récolte au dernier moment, et tout est à nouveau compromis ; le blé “ verse ” et pourrit au sol…
Voilà pourquoi juillet est une fête. Celle qui marque la fin — ou presque — des tourments.
Dès les premiers jours du mois, quelque chose fourmillait dans nos membres. C'est pour quand ? Qui va commencer ? Et l'on surveillait, jour après jour, le passage du vert au jaune clair, puis au blond. Puis les épis, tous ensemble, se recourbent en crosse d'évêque au-dessus de leur hampe : ils inclinent la tête vers le sol, et attendent humblement le coup de faux. Dans l'air plane le chaud parfum du froment mur et de la paille sèche. Allons, c'est le moment ! Sors ta faux, demain tu commenceras, enfin, les premiers “ tours ”.
A cette époque, le remembrement défigurateur n'avait pas encore été effectué. Les champs étaient petits, enclos de haies, imbriqués les uns dans les autres. Aussi devions-nous, avant de faire donner la moissonneuse-lieuse, dégager un passage tout autour de la parcelle, à la faux. Nous appelions ce travail préparatoire “ les tours ”. Il prenait une bonne semaine, et nous travaillions dans les mêmes conditions que nos ancêtres cinquante ou cent ans plus tôt, et avec les mêmes outils.
Un matin, nous entendions, venu d'un point ou d'un autre du village : tap, tap, tap,… Cela sonnait, régulier comme le tic-tac de l'horloge :
— Tiens, voilà Ledin (ou Picarnon, ou Tavard) qui “ bat son dard ”. On va en faire autant, c'est le moment.
Mon père enfonçait alors en terre son enclumeau, s'asseyait à même le sol, jambes écartées, plaçait le fil de la faux sur la surface aplanie de la petite enclume, et de son marteau effilé aux deux extrémités, il battait à petits coups bien réguliers l'extrême bord de la lame. Il ne fallait pas frapper trop fort, ni au mauvais endroit, sinon la faux “ s'allongeait ”, ou se tordait, et devenait inutilisable. Cela demandait plus de deux heures.
Le travail terminé, mon père se relevait, portait la main à son dos :
— Aïe ! c'est complètement rouillé là-dedans !
Puis il adaptait à la faux le râteau que nous utilisions spécialement pour les tours, cinq grands doigts de bois, effilés et légèrement recourbés.
Nous partions le lendemain matin, de très bonne heure : le travail est moins pénible dans la fraîcheur matinale, et la faux mord mieux sur les tiges humides.
Eugène jeune homme.
Moment émouvant que ce premier jour des moissons. J'avais l'impression de servir une sorte de première messe, qui préparait, je le savais, des semaines et des semaines d'intense dépense physique, des jours de totale fatigue, mais tout cela, ce premier jour recueilli des tours, ces semaines d'efforts dans la chaleur qui suffoque et la poussière, oui, tout cela, nous le savions, c'était notre lot, notre récompense aussi, et nous l'acceptions tranquillement, comme le mineur qui descend au fond du puits. Mon père disait au reste souvent :
— Non, il n'y a pas de travail plus pénible que celui du paysan. Sauf peut-être celui du mineur.
Nous partions d'ordinaire à trois pour les tours : le faucheur, celui qui préparait les liens — un enfant, ou une femme —, et celui qui faisait les javelles et liait les gerbes. Nous emportions deux litres de cidre bien frais, tiré au tonneau, et, dans le cadrain, du fromage blanc, de la crème, des cornichons, avec un gros pain de quatre livres.
Arrivés au champ, nous placions tout cela au cœur le plus ombreux de la haie. C'est que, à cette heure, l'air était frais, presque froid ; mais à dix heures, il serait transformé en fournaise.
Mon père fauchait. Il avait accroché à la ceinture le coffin — nous disions le “ coui ” — plein d'eau, dans laquelle trempait la pierre à aiguiser. Il dressait la faux devant lui, sortait la pierre, “ et fric et frac, et fric et frac ”, il torchait une dernière fois la lame, à coups de pierre rapides, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Il faisait si vite que je me demandais toujours comment il pouvait ne pas se couper. Un dernier long coup de pierre à l'intérieur : “ friic ” ! Deux petits coups de pouce pour vérifier le fil : la faux coupait comme un rasoir. Mon père disait, c'était rituel :
— Est-ce qu'il y en a un qui veut être rasé ?
On riait une bonne fois, la dernière de la matinée. Puis il se cassait en deux, le haut du corps jeté en avant, les jambes bien écartées. Un coup de faux, très ample : “ friss ” faisait la lame passant comme au travers des feurres. Les tiges ramassées par le râteau venaient se poser bien gentiment, un peu en oblique, contre celles qu'avait épargnées la faux. Mais déjà mon père avait avancé d'un petit pas et donnait son second coup : “ friss ” ! Un pas en avant : “ friss ” ! L'homme avançait maintenant, réglé comme une mécanique, sans se presser, un coup de faux, un pas en avant, un coup de faux, un pas en avant. Corps immobile, figé en équerre, seuls les bras et les jambes se balancent et se déplacent en rythme. Il va faucher ainsi, pendant une heure peut-être, sans se presser, sans se relever. La mécanique paraît infatigable. Elle est efficace, et le chemin qu'elle trace au bord de la haie s'allonge. Allons, derrière, ce n'est pas le moment de finir la nuit !
Aristide Tavard était lui aussi un bon faucheur, malgré sa petite taille. Cette année-là, il avait commencé sa moisson aux Champs-Guillarmes, sa plus grande parcelle. Il avançait pas à pas, mécanisme bien réglé, au milieu des hautes hampes qui le dépassaient. Cent mètres, deux cents mètres… Derrière lui, il n'entendait plus Angéline qui, d'une poignée de feurre tressait les liens et les disposait de vingt mètres en vingt mètres, ni le grand Raymond qui, à reculons, ramassait les lourdes tiges, les réunissait en javelles qu'il déposait sur les liens (nous disions les “ yasses ”), et les ceinturait ensemble, en une gerbe plus grosse qu'Angéline, et plus lourde qu'Aristide. Et puis Raymond prenait la gerbe par la taille, comme une fille à culbuter, et il la plantait debout, tout contre la haie, pour qu'elle ne gêne pas le passage des chevaux. Il devait les avoir sérieusement distancés…
Il commence à faire chaud, Aristide… Tu pourrais peut-être te relever ? Souffler un peu ? La sueur inonde ton visage, et le cidre est frais, dans la bouteille, là-bas, derrière toi, au creux de la haie… Non, un quart d'heure encore. Après, je m'arrêterai. Je soufflerai un peu…
Il se sentait gaillard, Aristide, et tout heureux d'avoir commencé, une fois encore la moisson. “ Friiss ”, faisait la faux, régulièrement. Ça va, Aristide, continue comme ça. T'as trouvé la cadence. Bien large, ton coup de dard, hein ? Deux mètres au moins. C'est qu'il faut faire la place pour trois chevaux de front. Du beau travail, Aristide, tu fais… y a pas à dire… même un jeune gars ne ferait pas mieux. Même pas le Raymond, qu'est pourtant bien plus costaud que toi. L'Raymond… Qu'est-ce qu'il lui arrive donc, en ce moment ? Quelque chose ne va pas, depuis quelque temps, à la maison. Il ne sait pas quoi, Aristide. Il ne pourrait pas dire, non. Il ne comprend pas, et il évite de chercher, mais il sent bien que l'orage monte. C'est ce silence, à table. Ils sont là, tous les trois, trois fois par jour, assis autour de la table. Les repas se prennent dans un silence lourd, étouffant. On entend seulement les cuillères, ou les fourchettes, tinter dans l'assiette, le lapement du grand Raymond. Pas un mot. Que c'est lourd ! Ou alors, si Raymond desserre les dents, c'est pour demander :
— M'man, passé moué l'pain ! Ou le sel. C'est tout. Jamais il ne le demanderait au père, qui n'attend pourtant qu'un geste, qu'un mot pour démontrer sa bonne volonté…
Alors, Aristide s'est recroquevillé sur lui-même. Il essaie de faire le moins de bruit possible en mangeant. De se faire tout petit. S'il pouvait s'aplatir contre le mur… Ou passer sous la table, comme le chien… Il ne demande jamais rien. S'il a besoin du pain, du sel ou du cidre, il attend que ça arrive à portée de la main, ou alors il se lève, et va le chercher au bout de la table.
Mais il sent bien que plus il tente de se faire oublier, et plus l'air s'épaissit autour de lui. Il prend vite son repas, dix minutes, pas plus, puis il referme son couteau et s'éclipse, il va “ voir les bêtes ” et laisse en tête à tête sa femme et son fils. Le voilà comme de trop. Depuis quelques jours, il a même surpris, en levant le nez de sur son assiette, des regards entre les deux autres… Celui d'Angéline lui semble dur. Elle est fermée. Au lit aussi d'ailleurs… Vrai, on dirait qu'elle ne peut plus me supporter… Qu'est-ce que je lui ai donc fait ? Raymond, lui, a un mauvais sourire au coin des lèvres, et son œil est comme moqueur. Ça lui fait mal, à Aristide, tout ça…
Mais voilà, aujourd'hui, il veut oublier tout. Ça va peut-être s'arranger… Aujourd'hui, Aristide montre sa valeur aux deux autres. Il est maître dans le maniement du fauchon, ça, même Raymond ne peut pas le lui enlever. Et puis, n'est-il pas, malgré tout, le chef de famille, puisqu'aujourd'hui il va en tête, il dégage le chemin pour que les autres passent, et les autres le suivent.
“ Friiss ” fait la faux, avec plus d'assurance encore. Et les tiges bien droites soudain vacillent, frappées à mort par le tranchant acéré de la lame. Mais elles sont pleines de sagesse résignée : leur heure n'a-t-elle pas sonné, ne sont-elles pas bien mûres, avec leur lourd épi qui déjà courbe la tête, comme s'il s'apprêtait au sacrifice ? Alors elles se laissent sagement emporter par le râteau, qui les dépose tout doucement, en bout de course, à gauche. Elles attendent là, un peu inclinées. Elles attendent que Raymond vienne les ramasser et les mettre en gerbe.
Oui, il se sent bien aujourd'hui, Aristide. Il a retrouvé le rythme exact, le balancement qui échauffe les muscles et ne fatigue plus. Il lui semble qu'il pourrait continuer ainsi jusqu'au soir.
— P'pa, va pas si vite ! C'est pas la peine. Té voué ben qu'la mère peut pus t'suivre !
Le grand Raymond lui a crié cela, de loin. Oh qu'il n'aime pas ce ton, Aristide ! Ce ton hargneux, provoquant.
Aristide a arrêté le mouvement mécanique. Il s'est redressé — oh, un peu, parce que là, maintenant, on sent les reins —, il s'est épongé le front du revers de la main, et s'est retourné vers les deux autres. C'est vrai qu'ils sont loin. Mais que dire ? Il n'a rien trouvé à répondre, Aristide. Est-ce qu'il commencerait à les craindre ? Il a marmonné, à ce qui lui semble, qu'il n'avait pas l'impression d'aller trop vite. Que cela ne faisait rien, si Angéline perdait du terrain. Que de toutes façons, tout à l'heure, il pourrait “ l'agider ”, lui donner un coup de main. Mais non, cent fois non, il ne se souvient pas avoir eu un haussement d'épaule !
— Qu'est-ce que tu dis ? Que tu t'en fous ? Ah j'vas t'montrer ça, moué, si tu t'en fous ! J'vas t'montrer à “ enfler de l'épaule ” !
Mais qu'est-ce qui lui prend, au grand Raymond ? Voilà que, d'un geste violent, il vient de lancer sa gerbe dans la haie. Voilà qu'il retrousse les manches de sa chemise. Angéline aussi s'est redressée. Elle regarde passer son fils, les mains sur les hanches. Elle ne lui a pas dit un mot, mais Aristide a eu l'impression, l'espace d'un éclair, qu'au moment où Raymond arrivait à sa hauteur, elle avait eu un regard d'encouragement. Il lui a même semblé qu'elle hochait la tête, comme pour lui dire : vas-y !
Aristide voyait Raymond fondre sur lui, et il restait là, paralysé, tenant encore la faux de la main gauche. Il ne pouvait pas croire. Après, il ne se souvient plus bien de ce qui s'est passé. Si, il se souvient que Raymond lui a arraché le fauchon des mains, violemment. Et puis il l'a bousculé, il l'a renversé, il a posé son gros derrière sur sa poitrine, et il s'est mis à lui marteler le visage, calmement, méthodiquement, sans proférer une parole. Aristide s'est mis à hurler. On a même entendu ses cris depuis le village. Il hurlait comme une bête. Des voisins, qui travaillaient pas loin ont raconté, le soir, qu'Aristide appelait : Au secours ! Au secours ! Y vont m'tuer ! Puis des gémissements, comme si on l'étouffait. Et puis le silence est retombé sur les champs bien blonds de l'été.
Juillet est un mois de fête à Briez. Mais ce jour-là, la fête s'est terminée tôt pour les trois Tavard. Nous les avons vus rentrer au village, en pleine journée, Angéline en tête, qui criait que tout ça était bien fait, qu'il l'avait bien cherché, que “ cela ” ne pouvait plus durer. Raymond suivait, sans rien dire, l'air plutôt dégagé. Et Aristide, cent mètres derrière, traînait, la tête basse. Ils sont rentrés tous les trois à la maison, et on ne les a plus revus de la journée.
Tout le village, ou peu s'en faut, a entendu la scène. Plusieurs moissonneurs auraient pu porter très vite secours à Aristide. Aucun ne s'est dérangé : à Briez, on était habitué à ces prises de pouvoir dans la violence ; plusieurs familles après tout étaient déjà passées par là. Non, on a laissé les Tavard régler leurs comptes, et cela valait peut-être mieux ainsi, car, à partir de ce jour, un nouvel équilibre s'est réalisé entre eux. Aristide est devenu muet et soumis. Jamais la moindre allusion à ce qui s'était passé. Apparemment, il a obtenu à ce prix le pardon et la paix. Raymond a pris le commandement de la tribu, et a entrepris, avec sa mère, la modernisation de la ferme. Il s'est lancé dans les emprunts, il a acheté des engrais, et puis le tracteur.
C'est comme ça que la tribu Tavard a commencé, avec son nouveau chef, une ascension qui devait la mener très haut.
— Non, il n'y a pas de travail plus pénible que celui du paysan. Sauf peut-être celui du mineur.
Nous partions d'ordinaire à trois pour les tours : le faucheur, celui qui préparait les liens — un enfant, ou une femme —, et celui qui faisait les javelles et liait les gerbes. Nous emportions deux litres de cidre bien frais, tiré au tonneau, et, dans le cadrain, du fromage blanc, de la crème, des cornichons, avec un gros pain de quatre livres.
Arrivés au champ, nous placions tout cela au cœur le plus ombreux de la haie. C'est que, à cette heure, l'air était frais, presque froid ; mais à dix heures, il serait transformé en fournaise.
Mon père fauchait. Il avait accroché à la ceinture le coffin — nous disions le “ coui ” — plein d'eau, dans laquelle trempait la pierre à aiguiser. Il dressait la faux devant lui, sortait la pierre, “ et fric et frac, et fric et frac ”, il torchait une dernière fois la lame, à coups de pierre rapides, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Il faisait si vite que je me demandais toujours comment il pouvait ne pas se couper. Un dernier long coup de pierre à l'intérieur : “ friic ” ! Deux petits coups de pouce pour vérifier le fil : la faux coupait comme un rasoir. Mon père disait, c'était rituel :
— Est-ce qu'il y en a un qui veut être rasé ?
On riait une bonne fois, la dernière de la matinée. Puis il se cassait en deux, le haut du corps jeté en avant, les jambes bien écartées. Un coup de faux, très ample : “ friss ” faisait la lame passant comme au travers des feurres. Les tiges ramassées par le râteau venaient se poser bien gentiment, un peu en oblique, contre celles qu'avait épargnées la faux. Mais déjà mon père avait avancé d'un petit pas et donnait son second coup : “ friss ” ! Un pas en avant : “ friss ” ! L'homme avançait maintenant, réglé comme une mécanique, sans se presser, un coup de faux, un pas en avant, un coup de faux, un pas en avant. Corps immobile, figé en équerre, seuls les bras et les jambes se balancent et se déplacent en rythme. Il va faucher ainsi, pendant une heure peut-être, sans se presser, sans se relever. La mécanique paraît infatigable. Elle est efficace, et le chemin qu'elle trace au bord de la haie s'allonge. Allons, derrière, ce n'est pas le moment de finir la nuit !
Aristide Tavard était lui aussi un bon faucheur, malgré sa petite taille. Cette année-là, il avait commencé sa moisson aux Champs-Guillarmes, sa plus grande parcelle. Il avançait pas à pas, mécanisme bien réglé, au milieu des hautes hampes qui le dépassaient. Cent mètres, deux cents mètres… Derrière lui, il n'entendait plus Angéline qui, d'une poignée de feurre tressait les liens et les disposait de vingt mètres en vingt mètres, ni le grand Raymond qui, à reculons, ramassait les lourdes tiges, les réunissait en javelles qu'il déposait sur les liens (nous disions les “ yasses ”), et les ceinturait ensemble, en une gerbe plus grosse qu'Angéline, et plus lourde qu'Aristide. Et puis Raymond prenait la gerbe par la taille, comme une fille à culbuter, et il la plantait debout, tout contre la haie, pour qu'elle ne gêne pas le passage des chevaux. Il devait les avoir sérieusement distancés…
Il commence à faire chaud, Aristide… Tu pourrais peut-être te relever ? Souffler un peu ? La sueur inonde ton visage, et le cidre est frais, dans la bouteille, là-bas, derrière toi, au creux de la haie… Non, un quart d'heure encore. Après, je m'arrêterai. Je soufflerai un peu…
Il se sentait gaillard, Aristide, et tout heureux d'avoir commencé, une fois encore la moisson. “ Friiss ”, faisait la faux, régulièrement. Ça va, Aristide, continue comme ça. T'as trouvé la cadence. Bien large, ton coup de dard, hein ? Deux mètres au moins. C'est qu'il faut faire la place pour trois chevaux de front. Du beau travail, Aristide, tu fais… y a pas à dire… même un jeune gars ne ferait pas mieux. Même pas le Raymond, qu'est pourtant bien plus costaud que toi. L'Raymond… Qu'est-ce qu'il lui arrive donc, en ce moment ? Quelque chose ne va pas, depuis quelque temps, à la maison. Il ne sait pas quoi, Aristide. Il ne pourrait pas dire, non. Il ne comprend pas, et il évite de chercher, mais il sent bien que l'orage monte. C'est ce silence, à table. Ils sont là, tous les trois, trois fois par jour, assis autour de la table. Les repas se prennent dans un silence lourd, étouffant. On entend seulement les cuillères, ou les fourchettes, tinter dans l'assiette, le lapement du grand Raymond. Pas un mot. Que c'est lourd ! Ou alors, si Raymond desserre les dents, c'est pour demander :
— M'man, passé moué l'pain ! Ou le sel. C'est tout. Jamais il ne le demanderait au père, qui n'attend pourtant qu'un geste, qu'un mot pour démontrer sa bonne volonté…
Alors, Aristide s'est recroquevillé sur lui-même. Il essaie de faire le moins de bruit possible en mangeant. De se faire tout petit. S'il pouvait s'aplatir contre le mur… Ou passer sous la table, comme le chien… Il ne demande jamais rien. S'il a besoin du pain, du sel ou du cidre, il attend que ça arrive à portée de la main, ou alors il se lève, et va le chercher au bout de la table.
Mais il sent bien que plus il tente de se faire oublier, et plus l'air s'épaissit autour de lui. Il prend vite son repas, dix minutes, pas plus, puis il referme son couteau et s'éclipse, il va “ voir les bêtes ” et laisse en tête à tête sa femme et son fils. Le voilà comme de trop. Depuis quelques jours, il a même surpris, en levant le nez de sur son assiette, des regards entre les deux autres… Celui d'Angéline lui semble dur. Elle est fermée. Au lit aussi d'ailleurs… Vrai, on dirait qu'elle ne peut plus me supporter… Qu'est-ce que je lui ai donc fait ? Raymond, lui, a un mauvais sourire au coin des lèvres, et son œil est comme moqueur. Ça lui fait mal, à Aristide, tout ça…
Mais voilà, aujourd'hui, il veut oublier tout. Ça va peut-être s'arranger… Aujourd'hui, Aristide montre sa valeur aux deux autres. Il est maître dans le maniement du fauchon, ça, même Raymond ne peut pas le lui enlever. Et puis, n'est-il pas, malgré tout, le chef de famille, puisqu'aujourd'hui il va en tête, il dégage le chemin pour que les autres passent, et les autres le suivent.
“ Friiss ” fait la faux, avec plus d'assurance encore. Et les tiges bien droites soudain vacillent, frappées à mort par le tranchant acéré de la lame. Mais elles sont pleines de sagesse résignée : leur heure n'a-t-elle pas sonné, ne sont-elles pas bien mûres, avec leur lourd épi qui déjà courbe la tête, comme s'il s'apprêtait au sacrifice ? Alors elles se laissent sagement emporter par le râteau, qui les dépose tout doucement, en bout de course, à gauche. Elles attendent là, un peu inclinées. Elles attendent que Raymond vienne les ramasser et les mettre en gerbe.
Oui, il se sent bien aujourd'hui, Aristide. Il a retrouvé le rythme exact, le balancement qui échauffe les muscles et ne fatigue plus. Il lui semble qu'il pourrait continuer ainsi jusqu'au soir.
— P'pa, va pas si vite ! C'est pas la peine. Té voué ben qu'la mère peut pus t'suivre !
Le grand Raymond lui a crié cela, de loin. Oh qu'il n'aime pas ce ton, Aristide ! Ce ton hargneux, provoquant.
Aristide a arrêté le mouvement mécanique. Il s'est redressé — oh, un peu, parce que là, maintenant, on sent les reins —, il s'est épongé le front du revers de la main, et s'est retourné vers les deux autres. C'est vrai qu'ils sont loin. Mais que dire ? Il n'a rien trouvé à répondre, Aristide. Est-ce qu'il commencerait à les craindre ? Il a marmonné, à ce qui lui semble, qu'il n'avait pas l'impression d'aller trop vite. Que cela ne faisait rien, si Angéline perdait du terrain. Que de toutes façons, tout à l'heure, il pourrait “ l'agider ”, lui donner un coup de main. Mais non, cent fois non, il ne se souvient pas avoir eu un haussement d'épaule !
— Qu'est-ce que tu dis ? Que tu t'en fous ? Ah j'vas t'montrer ça, moué, si tu t'en fous ! J'vas t'montrer à “ enfler de l'épaule ” !
Mais qu'est-ce qui lui prend, au grand Raymond ? Voilà que, d'un geste violent, il vient de lancer sa gerbe dans la haie. Voilà qu'il retrousse les manches de sa chemise. Angéline aussi s'est redressée. Elle regarde passer son fils, les mains sur les hanches. Elle ne lui a pas dit un mot, mais Aristide a eu l'impression, l'espace d'un éclair, qu'au moment où Raymond arrivait à sa hauteur, elle avait eu un regard d'encouragement. Il lui a même semblé qu'elle hochait la tête, comme pour lui dire : vas-y !
Aristide voyait Raymond fondre sur lui, et il restait là, paralysé, tenant encore la faux de la main gauche. Il ne pouvait pas croire. Après, il ne se souvient plus bien de ce qui s'est passé. Si, il se souvient que Raymond lui a arraché le fauchon des mains, violemment. Et puis il l'a bousculé, il l'a renversé, il a posé son gros derrière sur sa poitrine, et il s'est mis à lui marteler le visage, calmement, méthodiquement, sans proférer une parole. Aristide s'est mis à hurler. On a même entendu ses cris depuis le village. Il hurlait comme une bête. Des voisins, qui travaillaient pas loin ont raconté, le soir, qu'Aristide appelait : Au secours ! Au secours ! Y vont m'tuer ! Puis des gémissements, comme si on l'étouffait. Et puis le silence est retombé sur les champs bien blonds de l'été.
Juillet est un mois de fête à Briez. Mais ce jour-là, la fête s'est terminée tôt pour les trois Tavard. Nous les avons vus rentrer au village, en pleine journée, Angéline en tête, qui criait que tout ça était bien fait, qu'il l'avait bien cherché, que “ cela ” ne pouvait plus durer. Raymond suivait, sans rien dire, l'air plutôt dégagé. Et Aristide, cent mètres derrière, traînait, la tête basse. Ils sont rentrés tous les trois à la maison, et on ne les a plus revus de la journée.
Tout le village, ou peu s'en faut, a entendu la scène. Plusieurs moissonneurs auraient pu porter très vite secours à Aristide. Aucun ne s'est dérangé : à Briez, on était habitué à ces prises de pouvoir dans la violence ; plusieurs familles après tout étaient déjà passées par là. Non, on a laissé les Tavard régler leurs comptes, et cela valait peut-être mieux ainsi, car, à partir de ce jour, un nouvel équilibre s'est réalisé entre eux. Aristide est devenu muet et soumis. Jamais la moindre allusion à ce qui s'était passé. Apparemment, il a obtenu à ce prix le pardon et la paix. Raymond a pris le commandement de la tribu, et a entrepris, avec sa mère, la modernisation de la ferme. Il s'est lancé dans les emprunts, il a acheté des engrais, et puis le tracteur.
C'est comme ça que la tribu Tavard a commencé, avec son nouveau chef, une ascension qui devait la mener très haut.
Eugène soldat.
Novembre 1965.
Le pari de Louis Lavelotte.
— Toué, Louis, tu s'ras aux gerbes, comme d'habitude.
— Bon, patron…
Le battage des récoltes commençait dès la fin du mois d'août. Les moissons à peine terminées, nous entendions le roulement sourd du lourd convoi qui prenait la route : machine à vapeur, batteuse et presse ; le long périple de ferme en ferme se poursuivait jusqu'à la fin de l'hiver, à travers quatre ou cinq cantons. L'un des bruits les plus caractéristiques de l'automne était celui du battage, ronflement monotone qui parvenait de très loin et semblait comme porté dans l'air alourdi par les brouillards de l'arrière-saison, mêlé à l'odeur un peu âcre des fanes de pommes de terre séchées que l'on brûle.
— Tiens, le v'la sur Couloutre ! Tiens, le v'la sur Donzy ! Puis sur Perroy. Il se rapproche ! Notre tour arrive.
Le battage, comme la moisson, était une fête, la récompense d'une année de travail, d'incertitudes et d'angoisses. La moisson blonde, qui avait traversé les rigueurs de l'hiver, les aléas du printemps, les orages de l'été, qui reposait depuis juillet sous les hangars et les “ tisses ” (et si, au dernier moment, l'incendie la détruisait ?), la moisson blonde allait enfin passer dans la batteuse, et livrer ses boisseaux de grains dorés.
Les femmes s'affairaient plusieurs jours à l'avance. On sacrifiait par dizaines poules, canards, lapins. Cela sentait déjà la viande qui rissole, le bouillon gras et le civet qui mijote. Quelque chose d'extraordinaire, pendant quelques jours, allait se passer. La routine quotidienne serait bouleversée. Trois jours durant, la ferme, en temps normal si calme, allait être transformée en un gigantesque rucher bourdonnant. Ces préparatifs me plongeaient dans un état de grande excitation.
Et puis, un soir, à la tombée de la nuit, mon père et les deux commis partaient avec les quatre chevaux harnachés. C'était au fermier qui recevait le battage de l'acheminer jusque chez lui, et de l'installer. J'attendais, le cœur battant, l'arrivée du convoi. Je me postais à deux cents mètres de chez nous, dans un tournant, pour le voir arriver de plus loin, et ma mère quittait de temps à autres ses immenses chaudrons pour venir sur le pas de la porte, et tendre une oreille inquiète : un accident pouvait vite arriver avec des chevaux peu habitués à tirer des engins aussi lourds et peu maniables. Enfin, nous percevions, venu de très loin, le grondement que nous attendions : ils arrivent ! Le crissement des roues sur les cailloux grandissait, je percevais maintenant le martèlement régulier des sabots des chevaux. Quelques minutes d'attente encore, et là-haut, à l'entrée du village, débouchait en cahotant la grosse locomobile noire, que deux chevaux tiraient avec peine. La “ machine ”, comme nous l'appelions, m'impressionnait beaucoup. Je la trouvais gigantesque, elle m'effrayait lorsqu'elle était en action, qu'elle crachait ses jets de vapeur et tremblait de tous ses membres. C'était une énorme bête qui suait, soufflait et trépidait, un monstre tout droit sorti de la mythologie, Vulcain et Jupiter associés.
Je l'ai revue depuis. Le tracteur et la moissonneuse-batteuse ont renversé la divinité. On l'a remisée, voici plus de vingt ans, sous un hangar. Elle est couverte de poussière, un peu rouillée. Je l'ai trouvée toute petite. Elle m'a fait de la peine.
La batteuse proprement dite la suivait, elle aussi énorme, mais plus débonnaire. La presse à botteler fermait le convoi, long au total de plus de vingt mètres. Il fallait de rudes charretiers pour acheminer tout ce matériel, et pas n'importe quels chevaux ! On installait la batteuse dans la cour, on calait avec soi les trois engins, souvent en pleine nuit, à la lumière des lampes à pétrole.
Je dormais mal, dans ces nuits qui précédaient le grand jour du début du battage, et, tôt le matin, je tendais l'oreille aux bruits du dehors. Entre chien et loup, bien avant le lever du soleil, arrivait le mécanicien, propriétaire de la batteuse. Il se chargeait lui-même de la préparation de la machine, et de son entretien, tout au long de la journée. Le premier levé, il était aussi, le soir, le dernier à partir. Avant l'aube il allumait le feu dans le foyer de la locomobile, et surveillait la montée de la pression.
Le pari de Louis Lavelotte.
— Toué, Louis, tu s'ras aux gerbes, comme d'habitude.
— Bon, patron…
Le battage des récoltes commençait dès la fin du mois d'août. Les moissons à peine terminées, nous entendions le roulement sourd du lourd convoi qui prenait la route : machine à vapeur, batteuse et presse ; le long périple de ferme en ferme se poursuivait jusqu'à la fin de l'hiver, à travers quatre ou cinq cantons. L'un des bruits les plus caractéristiques de l'automne était celui du battage, ronflement monotone qui parvenait de très loin et semblait comme porté dans l'air alourdi par les brouillards de l'arrière-saison, mêlé à l'odeur un peu âcre des fanes de pommes de terre séchées que l'on brûle.
— Tiens, le v'la sur Couloutre ! Tiens, le v'la sur Donzy ! Puis sur Perroy. Il se rapproche ! Notre tour arrive.
Le battage, comme la moisson, était une fête, la récompense d'une année de travail, d'incertitudes et d'angoisses. La moisson blonde, qui avait traversé les rigueurs de l'hiver, les aléas du printemps, les orages de l'été, qui reposait depuis juillet sous les hangars et les “ tisses ” (et si, au dernier moment, l'incendie la détruisait ?), la moisson blonde allait enfin passer dans la batteuse, et livrer ses boisseaux de grains dorés.
Les femmes s'affairaient plusieurs jours à l'avance. On sacrifiait par dizaines poules, canards, lapins. Cela sentait déjà la viande qui rissole, le bouillon gras et le civet qui mijote. Quelque chose d'extraordinaire, pendant quelques jours, allait se passer. La routine quotidienne serait bouleversée. Trois jours durant, la ferme, en temps normal si calme, allait être transformée en un gigantesque rucher bourdonnant. Ces préparatifs me plongeaient dans un état de grande excitation.
Et puis, un soir, à la tombée de la nuit, mon père et les deux commis partaient avec les quatre chevaux harnachés. C'était au fermier qui recevait le battage de l'acheminer jusque chez lui, et de l'installer. J'attendais, le cœur battant, l'arrivée du convoi. Je me postais à deux cents mètres de chez nous, dans un tournant, pour le voir arriver de plus loin, et ma mère quittait de temps à autres ses immenses chaudrons pour venir sur le pas de la porte, et tendre une oreille inquiète : un accident pouvait vite arriver avec des chevaux peu habitués à tirer des engins aussi lourds et peu maniables. Enfin, nous percevions, venu de très loin, le grondement que nous attendions : ils arrivent ! Le crissement des roues sur les cailloux grandissait, je percevais maintenant le martèlement régulier des sabots des chevaux. Quelques minutes d'attente encore, et là-haut, à l'entrée du village, débouchait en cahotant la grosse locomobile noire, que deux chevaux tiraient avec peine. La “ machine ”, comme nous l'appelions, m'impressionnait beaucoup. Je la trouvais gigantesque, elle m'effrayait lorsqu'elle était en action, qu'elle crachait ses jets de vapeur et tremblait de tous ses membres. C'était une énorme bête qui suait, soufflait et trépidait, un monstre tout droit sorti de la mythologie, Vulcain et Jupiter associés.
Je l'ai revue depuis. Le tracteur et la moissonneuse-batteuse ont renversé la divinité. On l'a remisée, voici plus de vingt ans, sous un hangar. Elle est couverte de poussière, un peu rouillée. Je l'ai trouvée toute petite. Elle m'a fait de la peine.
La batteuse proprement dite la suivait, elle aussi énorme, mais plus débonnaire. La presse à botteler fermait le convoi, long au total de plus de vingt mètres. Il fallait de rudes charretiers pour acheminer tout ce matériel, et pas n'importe quels chevaux ! On installait la batteuse dans la cour, on calait avec soi les trois engins, souvent en pleine nuit, à la lumière des lampes à pétrole.
Je dormais mal, dans ces nuits qui précédaient le grand jour du début du battage, et, tôt le matin, je tendais l'oreille aux bruits du dehors. Entre chien et loup, bien avant le lever du soleil, arrivait le mécanicien, propriétaire de la batteuse. Il se chargeait lui-même de la préparation de la machine, et de son entretien, tout au long de la journée. Le premier levé, il était aussi, le soir, le dernier à partir. Avant l'aube il allumait le feu dans le foyer de la locomobile, et surveillait la montée de la pression.
Moissons.
Une heure plus tard, à cinq heures en automne, six heures en hiver, arrivaient “ les hommes ”, une quinzaine, qui, trois jours durant, allaient se donner à fond pour servir la batteuse, les uns sous les hangars, “ aux gerbes ”, les autres à la presse, les derniers enfin, les plus costauds, “ au grain ”. Ils entraient d'abord dans la cuisine, et j'entendais de ma chambre le raclement pesant de leurs sabots ou de leurs souliers cloutés sur les tommettes. Ils avalaient en hâte la soupe au lait, le café noir, deux grandes “ parpilles ” de pain et une tranche de jambon fumé, ils lichaient ensuite une bonne rasade de goutte, se levaient lentement de table, en s'essuyant la bouche du revers de la manche, et se rendait au poste qui leur avait été donné. Et la fête commençait, pour moi au moins, sinon pour eux.
C'est tout à fait par hasard que le drame s'est produit chez les Picarnon. Il aurait pu survenir partout ailleurs car il était sans doute écrit quelque part dans le destin de Louis Lavelotte qu'un jour on le ferait aller trop loin, comme cela, sans méchanceté, simplement pour s'amuser.
Le premier jour du battage, le matin, au moment de poster ses batteux, Adolphe Picarnon lui avait dit :
— Toué, Louis, tu s'ras aux gerbes, comme d'habitude.
— Bon, patron, avait répondu Louis.
C'était une tâche bien adaptée à Lavelotte ; il s'agissait de faire la chaîne, avec deux ou trois autres hommes selon les cas, et de se passer les gerbes, à la fourche, jusqu'à la batteuse. C'était sans doute le poste le moins pénible.
Pourquoi a-t-il fallu qu'un batteux demande, l'air sérieux et sans sourire :
— Et pourquoi pas aux sacs ? C'est vrai, ça, père Picarnon, Lavelotte n'est jamais aux sacs !
— Euh, fait Adolphe Picarnon… euh, vous pensez pas que c'est trop dure pour lui ?
— Trop dur pour lui ? On l'dirait pas, comme ça, mais c'est qu'il est plus fort qu'il en a l'air ! Pas vrai, Lavelotte, que tu peux bien porter l'grain, comme un autre ?
Et d'autres batteux ont repris en chœur :
— C'est vrai ça, qu'il est costaud ! Ils se poussaient du coude, et rigolaient : hein, si on l'mettait aux sacs, on s'amuserait bien ! Tu penses, les sacs, ils sont au moins deux fois plus lourds que lui !
Les porteurs de grain étaient des gaillards considérés, des garçons jeunes, en pleine force, avec de gros biceps et des épaules de forts des Halles. Les sacs, pleins de blé, pesaient quatre-vingts kilos ; quatre-vingts kilos qu'on vous balançait sur le dos, et qu'il fallait porter, depuis la batteuse jusqu'au grenier, une centaine de mètres parfois, et toujours des escaliers ou une échelle à gravir. Chez les Picarnon, c'était un escalier de pierre, rude et long. Quatre tonnes chaque jour à porter, quatre tonnes qui pesaient sur la colonne vertébrale, dans les jambes. C'est pourquoi les porteurs de grain jouissaient d'un traitement de faveur : une bouteille de vin, et non de cidre comme pour les autres, les attendait au grenier. Le patron veillait personnellement à ce qu'elle soit renouvelée dès qu'elle était vide. Et le porteur de grain, après avoir déversé le contenu de son sac sur le tas de blé, ajouté au canif une entaille sur la baguette de noisetier qui permettrait, à la fin du battage, de savoir avec exactitude à combien de boisseaux s'élevait la récolte de l'année, vidait d'un trait son verre de vin et repartait à la batteuse chercher un nouveau sac de quatre-vingts kilos. Oui, quatre tonnes par jour et par homme, mais aussi trois à quatre litres de vin, pour le moins.
C'est tout à fait par hasard que le drame s'est produit chez les Picarnon. Il aurait pu survenir partout ailleurs car il était sans doute écrit quelque part dans le destin de Louis Lavelotte qu'un jour on le ferait aller trop loin, comme cela, sans méchanceté, simplement pour s'amuser.
Le premier jour du battage, le matin, au moment de poster ses batteux, Adolphe Picarnon lui avait dit :
— Toué, Louis, tu s'ras aux gerbes, comme d'habitude.
— Bon, patron, avait répondu Louis.
C'était une tâche bien adaptée à Lavelotte ; il s'agissait de faire la chaîne, avec deux ou trois autres hommes selon les cas, et de se passer les gerbes, à la fourche, jusqu'à la batteuse. C'était sans doute le poste le moins pénible.
Pourquoi a-t-il fallu qu'un batteux demande, l'air sérieux et sans sourire :
— Et pourquoi pas aux sacs ? C'est vrai, ça, père Picarnon, Lavelotte n'est jamais aux sacs !
— Euh, fait Adolphe Picarnon… euh, vous pensez pas que c'est trop dure pour lui ?
— Trop dur pour lui ? On l'dirait pas, comme ça, mais c'est qu'il est plus fort qu'il en a l'air ! Pas vrai, Lavelotte, que tu peux bien porter l'grain, comme un autre ?
Et d'autres batteux ont repris en chœur :
— C'est vrai ça, qu'il est costaud ! Ils se poussaient du coude, et rigolaient : hein, si on l'mettait aux sacs, on s'amuserait bien ! Tu penses, les sacs, ils sont au moins deux fois plus lourds que lui !
Les porteurs de grain étaient des gaillards considérés, des garçons jeunes, en pleine force, avec de gros biceps et des épaules de forts des Halles. Les sacs, pleins de blé, pesaient quatre-vingts kilos ; quatre-vingts kilos qu'on vous balançait sur le dos, et qu'il fallait porter, depuis la batteuse jusqu'au grenier, une centaine de mètres parfois, et toujours des escaliers ou une échelle à gravir. Chez les Picarnon, c'était un escalier de pierre, rude et long. Quatre tonnes chaque jour à porter, quatre tonnes qui pesaient sur la colonne vertébrale, dans les jambes. C'est pourquoi les porteurs de grain jouissaient d'un traitement de faveur : une bouteille de vin, et non de cidre comme pour les autres, les attendait au grenier. Le patron veillait personnellement à ce qu'elle soit renouvelée dès qu'elle était vide. Et le porteur de grain, après avoir déversé le contenu de son sac sur le tas de blé, ajouté au canif une entaille sur la baguette de noisetier qui permettrait, à la fin du battage, de savoir avec exactitude à combien de boisseaux s'élevait la récolte de l'année, vidait d'un trait son verre de vin et repartait à la batteuse chercher un nouveau sac de quatre-vingts kilos. Oui, quatre tonnes par jour et par homme, mais aussi trois à quatre litres de vin, pour le moins.
— Allons, reprit Adolphe Picarnon, allons les gars, faut être un peu sérieux… Euh… Lavelotte, il peut pas “ porter l'grain ”…
— Et pourquoi donc que j'“ portrais pas l'grain ”, patron ?
Lavelotte était vexé par les ricanements des autres.
— Vous allez voir que j'peux l'porter, tout comme un autre !
— Euh, si c'est comme ça, fit Picarnon en écartant les bras, si c'est comme ça, c'est pas moi qui peux t'en empêcher… Après tout, tu l'verras bien… Il était embarrassé, Adolphe, euh… c'est entendu, j'te mets aux sacs…
Les hommes se poussaient du coude, en clignant de l'œil : hein, on va rigoler…
Louis Lavelotte était domestique chez les Picarnon depuis une quinzaine d'années. Enfant de l'Assistance Publique, il s'était “ embauché ” dès sa sortie de l'école chez eux, à quatorze ans, comme vacher d'abord, puis comme second charretier, et n'avait jamais cherché à changer de maître. C'était un petit rouquin malingre, un peu difforme ; il portait, plaqué en permanence sur le visage, une sorte de rictus qui l'aidait beaucoup à supporter, comme si elles ne l'atteignaient pas, les plaisanteries dont il était l'objet, surtout au moment des battages. Adolphe Picarnon l'envoyait systématiquement “ rendre des journées ” dans toutes les fermes de la région, préférant garder chez lui son premier charretier, Maurice Lauche.
Louis Lavelotte n'était pas un fainéant, oh non ! Tout au contraire. Bon comme le bon pain et sans malice, il dépensait au contraire ses forces sans compter. Il se “ défonçait ”, comme s'il voulait se faire pardonner son air chétif. Il avait son orgueil, Lavelotte, et c'est bien ce qui l'a perdu. Au reste, s'il ne payait pas de mine, il était plus vigoureux qu'on ne l'aurait cru, sec, mais “ tout en nerfs ” comme nous disions.
Non, Louis Lavelotte n'était pas un mauvais garçon, tout au contraire :
— Louis, j'te mets aux gerbes aujourd'hui, et Louis répondait : “ d'accord, patron ”. Qu'on le mette aux gerbes, à la presse, à la batteuse, Louis Lavelotte répondait toujours “ d'accord patron ”. Et s'il était devenu peu à peu un objet d'amusement, le souffre-douleur du village, il n'était pas aussi sot qu'on voulait bien le dire, mais, comme les bouffons d'autrefois, assez sage pour supporter les mauvais tours qu'on lui jouait, et en rire le premier. Et le soir, après le dîner, quand le maître lui disait :
— Louis, tu vas nous jouer un peu d'harmonica, il répondait encore : “ d'accord patron ”.
Alors, on débarrassait la grande table rectangulaire, des planches posées sur tréteaux où les quinze batteux avaient pris leur repas, Lavelotte grimpait dessus avec ses sabots, ajustait l'harmonica à ses lèvres, plissait les yeux, son visage se ridait comme celui d'un singe, et il commençait à jouer la bourrée et à la danser, sur la table, sans quitter ses sabots, qu'il faisait sonner gaillardement au rythme de la danse. Après une journée éreintante.
De temps à autre il détachait l'harmonica de ses lèvres, et, sans cesser ses va-et-vient sur la table, il chantait, Louis Lavelotte, le disgracié :
“ Monsieur l'curé n'veut pas
Qu'les gars bichint les filles,
Mais il n'interdit pas
Qu'les filles bichint les gars… ”
Les hommes, qui avaient fait cercle autour du bouffon, riaient à gorge déployée, se tapaient sur les cuisses et rotaient bruyamment :
— Ce Lavelotte, quel animal tout de même ! Il est impayable !
Les femmes, qui essuyaient déjà la vaisselle, suivaient le spectacle de loin, et s'esclaffaient aussi.
Quand Lavelotte, à bout de souffle, commençait à flancher, et faisait mine de vouloir se reposer un peu, il s'en trouvait toujours plusieurs pour s'écrier, en riant :
— Eh, Lavelotte, tu vas pas t'arrêter coumme ça ! T'en counnais ben d'autres ! Allez Lavelotte, continue, t'es ben l'meilleur !
Et Lavelotte se lançait dans une autre bourrée, toujours jouant, toujours dansant et chantant :
“ J'ai m'né mes dindes à Cosne,
J'ai ram'né mes dindons,
A deux cents francs d'la dinde,
A cinquante les dindons,
Et dansez don’ mes dindes,
Et dansez mes dindons… ”
Les paroles ne valaient certes pas cher, mais la musique était entraînante, et l'envie de saboter la bourrée commençait bientôt à fourmiller dans les jambes des batteux.
La bourrée restait toujours la danse populaire des hommes. Je dis bien “ des hommes ”, non des femmes. La bourrée est une danse virile, danse nuptiale et guerrière à la fois, où les mâles s'affrontent, par deux ou par quatre, sous les yeux des filles, les “ fumelles ”, seulement spectatrices, et qu'il faut séduire. Il s'agit de se montrer à son avantage, par l'élégance du corps, la vigueur de la sabotée, la fierté du regard. A cette époque, tous les hommes savaient encore danser la vraie bourrée populaire, que les troupes folkloriques aujourd'hui essaient de restituer avec beaucoup de mérite, mais de façon affadie, sans âme et sans cœur. La bourrée, ce n'était pas seulement un pas, c'était un langage, venu du plus lointain de notre histoire, et que nous partagions avec nos voisins Berrichons et Auvergnats ; aujourd'hui, on a retenu le pas, mais on a oublié tout le reste, qui était l'essentiel. Oui, c'était une belle danse, la bourrée, la plus belle peut-être, où s'exprimait toute la fierté, la vigueur et comme le génie d'une race. Pour comprendre cela, il faut avoir vu ces paysans lourdauds soudain transfigurés, gaillards et alertes, le buste bien cambré, un peu raide, la tête légèrement rejetée en arrière, les bras ballants au loin du corps, il faut avoir surpris dans les regards échangés au moment où ils se croisent, cette flamme fière qui défie le partenaire…
Et c'est Louis Lavelotte, le plus chétif des garçons du village, qui, avec un simple harmonica, réussissait ce tour de force de réveiller chez les rudes batteux les antiques pulsions de leur race.
Il a tenu le premier jour, Louis Lavelotte. Il a transporté ses quatre tonnes, il a bu ses trois litres de vin.
Mais c'est le deuxième jour qu'a commencé pour lui le calvaire. De sac en sac il geignait plus fort, en montant l'escalier. Il a encore porté ses quatre tonnes, titubant, les mâchoires serrées : ah ils veulent s'amuser encore une fois à tes dépens mon vieux Lavelotte ? Eh bien, tu en crèveras peut-être, mais tu ne peux plus reculer… Ton pari, il faut le gagner !
Le troisième jour, dès le matin, il a senti qu'il n'ira pas jusqu'au soir. Et s'il en parlait au patron ? Il lui donnerait un autre poste, c'est sûr. Oui, mais les autres ? Qu'est-ce qu'ils diraient, les autres ? Lavelotte, mon vieux, tu n'aurais pas fini d'en entendre parler ! Ils se moqueraient de toi encore une fois… Pas qu'ils soient méchants, non. Faut bien rire, mais pas de ça… pas de ta faiblesse. Et je les entends déjà : c'est Lavelotte, qu'est même pas capable de porter les grains !
Combien a-t-il encore porté de sacs, au matin du troisième jour, Louis Lavalotte ? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'arrivé au grenier, il soufflait un long moment, en cachette, le visage dégoulinant de sueur, et qu'il se saisissait fébrilement de la taille. Tout se brouillait devant lui, un voile lui tombait sur les yeux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux Lavelotte ? Tu vois plus les encoches. Tu vas pas caler coumme ça… Bois donc encore un coup… Faut tenir jusqu'à ce soir, y a rien d'aut’ à faire !
Et puis, un peu avant midi, Lavelotte s'est effondré dans l'escalier, sous son sac de blé. On a entendu le bruit du corps qui roulait sur les marches ; on l'a relevé et porté dans sa petite chambre de domestique, et couché sur sa paillasse. Il délirait à moitié, et demandait à boire :
— A bouée, à bouée !… J'ai souéf, oh qu'jai souéf !
On lui a donné à boire. De l'eau, bien fraîche. Il était inondé de sueur : allons, mon vieux Lavelotte, faut te r'mettre, ça va passer !
Ça n'est pas passé. Lavelotte, dévoré de fièvre, a sombré dans une sorte de coma. Il était agité, et il fallait sans cesse le remettre sur sa paillasse. Adolphe Picarnon lui rendait des visites fréquentes. Il était inquiet, le père Adolphe, et pas trop fier de lui. Il essayait de lui parler, embarrassé : allons, mon Louis, calme-toi, on s'occupe de toi, ça va s'arranger. Une fois, il a même eu un peu d'espoir : Lavelotte a reconnu sa voix, a cessé de s'agiter, et, sans ouvrir les yeux, il a murmuré :
— Voyez-don’, patron… j'ai pas pu t'nir ma place…
Pour la première fois depuis bien longtemps, le battage ne s'est pas achevé en fête, et on n'a pas dansé la bourrée. On n'avait plus de musicien, et de toutes façons, le cœur n'y était pas. Les Picarnon ont attendu un jour, puis deux, puis, affolés, ils ont appelé le docteur. C'était trop tard. Lavelotte est mort le troisième jour, sans avoir repris connaissance, et sans avoir pu “ tenir sa place au battage ” jusqu'au bout.
Il n'avait pas de famille. Pourtant, quand on l'a porté aux Terres Rouges, tout le village suivait le corbillard, en un long cortège silencieux. Personne ne se sentait bien fier. Même les derniers, ceux qui se trouvaient tout au bout, marchaient à pas lents, en silence, sans se regarder, faces de glaise obstinément baissées, le chapeau noir rabattu sur les yeux, et les gros poings serrés. Et ce qui passait exactement dans les têtes, personne ne saurait le dire. Ce qui est sûr, c'est que chacun est rentré chez soi, après l'enterrement, et qu'on n'a pas fait la tournée des cafés.
A Briez, on n'avait jamais vu ça.
— Et pourquoi donc que j'“ portrais pas l'grain ”, patron ?
Lavelotte était vexé par les ricanements des autres.
— Vous allez voir que j'peux l'porter, tout comme un autre !
— Euh, si c'est comme ça, fit Picarnon en écartant les bras, si c'est comme ça, c'est pas moi qui peux t'en empêcher… Après tout, tu l'verras bien… Il était embarrassé, Adolphe, euh… c'est entendu, j'te mets aux sacs…
Les hommes se poussaient du coude, en clignant de l'œil : hein, on va rigoler…
Louis Lavelotte était domestique chez les Picarnon depuis une quinzaine d'années. Enfant de l'Assistance Publique, il s'était “ embauché ” dès sa sortie de l'école chez eux, à quatorze ans, comme vacher d'abord, puis comme second charretier, et n'avait jamais cherché à changer de maître. C'était un petit rouquin malingre, un peu difforme ; il portait, plaqué en permanence sur le visage, une sorte de rictus qui l'aidait beaucoup à supporter, comme si elles ne l'atteignaient pas, les plaisanteries dont il était l'objet, surtout au moment des battages. Adolphe Picarnon l'envoyait systématiquement “ rendre des journées ” dans toutes les fermes de la région, préférant garder chez lui son premier charretier, Maurice Lauche.
Louis Lavelotte n'était pas un fainéant, oh non ! Tout au contraire. Bon comme le bon pain et sans malice, il dépensait au contraire ses forces sans compter. Il se “ défonçait ”, comme s'il voulait se faire pardonner son air chétif. Il avait son orgueil, Lavelotte, et c'est bien ce qui l'a perdu. Au reste, s'il ne payait pas de mine, il était plus vigoureux qu'on ne l'aurait cru, sec, mais “ tout en nerfs ” comme nous disions.
Non, Louis Lavelotte n'était pas un mauvais garçon, tout au contraire :
— Louis, j'te mets aux gerbes aujourd'hui, et Louis répondait : “ d'accord, patron ”. Qu'on le mette aux gerbes, à la presse, à la batteuse, Louis Lavelotte répondait toujours “ d'accord patron ”. Et s'il était devenu peu à peu un objet d'amusement, le souffre-douleur du village, il n'était pas aussi sot qu'on voulait bien le dire, mais, comme les bouffons d'autrefois, assez sage pour supporter les mauvais tours qu'on lui jouait, et en rire le premier. Et le soir, après le dîner, quand le maître lui disait :
— Louis, tu vas nous jouer un peu d'harmonica, il répondait encore : “ d'accord patron ”.
Alors, on débarrassait la grande table rectangulaire, des planches posées sur tréteaux où les quinze batteux avaient pris leur repas, Lavelotte grimpait dessus avec ses sabots, ajustait l'harmonica à ses lèvres, plissait les yeux, son visage se ridait comme celui d'un singe, et il commençait à jouer la bourrée et à la danser, sur la table, sans quitter ses sabots, qu'il faisait sonner gaillardement au rythme de la danse. Après une journée éreintante.
De temps à autre il détachait l'harmonica de ses lèvres, et, sans cesser ses va-et-vient sur la table, il chantait, Louis Lavelotte, le disgracié :
“ Monsieur l'curé n'veut pas
Qu'les gars bichint les filles,
Mais il n'interdit pas
Qu'les filles bichint les gars… ”
Les hommes, qui avaient fait cercle autour du bouffon, riaient à gorge déployée, se tapaient sur les cuisses et rotaient bruyamment :
— Ce Lavelotte, quel animal tout de même ! Il est impayable !
Les femmes, qui essuyaient déjà la vaisselle, suivaient le spectacle de loin, et s'esclaffaient aussi.
Quand Lavelotte, à bout de souffle, commençait à flancher, et faisait mine de vouloir se reposer un peu, il s'en trouvait toujours plusieurs pour s'écrier, en riant :
— Eh, Lavelotte, tu vas pas t'arrêter coumme ça ! T'en counnais ben d'autres ! Allez Lavelotte, continue, t'es ben l'meilleur !
Et Lavelotte se lançait dans une autre bourrée, toujours jouant, toujours dansant et chantant :
“ J'ai m'né mes dindes à Cosne,
J'ai ram'né mes dindons,
A deux cents francs d'la dinde,
A cinquante les dindons,
Et dansez don’ mes dindes,
Et dansez mes dindons… ”
Les paroles ne valaient certes pas cher, mais la musique était entraînante, et l'envie de saboter la bourrée commençait bientôt à fourmiller dans les jambes des batteux.
La bourrée restait toujours la danse populaire des hommes. Je dis bien “ des hommes ”, non des femmes. La bourrée est une danse virile, danse nuptiale et guerrière à la fois, où les mâles s'affrontent, par deux ou par quatre, sous les yeux des filles, les “ fumelles ”, seulement spectatrices, et qu'il faut séduire. Il s'agit de se montrer à son avantage, par l'élégance du corps, la vigueur de la sabotée, la fierté du regard. A cette époque, tous les hommes savaient encore danser la vraie bourrée populaire, que les troupes folkloriques aujourd'hui essaient de restituer avec beaucoup de mérite, mais de façon affadie, sans âme et sans cœur. La bourrée, ce n'était pas seulement un pas, c'était un langage, venu du plus lointain de notre histoire, et que nous partagions avec nos voisins Berrichons et Auvergnats ; aujourd'hui, on a retenu le pas, mais on a oublié tout le reste, qui était l'essentiel. Oui, c'était une belle danse, la bourrée, la plus belle peut-être, où s'exprimait toute la fierté, la vigueur et comme le génie d'une race. Pour comprendre cela, il faut avoir vu ces paysans lourdauds soudain transfigurés, gaillards et alertes, le buste bien cambré, un peu raide, la tête légèrement rejetée en arrière, les bras ballants au loin du corps, il faut avoir surpris dans les regards échangés au moment où ils se croisent, cette flamme fière qui défie le partenaire…
Et c'est Louis Lavelotte, le plus chétif des garçons du village, qui, avec un simple harmonica, réussissait ce tour de force de réveiller chez les rudes batteux les antiques pulsions de leur race.
Il a tenu le premier jour, Louis Lavelotte. Il a transporté ses quatre tonnes, il a bu ses trois litres de vin.
Mais c'est le deuxième jour qu'a commencé pour lui le calvaire. De sac en sac il geignait plus fort, en montant l'escalier. Il a encore porté ses quatre tonnes, titubant, les mâchoires serrées : ah ils veulent s'amuser encore une fois à tes dépens mon vieux Lavelotte ? Eh bien, tu en crèveras peut-être, mais tu ne peux plus reculer… Ton pari, il faut le gagner !
Le troisième jour, dès le matin, il a senti qu'il n'ira pas jusqu'au soir. Et s'il en parlait au patron ? Il lui donnerait un autre poste, c'est sûr. Oui, mais les autres ? Qu'est-ce qu'ils diraient, les autres ? Lavelotte, mon vieux, tu n'aurais pas fini d'en entendre parler ! Ils se moqueraient de toi encore une fois… Pas qu'ils soient méchants, non. Faut bien rire, mais pas de ça… pas de ta faiblesse. Et je les entends déjà : c'est Lavelotte, qu'est même pas capable de porter les grains !
Combien a-t-il encore porté de sacs, au matin du troisième jour, Louis Lavalotte ? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'arrivé au grenier, il soufflait un long moment, en cachette, le visage dégoulinant de sueur, et qu'il se saisissait fébrilement de la taille. Tout se brouillait devant lui, un voile lui tombait sur les yeux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux Lavelotte ? Tu vois plus les encoches. Tu vas pas caler coumme ça… Bois donc encore un coup… Faut tenir jusqu'à ce soir, y a rien d'aut’ à faire !
Et puis, un peu avant midi, Lavelotte s'est effondré dans l'escalier, sous son sac de blé. On a entendu le bruit du corps qui roulait sur les marches ; on l'a relevé et porté dans sa petite chambre de domestique, et couché sur sa paillasse. Il délirait à moitié, et demandait à boire :
— A bouée, à bouée !… J'ai souéf, oh qu'jai souéf !
On lui a donné à boire. De l'eau, bien fraîche. Il était inondé de sueur : allons, mon vieux Lavelotte, faut te r'mettre, ça va passer !
Ça n'est pas passé. Lavelotte, dévoré de fièvre, a sombré dans une sorte de coma. Il était agité, et il fallait sans cesse le remettre sur sa paillasse. Adolphe Picarnon lui rendait des visites fréquentes. Il était inquiet, le père Adolphe, et pas trop fier de lui. Il essayait de lui parler, embarrassé : allons, mon Louis, calme-toi, on s'occupe de toi, ça va s'arranger. Une fois, il a même eu un peu d'espoir : Lavelotte a reconnu sa voix, a cessé de s'agiter, et, sans ouvrir les yeux, il a murmuré :
— Voyez-don’, patron… j'ai pas pu t'nir ma place…
Pour la première fois depuis bien longtemps, le battage ne s'est pas achevé en fête, et on n'a pas dansé la bourrée. On n'avait plus de musicien, et de toutes façons, le cœur n'y était pas. Les Picarnon ont attendu un jour, puis deux, puis, affolés, ils ont appelé le docteur. C'était trop tard. Lavelotte est mort le troisième jour, sans avoir repris connaissance, et sans avoir pu “ tenir sa place au battage ” jusqu'au bout.
Il n'avait pas de famille. Pourtant, quand on l'a porté aux Terres Rouges, tout le village suivait le corbillard, en un long cortège silencieux. Personne ne se sentait bien fier. Même les derniers, ceux qui se trouvaient tout au bout, marchaient à pas lents, en silence, sans se regarder, faces de glaise obstinément baissées, le chapeau noir rabattu sur les yeux, et les gros poings serrés. Et ce qui passait exactement dans les têtes, personne ne saurait le dire. Ce qui est sûr, c'est que chacun est rentré chez soi, après l'enterrement, et qu'on n'a pas fait la tournée des cafés.
A Briez, on n'avait jamais vu ça.
Eugène, Renée, Jean. Unique photo des trois ensemble...
Paix sur mon village
Jours de juillet, brûlants comme une fournaise. Immobile dans le ciel, le soleil flamme, le soleil flambe, le soleil lèche comme un feu de cheminée, et la campagne se tord sous sa morsure. Anéantissement. Les arbres tremblent dans l'air qui vibre, et c'est comme si tout allait se dissoudre et fondre sous la chaleur. On cherche en vain l'ombre : elle est mangée par la lumière.
Haletantes, les bêtes se tiennent tapies dans les fourrés, et les épis de blé craquettent sous l'haleine desséchante du vent “ soulaire ”.
Nous fournissions, ces jours-là, où nous aurions aimé attendre le crépuscule dans la fraîcheur des maisons aux volets clos, la plus harassante débauche de travail de l'année. Marcher, marcher du lever au coucher du soleil, marcher encore dans l'éteule brûlante, prendre à bras le corps les gerbes, les rassembler en moyettes bien alignées, puis les embrocher à la fourche, les tendre à l'empileur jusqu'au haut des chariots, et cent fois, mille fois répéter le même geste, et après quelques heures vous ne sentiez plus votre corps, ni la fatigue qui depuis longtemps avait rendu vos muscles indolores, ni votre gorge desséchée, en feu ; vous aviez perdu le sens même du temps ; vous marchiez, le cerveau vidé.
Le soir, après le dîner, nous sortions devant la maison, sous l'orme. Pour attendre la nuit. Elle vient lentement en cette saison. On dirait que la lumière ne veut pas se retirer. Elle s'en va, mais à reculons, comme à regret. Peu à peu, les masses se fondent dans l'obscurité qui monte du sol, et gagne, comme une houle qui rampe, le bas des maisons, le pied des arbres qu'elle enlace, glisse au long des façades, envoie les pignons. Les lointains s'estompent d'abord, et puis la marée atteint les toits, les cimes des arbres, et voilà qu'elle les submerge. Elle apporte avec elle une exquise fraîcheur, l'odeur de froment mûr, et l'impressionnant silence des soirs d'été. C'est le silence qui suit les grandes batailles ; la terre revient à elle, cherche à reprendre souffle. C'est l'heure où descend la paix merveilleuse, qui vient après la peine, apaise les membres douloureux, détend les corps et calme les cœurs.
Dans le lointain, on entend encore le bruit de deux seaux que l'on entrechoque, le claquement de volets qu'on ferme, la voix bien distincte du père Ledin. Un chien aboie. Et progressivement le silence s'empare du village qui se recueille.
Très loin, bien au-delà des contrées connues, le ciel s'embrase, une fraction de seconde, et vibre d'une grande lueur qui aussitôt s'éteint :
— Des éclairs de chaleur, dit mon père. Signe de beau temps pour demain. Et de grande chaleur, comme aujourd'hui.
Sous l'orme, nous buvons le silence, nous aspirons la fraîcheur de la nuit, à longues goulées, et de tous les pores de notre peau. Le corps nous fait mal maintenant, mais c'est bon de le sentir, de nouveau, d'étirer les bras et les jambes endoloris.
C'est l'heure délicieuse où la caille entonne son chant discret, dans les champs de blé que la moissonneuse a épargnés. Elle se racle la gorge, et margote en grasseyant un peu.
— Ecoute, murmure mon père… Ecoute la caille ! Cette petite boule de plumes toute ronde n'est jamais contente. Tu sais ce qu'elle chante, la caille ? Tu sais ce qu'elle dit ? A peu près la même chose que nous, paysans. Elle parle à ses enfants. Elle leur fait la leçon. Elle leur apprend la sagesse, et qu'il faut savoir économiser, et prévoir pour l'avenir. Ecoute… elle leur dit :
“ Can-cailla, can-cailla,
Quand y a du blé, je n'ai plus de sacs,
Can-cailla, can-cailla,
Quand y a des sacs, je n'ai plus de blé ! ”
— Voilà ce qu'elle dit, la caille. C'est à peu près notre chant, à nous aussi. Mais avec cela, en ce moment, elle est grasse, et dodue, gavée comme une gourmande qu'elle est !
L'ombre s'insinue maintenant entre nous. Nous nous distinguons avec peine. Il ne faut plus parler. Il ne faut pas effrayer la nuit. Il ne faut pas briser la paix.
Il serait sage de rentrer, de s'aller reposer. Non, restons donc encore un peu. Restons toute la nuit. Elle est si courte, et demain viendra bien assez tôt ! Et puis, si la caille a commencé sa vie, le “ do ”, lui, ne s'est pas encore fait entendre. Il attend son heure. Ce silence ne lui suffit pas… Il n'a qu'une corde à sa lyre, et il le sait. Et il sait aussi que pour que son chant envoûte, il lui faut parler le dernier, parler seul à la nuit. Et il veut envoûter.
Le “ do ” est un sorcier, un “ empicasseux ”. Le “ do ”, cet être chthonien, c'est le crapaud sonneur, en parler nivernais. Il se tient dans son antre humide toute la journée, hébété, paupières closes sur ses yeux globuleux, corps flasque écrasé sur ses pattes repliées. Il se sait laid, la plus laide bête de la création. Alors il se cache toute la journée. Il se terre. Mais il attend son heure. Et quand il fait bien noir, quand il est sûr que rien ni personne ne peut plus le voir, il sort lentement de sa retraite obscure. Les nuits de juillet sont courtes, mais elles sont à lui. Et alors, la bête immonde, pustuleuse, engage avec le ciel où s'allument une à une les étoiles, une mystérieuse conversation et tandis que descend sur la terre le majestueux silence de la nuit de juillet, s'élève, seule, pure comme le cristal, comme les étoiles qui scintillent là-haut, ensorcelante, la note courte et flûtée, inlassablement répétée du “ do ”.
Jours de juillet, brûlants comme une fournaise. Immobile dans le ciel, le soleil flamme, le soleil flambe, le soleil lèche comme un feu de cheminée, et la campagne se tord sous sa morsure. Anéantissement. Les arbres tremblent dans l'air qui vibre, et c'est comme si tout allait se dissoudre et fondre sous la chaleur. On cherche en vain l'ombre : elle est mangée par la lumière.
Haletantes, les bêtes se tiennent tapies dans les fourrés, et les épis de blé craquettent sous l'haleine desséchante du vent “ soulaire ”.
Nous fournissions, ces jours-là, où nous aurions aimé attendre le crépuscule dans la fraîcheur des maisons aux volets clos, la plus harassante débauche de travail de l'année. Marcher, marcher du lever au coucher du soleil, marcher encore dans l'éteule brûlante, prendre à bras le corps les gerbes, les rassembler en moyettes bien alignées, puis les embrocher à la fourche, les tendre à l'empileur jusqu'au haut des chariots, et cent fois, mille fois répéter le même geste, et après quelques heures vous ne sentiez plus votre corps, ni la fatigue qui depuis longtemps avait rendu vos muscles indolores, ni votre gorge desséchée, en feu ; vous aviez perdu le sens même du temps ; vous marchiez, le cerveau vidé.
Le soir, après le dîner, nous sortions devant la maison, sous l'orme. Pour attendre la nuit. Elle vient lentement en cette saison. On dirait que la lumière ne veut pas se retirer. Elle s'en va, mais à reculons, comme à regret. Peu à peu, les masses se fondent dans l'obscurité qui monte du sol, et gagne, comme une houle qui rampe, le bas des maisons, le pied des arbres qu'elle enlace, glisse au long des façades, envoie les pignons. Les lointains s'estompent d'abord, et puis la marée atteint les toits, les cimes des arbres, et voilà qu'elle les submerge. Elle apporte avec elle une exquise fraîcheur, l'odeur de froment mûr, et l'impressionnant silence des soirs d'été. C'est le silence qui suit les grandes batailles ; la terre revient à elle, cherche à reprendre souffle. C'est l'heure où descend la paix merveilleuse, qui vient après la peine, apaise les membres douloureux, détend les corps et calme les cœurs.
Dans le lointain, on entend encore le bruit de deux seaux que l'on entrechoque, le claquement de volets qu'on ferme, la voix bien distincte du père Ledin. Un chien aboie. Et progressivement le silence s'empare du village qui se recueille.
Très loin, bien au-delà des contrées connues, le ciel s'embrase, une fraction de seconde, et vibre d'une grande lueur qui aussitôt s'éteint :
— Des éclairs de chaleur, dit mon père. Signe de beau temps pour demain. Et de grande chaleur, comme aujourd'hui.
Sous l'orme, nous buvons le silence, nous aspirons la fraîcheur de la nuit, à longues goulées, et de tous les pores de notre peau. Le corps nous fait mal maintenant, mais c'est bon de le sentir, de nouveau, d'étirer les bras et les jambes endoloris.
C'est l'heure délicieuse où la caille entonne son chant discret, dans les champs de blé que la moissonneuse a épargnés. Elle se racle la gorge, et margote en grasseyant un peu.
— Ecoute, murmure mon père… Ecoute la caille ! Cette petite boule de plumes toute ronde n'est jamais contente. Tu sais ce qu'elle chante, la caille ? Tu sais ce qu'elle dit ? A peu près la même chose que nous, paysans. Elle parle à ses enfants. Elle leur fait la leçon. Elle leur apprend la sagesse, et qu'il faut savoir économiser, et prévoir pour l'avenir. Ecoute… elle leur dit :
“ Can-cailla, can-cailla,
Quand y a du blé, je n'ai plus de sacs,
Can-cailla, can-cailla,
Quand y a des sacs, je n'ai plus de blé ! ”
— Voilà ce qu'elle dit, la caille. C'est à peu près notre chant, à nous aussi. Mais avec cela, en ce moment, elle est grasse, et dodue, gavée comme une gourmande qu'elle est !
L'ombre s'insinue maintenant entre nous. Nous nous distinguons avec peine. Il ne faut plus parler. Il ne faut pas effrayer la nuit. Il ne faut pas briser la paix.
Il serait sage de rentrer, de s'aller reposer. Non, restons donc encore un peu. Restons toute la nuit. Elle est si courte, et demain viendra bien assez tôt ! Et puis, si la caille a commencé sa vie, le “ do ”, lui, ne s'est pas encore fait entendre. Il attend son heure. Ce silence ne lui suffit pas… Il n'a qu'une corde à sa lyre, et il le sait. Et il sait aussi que pour que son chant envoûte, il lui faut parler le dernier, parler seul à la nuit. Et il veut envoûter.
Le “ do ” est un sorcier, un “ empicasseux ”. Le “ do ”, cet être chthonien, c'est le crapaud sonneur, en parler nivernais. Il se tient dans son antre humide toute la journée, hébété, paupières closes sur ses yeux globuleux, corps flasque écrasé sur ses pattes repliées. Il se sait laid, la plus laide bête de la création. Alors il se cache toute la journée. Il se terre. Mais il attend son heure. Et quand il fait bien noir, quand il est sûr que rien ni personne ne peut plus le voir, il sort lentement de sa retraite obscure. Les nuits de juillet sont courtes, mais elles sont à lui. Et alors, la bête immonde, pustuleuse, engage avec le ciel où s'allument une à une les étoiles, une mystérieuse conversation et tandis que descend sur la terre le majestueux silence de la nuit de juillet, s'élève, seule, pure comme le cristal, comme les étoiles qui scintillent là-haut, ensorcelante, la note courte et flûtée, inlassablement répétée du “ do ”.
Tous droits réservés.
*************************************************************************************************************************************
Nous avons découvert ces textes après la mort de Papa. De son vivant, nous connaissions quelques histoires, et surtout chaque dimanche nous allions déjeuner à Ciez, chez Mémé, dans cette fameuse maison où Edouard vécut et mourut. C'était une corvée (il est même arrivé que Laurent vomisse en y allant, mais bon tout le monde sait que la CX fait vomir !), la journée n'était agrémentée que par la télévision que nous n'avions pas chez nous. Rencontre avec Starsky et Hutch, dont mes copains me parlaient à l'école, je croyais que c'était un seul et même personnage, "Starskyéhutch". Mon frère a écrit un beau texte sur la télé chez Mémé, à lire ici.
Au cimetière, rituellement, on nous montrait toutes les tombes, une à une. Dont celle de Jean, le premier enfant, mort à un an. Il nous fallu longtemps encore pour comprendre que Papa (Jean-Claude) était double.
Une anecdote résumait à elle seule tout le passé : celle de la binette. L'instituteur de Ciez avait repéré les les qualités scolaires de Jean. Un jour il convoqua les parents pour leur dire que Jean pouvait aller au collège, en internat. De retour à la ferme, dans la charrette, Eugène dit à son fils qu'il lui laissait le choix : aller étudier à la ville, ou rester à la ferme avec eux. Jean répondit sans hésiter qu'il voulait rester à la ferme. Le soir au souper, Eugène lui dit : "Bien mon petit, alors demain tu iras biner le champ de betteraves". Jean se lève aux aurores, part avec son casse-croûte, et commence son labeur. Au bout de quelques heures, déjà fourbu, il observe l'étendue restant à biner par rapport à ce qu'il vient de faire. Il casse la croûte, reprend l'ouvrage. A midi son dos est cassé, ses mains sont en sang. Il rentre à la ferme, et penaud, craignant de se faire engueuler, il annonce à ses parents que finalement, il veut bien faire des études. Eclat de rire du père, malin, content de son tour, et désarroi surpris de Papa qui comprend qu'il a été manipulé. La binette est restée un objet sacré, je l'ai toujours connue avec nous, porteuse de son message historique.
Collège, lycée à Cosne-sur-Loire, puis Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon. Instituteur, professeur, agrégé, son parcours idéal républicain faisait causer dans les chaumières. En publiant ces textes une première fois il y a un an, et en les relayant sur une réseau social, j'ai été contacté par la petite-fille de l'instituteur, qui se rappelait que son grand-père parlait toujours de Papa comme le meilleur élève de toute sa carrière.
Mais bizarrement Papa ne parlait jamais de son père. Il était très tendre avec sa mère, silencieusement. Nous sentions que cette visite hebdomadaire était pour lui comme un serment tenu. En fait c'est après sa mort que nous avons compris, tirant un à un les quelques fils que nous avions en main. Enfant Papa adorait son père, charismatique et drôle, effaçant presque tout à fait l'image de sa mère par ailleurs effacée. Mais un jour une voisine, leur propriétaire, convoqua père et fils sous prétexte de réparer une clôture. Elle profita de ce moment pour annoncer à Jean que son père était un coureur connu dans toute la région, que sa mère était cocue. Cette révélation fut un choc insurmontable pour Papa, qui de ce jour fit dégringoler son père du piédestal où il l'avait mis, puis tenta le reste de sa vie d'y installer sa mère. Apparemment il n'adressa plus la parole à son père pendant des années, et peut-être jusqu'à la mort d'Eugène en 1965. Mon frère poursuivit plus loin l'enquête, à la recherche d'un éventuel fils caché, demi-frère de Papa, et il semble bien qu'il ait existé. Ce qui expliquerait encore mieux la fâcherie de Papa à l'encontre de son géniteur.
Nous avons découvert ces textes après la mort de Papa. De son vivant, nous connaissions quelques histoires, et surtout chaque dimanche nous allions déjeuner à Ciez, chez Mémé, dans cette fameuse maison où Edouard vécut et mourut. C'était une corvée (il est même arrivé que Laurent vomisse en y allant, mais bon tout le monde sait que la CX fait vomir !), la journée n'était agrémentée que par la télévision que nous n'avions pas chez nous. Rencontre avec Starsky et Hutch, dont mes copains me parlaient à l'école, je croyais que c'était un seul et même personnage, "Starskyéhutch". Mon frère a écrit un beau texte sur la télé chez Mémé, à lire ici.
Au cimetière, rituellement, on nous montrait toutes les tombes, une à une. Dont celle de Jean, le premier enfant, mort à un an. Il nous fallu longtemps encore pour comprendre que Papa (Jean-Claude) était double.
Une anecdote résumait à elle seule tout le passé : celle de la binette. L'instituteur de Ciez avait repéré les les qualités scolaires de Jean. Un jour il convoqua les parents pour leur dire que Jean pouvait aller au collège, en internat. De retour à la ferme, dans la charrette, Eugène dit à son fils qu'il lui laissait le choix : aller étudier à la ville, ou rester à la ferme avec eux. Jean répondit sans hésiter qu'il voulait rester à la ferme. Le soir au souper, Eugène lui dit : "Bien mon petit, alors demain tu iras biner le champ de betteraves". Jean se lève aux aurores, part avec son casse-croûte, et commence son labeur. Au bout de quelques heures, déjà fourbu, il observe l'étendue restant à biner par rapport à ce qu'il vient de faire. Il casse la croûte, reprend l'ouvrage. A midi son dos est cassé, ses mains sont en sang. Il rentre à la ferme, et penaud, craignant de se faire engueuler, il annonce à ses parents que finalement, il veut bien faire des études. Eclat de rire du père, malin, content de son tour, et désarroi surpris de Papa qui comprend qu'il a été manipulé. La binette est restée un objet sacré, je l'ai toujours connue avec nous, porteuse de son message historique.
Collège, lycée à Cosne-sur-Loire, puis Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon. Instituteur, professeur, agrégé, son parcours idéal républicain faisait causer dans les chaumières. En publiant ces textes une première fois il y a un an, et en les relayant sur une réseau social, j'ai été contacté par la petite-fille de l'instituteur, qui se rappelait que son grand-père parlait toujours de Papa comme le meilleur élève de toute sa carrière.
Mais bizarrement Papa ne parlait jamais de son père. Il était très tendre avec sa mère, silencieusement. Nous sentions que cette visite hebdomadaire était pour lui comme un serment tenu. En fait c'est après sa mort que nous avons compris, tirant un à un les quelques fils que nous avions en main. Enfant Papa adorait son père, charismatique et drôle, effaçant presque tout à fait l'image de sa mère par ailleurs effacée. Mais un jour une voisine, leur propriétaire, convoqua père et fils sous prétexte de réparer une clôture. Elle profita de ce moment pour annoncer à Jean que son père était un coureur connu dans toute la région, que sa mère était cocue. Cette révélation fut un choc insurmontable pour Papa, qui de ce jour fit dégringoler son père du piédestal où il l'avait mis, puis tenta le reste de sa vie d'y installer sa mère. Apparemment il n'adressa plus la parole à son père pendant des années, et peut-être jusqu'à la mort d'Eugène en 1965. Mon frère poursuivit plus loin l'enquête, à la recherche d'un éventuel fils caché, demi-frère de Papa, et il semble bien qu'il ait existé. Ce qui expliquerait encore mieux la fâcherie de Papa à l'encontre de son géniteur.
Papa est mort le 14 avril 1988 au Cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor.
Sur le contexte, j'en dis plus en milieu du site "Localer"; les circonstances les voilà, pour ce que nous en savons, puisqu'il était seul.
Nous avions l'habitude d'y venir chaque année, et le jeu avec mon frère et Papa était de descendre tout en bas de la falaise, au ras de l'eau. La descente était ardue, et simple à la fois. Il fallait juste bien faire attention à chacune de ses prises, pieds et mains. Il y avait des espèces de grottes à mi-falaise, juste en face du rocher aux oiseaux, avec un parterre d'herbe, comme un gazon anglais. On s'y arrêtait des heures, avec les jumelles, à observer, Papa était le plus patient, comme s'il n'en partirait plus.
Ces vacances de Pâques, pour la première fois mon frère n'était pas là, il venait de rentrer en hypokhâgne au lycée Lakanal de Sceaux, et il avait déjà repris les cours. C'était la première fois que nous étions en vacances à trois.
L'avant veille, nous avions crapahuté, Maman comme d'habitude nous avait laissé lorsque nous avions commencé la descente. Nous nous étions retrouvés tous les deux sur un rocher à ras de l'eau, et nous avions pissé de concert, dans un ressac entre deux roches. Je lui dis que ça faisait comme une chasse d'eau, et Papa me confia qu'un jour, seul, il avait chié là, souvenir délicieux. Nous en avons ri, fort. Au retour, sur le chemin des douaniers, je me suis retourné pour le prendre en photo, il avait ce grand sourire que nous avions échangé en bas, il me fit un salut de la main. Les jours suivants je me suis rappelé de ce cliché, j'ai fait développé la pellicule mais cette photo était brûlée, foutue.
Le soir à l'hôtel, je me suis senti malade, fiévreux, je suis resté dans ma chambre le lendemain. Le soir venu, Papa de retour de la falaise me dit qu'il avait trouvé un nouvel endroit encore mieux pour observer, il voulait absolument me le faire découvrir. Mais j'étais encore malade, on se dit que l'on verrait au petit-déjeuner si j'allais mieux. On prit ce petit-déjeuner tous les deux, moment très rare, unique fois ? Il était venu me réveiller dans ma chambre, vraiment soucieux de mon état, j'en étais touché, et en prenant le petit-déjeuner on a convenu que je n'étais définitivement pas assez en forme pour l'accompagner.
Ils sont partis avec la CX jusqu'au parking du phare, à trois ou quatre kilomètres de l'hôtel. Ils ont marché ensemble jusqu'à l'endroit menant à sa nouvelle découverte, Maman est restée sur le sentier, puis elle est rentrée à l'hôtel à pied. Vers onze heure elle a commencé à s'inquiéter, moi non, je me foutais un peu d'elle. Vers 11h30, son angoisse commença à me gagner, et à midi n'y tenant plus nous avons décidé d'aller à pied au phare.
A chaque virage de ces quelques kilomètres j'espérais voir surgir la CX, j'écoutais chaque bruit de moteur, et au fur à mesure du chemin notre angoisse devenait plus vive. En voyant la CX toujours garée sur le parking du phare, je crois que nous avions déjà presque compris. Nous nous sommes précipité dans la loge du gardien qui était là. Non, on ne lui avait rien signalé. Il avait sûrement oublié le temps face au spectacle, on s'inquiétait sûrement pour rien. A ce moment là, à la radio, on entend qu'un corps a été découvert au pied de la falaise, au ras de l'eau. On a grimpé dans la camionnette du gardien, qui nous a emmené sur les lieux. Il y avait plusieurs véhicules, gendarmes et pompiers. C'était assez confus, on nous a tenu à l'écart, au loin on apercevait des dizaines de personnes en arc de cercle au bord de la falaise, le regard braqué en bas. C'est là que nous avons entendu plus de précision sur le corps: "Homme cinquante ans environ". Je me souviens, Maman demandant au pompier resté près de nous : "Mais il est mort ??". Et lui répondant, haussant les épaules : "Ben, oui".
KO debout, j'ai tout de suite senti que ce tremblement de terre tremblerait toute ma vie. Après tout est comme embrouillardé, mais je me rappelle presque de chaque détail. Nous avons été pris en charge par deux gendarmes, un jeune visiblement ému, et un vieux expérimenté. Le corps n'était pas atteignable par la falaise, les pompiers ont dû venir en Zodiac pour le chercher par la mer. On est monté dans la 4L des gendarmes qui nous ont emmené à la caserne des pompiers, je crois que c'était à Saint Cast le Guildo. Là nous avons pu voir le corps. Il n'était presque pas abîmé, il avait l'air calme, les yeux fermés, juste une profonde entaille de quelques centimètres sur la droite de son front.
Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, nous n'avons pas dormi, nous avons discuté toute la nuit avec Maman. Nous avons écarté tout de suite l'hypothèse du suicide, impossible, il était trop heureux ces jours-ci. Un médecin légiste fit un rapport, montrant que Papa portait des baskets à semelles lisses ce jour-là. Il avait plu la veille, la lande était détrempée, et remontant la falaise il aurait glissé sur son dernier appui, le médecin ajoutant qu'il avait vu la trace de la glissade. Il aurait basculé en arrière dans le vide, se serait brisé la nuque, et serait donc mort avant même d'avoir touché le rocher. Je ne sais pas par quelle force, mais cette nuit-là avec Maman nous avons su positiver, oui, positiver. Nous nous sommes dit qu'il était mort heureux, dans la force de l'âge, sans souffrir, enfin débarrassé des fardeaux hérités, et que loin d'être une chute, sa mort était un envol. L'envol du Martinet.
Il a dû juste avoir le temps de se dire : "Merde".
Cette nuit-là, aussi, je me suis promis de ne pas rajouter de souci à ma mère, et je me tins bien sage les années suivantes.
Laurent nous a rejoint le lendemain; il a vécu le drame à distance, ses souvenirs sont ici.
Mon père étant maire, nous avons eu droit à quelques égards. Le maire d'une commune voisine (Matignon je crois, ou Plévenon comme l'écrit mon frère ?) nous prêta son gymnase pour garder le corps avant son rapatriement. C'est là que nous l'avons revu, Laurent pour la première fois. Le sac blanc, la fermeture éclair. Cette fois-ci il était livide, gris, ses poils de barbe avaient poussé, et quelques hématomes étaient apparus sur le visage, le torse et les bras. Ensuite c'est un retour de nuit, l'assurance nous avait envoyé un chauffeur qui ramena la CX, et nous dedans. Des amis nous attendaient dans notre maison d'Urzy, les plus proches bien sûr, ils nous ont pris en main nous n'avions rien à faire. Le corps est arrivé le lendemain, je me souviens de l'entrée de la voiture dans la cour, les amis autour. On l'installa dans le bureau de Maman, dans l'aile gauche sur mon dessin, cercueil fermé. Ce fût le défilé des adjoints éplorés, puis l'enterrement. Le lycée avait affrété un ou plusieurs bus, tout le parti communiste était là (je me souviens de leur gerbe), les résistants, les autres politiques, les profs et les élèves. Plus de mille personnes, une sono avait été installée devant le porche de la petite église d'Urzy pour les personnes restées à l'extérieur. La cérémonie fut célébrée par un prêtre ouvrier, chauffeur-livreur, devant le cercueil recouvert du drapeau tricolore, et c'était beau. Je n'avais pas tout à fait 16 ans. Il n'était pas Ambroise Croizat, mais ce fût un bel enterrement, et les personnes présentes - vivantes - s'en souviennent encore.
************************************************************************************************************************************
Sur le contexte, j'en dis plus en milieu du site "Localer"; les circonstances les voilà, pour ce que nous en savons, puisqu'il était seul.
Nous avions l'habitude d'y venir chaque année, et le jeu avec mon frère et Papa était de descendre tout en bas de la falaise, au ras de l'eau. La descente était ardue, et simple à la fois. Il fallait juste bien faire attention à chacune de ses prises, pieds et mains. Il y avait des espèces de grottes à mi-falaise, juste en face du rocher aux oiseaux, avec un parterre d'herbe, comme un gazon anglais. On s'y arrêtait des heures, avec les jumelles, à observer, Papa était le plus patient, comme s'il n'en partirait plus.
Ces vacances de Pâques, pour la première fois mon frère n'était pas là, il venait de rentrer en hypokhâgne au lycée Lakanal de Sceaux, et il avait déjà repris les cours. C'était la première fois que nous étions en vacances à trois.
L'avant veille, nous avions crapahuté, Maman comme d'habitude nous avait laissé lorsque nous avions commencé la descente. Nous nous étions retrouvés tous les deux sur un rocher à ras de l'eau, et nous avions pissé de concert, dans un ressac entre deux roches. Je lui dis que ça faisait comme une chasse d'eau, et Papa me confia qu'un jour, seul, il avait chié là, souvenir délicieux. Nous en avons ri, fort. Au retour, sur le chemin des douaniers, je me suis retourné pour le prendre en photo, il avait ce grand sourire que nous avions échangé en bas, il me fit un salut de la main. Les jours suivants je me suis rappelé de ce cliché, j'ai fait développé la pellicule mais cette photo était brûlée, foutue.
Le soir à l'hôtel, je me suis senti malade, fiévreux, je suis resté dans ma chambre le lendemain. Le soir venu, Papa de retour de la falaise me dit qu'il avait trouvé un nouvel endroit encore mieux pour observer, il voulait absolument me le faire découvrir. Mais j'étais encore malade, on se dit que l'on verrait au petit-déjeuner si j'allais mieux. On prit ce petit-déjeuner tous les deux, moment très rare, unique fois ? Il était venu me réveiller dans ma chambre, vraiment soucieux de mon état, j'en étais touché, et en prenant le petit-déjeuner on a convenu que je n'étais définitivement pas assez en forme pour l'accompagner.
Ils sont partis avec la CX jusqu'au parking du phare, à trois ou quatre kilomètres de l'hôtel. Ils ont marché ensemble jusqu'à l'endroit menant à sa nouvelle découverte, Maman est restée sur le sentier, puis elle est rentrée à l'hôtel à pied. Vers onze heure elle a commencé à s'inquiéter, moi non, je me foutais un peu d'elle. Vers 11h30, son angoisse commença à me gagner, et à midi n'y tenant plus nous avons décidé d'aller à pied au phare.
A chaque virage de ces quelques kilomètres j'espérais voir surgir la CX, j'écoutais chaque bruit de moteur, et au fur à mesure du chemin notre angoisse devenait plus vive. En voyant la CX toujours garée sur le parking du phare, je crois que nous avions déjà presque compris. Nous nous sommes précipité dans la loge du gardien qui était là. Non, on ne lui avait rien signalé. Il avait sûrement oublié le temps face au spectacle, on s'inquiétait sûrement pour rien. A ce moment là, à la radio, on entend qu'un corps a été découvert au pied de la falaise, au ras de l'eau. On a grimpé dans la camionnette du gardien, qui nous a emmené sur les lieux. Il y avait plusieurs véhicules, gendarmes et pompiers. C'était assez confus, on nous a tenu à l'écart, au loin on apercevait des dizaines de personnes en arc de cercle au bord de la falaise, le regard braqué en bas. C'est là que nous avons entendu plus de précision sur le corps: "Homme cinquante ans environ". Je me souviens, Maman demandant au pompier resté près de nous : "Mais il est mort ??". Et lui répondant, haussant les épaules : "Ben, oui".
KO debout, j'ai tout de suite senti que ce tremblement de terre tremblerait toute ma vie. Après tout est comme embrouillardé, mais je me rappelle presque de chaque détail. Nous avons été pris en charge par deux gendarmes, un jeune visiblement ému, et un vieux expérimenté. Le corps n'était pas atteignable par la falaise, les pompiers ont dû venir en Zodiac pour le chercher par la mer. On est monté dans la 4L des gendarmes qui nous ont emmené à la caserne des pompiers, je crois que c'était à Saint Cast le Guildo. Là nous avons pu voir le corps. Il n'était presque pas abîmé, il avait l'air calme, les yeux fermés, juste une profonde entaille de quelques centimètres sur la droite de son front.
Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, nous n'avons pas dormi, nous avons discuté toute la nuit avec Maman. Nous avons écarté tout de suite l'hypothèse du suicide, impossible, il était trop heureux ces jours-ci. Un médecin légiste fit un rapport, montrant que Papa portait des baskets à semelles lisses ce jour-là. Il avait plu la veille, la lande était détrempée, et remontant la falaise il aurait glissé sur son dernier appui, le médecin ajoutant qu'il avait vu la trace de la glissade. Il aurait basculé en arrière dans le vide, se serait brisé la nuque, et serait donc mort avant même d'avoir touché le rocher. Je ne sais pas par quelle force, mais cette nuit-là avec Maman nous avons su positiver, oui, positiver. Nous nous sommes dit qu'il était mort heureux, dans la force de l'âge, sans souffrir, enfin débarrassé des fardeaux hérités, et que loin d'être une chute, sa mort était un envol. L'envol du Martinet.
Il a dû juste avoir le temps de se dire : "Merde".
Cette nuit-là, aussi, je me suis promis de ne pas rajouter de souci à ma mère, et je me tins bien sage les années suivantes.
Laurent nous a rejoint le lendemain; il a vécu le drame à distance, ses souvenirs sont ici.
Mon père étant maire, nous avons eu droit à quelques égards. Le maire d'une commune voisine (Matignon je crois, ou Plévenon comme l'écrit mon frère ?) nous prêta son gymnase pour garder le corps avant son rapatriement. C'est là que nous l'avons revu, Laurent pour la première fois. Le sac blanc, la fermeture éclair. Cette fois-ci il était livide, gris, ses poils de barbe avaient poussé, et quelques hématomes étaient apparus sur le visage, le torse et les bras. Ensuite c'est un retour de nuit, l'assurance nous avait envoyé un chauffeur qui ramena la CX, et nous dedans. Des amis nous attendaient dans notre maison d'Urzy, les plus proches bien sûr, ils nous ont pris en main nous n'avions rien à faire. Le corps est arrivé le lendemain, je me souviens de l'entrée de la voiture dans la cour, les amis autour. On l'installa dans le bureau de Maman, dans l'aile gauche sur mon dessin, cercueil fermé. Ce fût le défilé des adjoints éplorés, puis l'enterrement. Le lycée avait affrété un ou plusieurs bus, tout le parti communiste était là (je me souviens de leur gerbe), les résistants, les autres politiques, les profs et les élèves. Plus de mille personnes, une sono avait été installée devant le porche de la petite église d'Urzy pour les personnes restées à l'extérieur. La cérémonie fut célébrée par un prêtre ouvrier, chauffeur-livreur, devant le cercueil recouvert du drapeau tricolore, et c'était beau. Je n'avais pas tout à fait 16 ans. Il n'était pas Ambroise Croizat, mais ce fût un bel enterrement, et les personnes présentes - vivantes - s'en souviennent encore.
************************************************************************************************************************************
Le Vivier de mon enfance. Mon plus beau dessin.
Au pire moment de sa dépression, il était allé se reposer dans une clinique (psychiatrique ?) de la région parisienne, et il devait se faire opérer du dos. Il se sentait tellement faible qu'il redoutait l'anesthésie générale, au point de rédiger ce texte à notre intention. Deux larmes sont tombées sur le papier, je ne sais pas si ce sont les siennes, où les nôtres quand nous avons lu ce texte pour la première fois.
Après sa mort nous nous sommes rapprochés de Mémé, comme il nous y enjoignait à la fin de sa lettre, bien au-delà du peu de relations que nous avions nouées lors de tous ces dimanches mornes et silencieux. La mort de son fils unique était pour elle l'ultime épreuve d'une vie qui en était jalonnée. Nous avons alors eu quelques moments doux et chauds entre elle et nous. Elle s'ouvrit peu à peu, et face à nos questions elle nous déroulait quelques souvenirs de son enfance, qui ressemblaient aux chroniques de Papa. Nous l'avons accompagné comme nous avons pu jusqu'à sa mort, qu'elle attendait impatiemment ("héla qu'c'est long ! Héla qu'j'm'ennuie !"), et qu'elle rencontra dans son lit, dans ce même lit de cette même chambre de cette même maison où ses parents adorés étaient morts et où elle était née.
Nous en héritâmes, ainsi que de quelques arpents de bonnes terres cultivables, à peine 5 hectares acquis parcelle par parcelle sur plusieurs générations. Nous vendîmes le tout, je crois pour 50 000 francs chacun. Il n'y avait vraiment rien d'autre à en tirer, la maison nous semblait minuscule, le village n'est pas accueillant, ni joli, la campagne alentours, ravagée par le remembrement, n'a plus aucun charme, et c'était bien là l'autre souffrance de Papa.
Et c'est ainsi que nous ne sommes plus paysans.
Dans mon souvenir, je garde nettes quelques odeurs de Papa (le bois, la mousse, la poudre), le son de sa voix (enregistrez vos proches ! C'est au moins aussi fort qu'une photo, la voix, et on l'oublie...), son sourire rare et son rire plus encore. De physique comme d'esprit, il avait un air de famille avec Yves Montand (physique), Jacques Brel (physique et esprit, c'était l'artiste de ses 20 ans en 1957, à peine plus âgé que lui), et Gérard Philippe (esprit), qu'il admirait, et dont la mort l'avait profondément marqué, comme toute sa génération. Pour vous faire une idée, Papa était une composition de ces trois là. Quelque chose de Lino Ventura aussi, surtout le prof d'histoire-géo qu'il campe dans "La gifle".
Par-dessus tout, dans mon esprit, il incarne toujours l'autorité, la sévérité, l'austérité, l'honnêteté, le travail acharné, le charisme, la justice et l'honneur. L'humanisme et l'idéalisme, aussi.
Lourd, dit mon frère. Ecrasant ? Comment pousser à l'ombre d'un grand arbre ? Même abattu ?
Il incarne aussi pour toujours la première médaille de vie accrochée à mon coeur : celle reçue pour l'avoir fait sourire et rire jusqu'aux oreilles, les deux dernières années de sa vie.
Nous en héritâmes, ainsi que de quelques arpents de bonnes terres cultivables, à peine 5 hectares acquis parcelle par parcelle sur plusieurs générations. Nous vendîmes le tout, je crois pour 50 000 francs chacun. Il n'y avait vraiment rien d'autre à en tirer, la maison nous semblait minuscule, le village n'est pas accueillant, ni joli, la campagne alentours, ravagée par le remembrement, n'a plus aucun charme, et c'était bien là l'autre souffrance de Papa.
Et c'est ainsi que nous ne sommes plus paysans.
Dans mon souvenir, je garde nettes quelques odeurs de Papa (le bois, la mousse, la poudre), le son de sa voix (enregistrez vos proches ! C'est au moins aussi fort qu'une photo, la voix, et on l'oublie...), son sourire rare et son rire plus encore. De physique comme d'esprit, il avait un air de famille avec Yves Montand (physique), Jacques Brel (physique et esprit, c'était l'artiste de ses 20 ans en 1957, à peine plus âgé que lui), et Gérard Philippe (esprit), qu'il admirait, et dont la mort l'avait profondément marqué, comme toute sa génération. Pour vous faire une idée, Papa était une composition de ces trois là. Quelque chose de Lino Ventura aussi, surtout le prof d'histoire-géo qu'il campe dans "La gifle".
Par-dessus tout, dans mon esprit, il incarne toujours l'autorité, la sévérité, l'austérité, l'honnêteté, le travail acharné, le charisme, la justice et l'honneur. L'humanisme et l'idéalisme, aussi.
Lourd, dit mon frère. Ecrasant ? Comment pousser à l'ombre d'un grand arbre ? Même abattu ?
Il incarne aussi pour toujours la première médaille de vie accrochée à mon coeur : celle reçue pour l'avoir fait sourire et rire jusqu'aux oreilles, les deux dernières années de sa vie.
Papa à 28 ans peint par son vieil ami André Claudot.
Impossible de terminer cette branche paternelle sans évoquer l'un de nos plus illustres ancêtres : l'arrière grand-père d'Edouard, le grand-père de sa mère Adélaïde née Coignet, épouse de François Charrault, j'ai nommé Jean-Roch Coignet, le célèbre Capitaine auteur des non moins célèbres "Carnet du Capitaine Coignet", grognard de l'Empereur, vieux de la vieille Garde Impériale, de tous les combats entre 1799 et 1815.
A la fin de sa vie (il est mort à Auxerre en 1865 à 89 ans), il vendait son bouquin dans les auberges, en faisant la réclame :
"16 campagnes, 48 batailles, 0 blessures, 5 francs, c'est pas cher payé !"
Ses descendants habitent toujours le nord du département, entre Perroy et Ciez. Ils sont distributeurs de fioul. Nous nous y arrêtions parfois avec Papa le dimanche de retour de chez Mémé. Il faut que je les recontacte.
Premier soldat fait Chevalier de la Légion d'Honneur remise par l'Empereur himself aux Invalides le 14 juillet 1804, puis Officier le 3 juillet 1812. Il ne fut autorisé à porter le titre d'Officier qu'en 1847, après une ordonnance sur les Légions remises pendant l'épisode des 100 jours.
Novembre 2017, grand débat national sur la Légion d'Honneur. C'est sûr ça ne vaut pas le coiffeur de Sarkozy.
A la fin de sa vie (il est mort à Auxerre en 1865 à 89 ans), il vendait son bouquin dans les auberges, en faisant la réclame :
"16 campagnes, 48 batailles, 0 blessures, 5 francs, c'est pas cher payé !"
Ses descendants habitent toujours le nord du département, entre Perroy et Ciez. Ils sont distributeurs de fioul. Nous nous y arrêtions parfois avec Papa le dimanche de retour de chez Mémé. Il faut que je les recontacte.
Premier soldat fait Chevalier de la Légion d'Honneur remise par l'Empereur himself aux Invalides le 14 juillet 1804, puis Officier le 3 juillet 1812. Il ne fut autorisé à porter le titre d'Officier qu'en 1847, après une ordonnance sur les Légions remises pendant l'épisode des 100 jours.
Novembre 2017, grand débat national sur la Légion d'Honneur. C'est sûr ça ne vaut pas le coiffeur de Sarkozy.
Humble héros oublié, au parcours quasi-magique. Les balles, les boulets, les coups de sabre l'évitent et le contournent. Ses coups sont presque toujours fatals. Il est très malin, aussi. Pour rentrer dans la Garde Impériale, n'ayant pas la taille, et sur les conseils de son officier, il glisse un paquet de cartes sous chacun de ses pieds pour passer sous la toise. Comme le héros astronaute du sublime film "Bienvenue à Gattaca".
Son témoignage est souvent repris par les historiens comme l'un des plus directs et fidèles de la période.
Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Russie... Ces aventures sont tellement extraordinaires et incroyables qu'elles ont été portées à la télévision dans un délicieux téléfilm de 1969. Tiens, si vous avez six heures devant vous :
Son témoignage est souvent repris par les historiens comme l'un des plus directs et fidèles de la période.
Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Russie... Ces aventures sont tellement extraordinaires et incroyables qu'elles ont été portées à la télévision dans un délicieux téléfilm de 1969. Tiens, si vous avez six heures devant vous :
Texte écrit à deux avec mon frère Laurent.
"Les généalogies parallèles, où comment nous avons rencontré notre demi-oncle".
Samedi 19 octobre 2019, 18 heures. J’attends mon frère Laurent, qui à l’orée de ses 50 ans, et dans une période de profonds changements, a décidé de relier Conflans-Sainte-Honorine à Nevers en bicyclette, en suivant la Seine puis l’Yonne, crochetant par Vézelay.
C’est que nous avons rendez-vous le lendemain dans le Donziais, sur les traces de nos racines paternelles. De ce côté de l'arbre familial, notre ancêtre le plus lointain d’après les archives est un Paul Martinet, né à Perroy en 1625.
Voilà des mois et des années que nous enquêtons autour de la personnalité de notre grand-père Eugène Martinet, (1909-1965) mort avant même que nous soyons conçus. Notre père Jean-Claude (1937-1988) n’aimait pas parler de lui.
Au chapitre des ancêtres, il préférait nous conter la légende de son grand-père maternel Edouard Charrault (1881-1954), survivant de Verdun, paysan mais aussi chef cuisinier. A l’époque, d’Entrains-sur-Nohain à Donzy, pas de mariage réussi sans le colin “sauce Charrault”, une délicieuse recette au beurre.
Après avoir quitté la ferme qu’ils louaient et exploitaient au hameau de Bréau, nos grand-parents Eugène et Renée ont vécu leurs dernières années à Ciez, dans la petite maison héritée d’Edouard. C’est dans ce même village que nous avons rendez-vous avec une tante de notre père, Jacqueline Martinet, fille de Georges, un des trois frères d’Eugène. Nous ne nous rappelons pas que notre taiseux de père, pas plus que notre Mémé ne nous aient jamais parlé d’elle.
Nous avions quasiment renoncé à faire la lumière sur Eugène, avant que je tombe par hasard, lors de la Fête de Loire de Marseille-les Aubigny fin août 2019, sur Aude Martinet, une petite cousine du Cher (Beffes) grâce à qui nous avons pu remonter quelques branches de l’arbre. C’est la grand-mère d’Aude, Régine qui nous apprend que Jacqueline vit encore, et qu’elle garde encore bien vive toute la mémoire de ce passé.
Jacqueline habite en plein milieu du bourg, dans une petite maison semblable à celle de notre grand-mère. A plus de 80 ans, elle est toujours en forme. Elle a l’air si contente de nous retrouver, nous qu’elle a connu enfants, quand elle était épicière et que nous venions lui acheter des paquets “surprise” avec les cinq francs que nous avait donné Mémé. La dernière fois qu’elle nous a aperçu c’était à l’enterrement de Mémé (1995) ; la fois d’avant c’était à celui de Papa. Nous ne nous étions ni parlé, ni même salué. Pourtant – cela me surprend et me touche - elle a gardé deux articles du Journal du Centre, à l’époque où mes aventures audiovisuelles nivernaises intéressaient la presse locale. A distance, elle nous suivait.
Georges Chalons, son mari, est toujours là auprès d’elle, en pleine forme : une tête d’acteur américain, coiffé comme Reagan mais en tout blanc. Tu lui mets un chapeau, c’est un cowboy de western. La classe à l’ancienne, à la John Wayne.
Nous n’avons jusqu’à présent sur Eugène (ils prononcent « Ugène » à Ciez) que des informations soigneusement filtrées.
D’abord ce que notre père a confié à notre mère au fil de leur vingt ans de vie commune: que c’était un bel homme, chaleureux, drôle, aimé de tous. Mais aussi qu’il y avait dans le village, au sein d’une autre famille, un homme qui lui ressemblait étrangement, et auquel il avait été lié par une sorte d’affection.
Ensuite, le portrait qu’il en faisait pour nous: c’était un bon cultivateur, particulièrement doué pour aider une vache ou une jument à mettre bas grâce à un don presque surnaturel de communication avec les animaux. Si les choses se présentaient mal, c’est lui qu’on appelait à l’aide dans tous les hameaux des environs. Il ajoutait quelquefois avec solennité que son père lui avait inculqué la franchise comme valeur principale. Mais nous avions aussi appris que pendant des années, le fils avait refusé d’adresser la parole au père, et que celui-ci en avait beaucoup souffert.
Du grand-père, nous avons aussi hérité d’une clarinette, qui est censée lui avoir appartenu. Un puzzle, mais avec beaucoup de pièces manquantes. Du coup, nous le voyons tantôt comme une sorte de chaman magnétique, tantôt comme un type un peu fruste, comparé au Grand-Père Charrault. Nous n’arrivons pas à le cerner, Eugène. A vrai dire, quelques mois avant de mourir, notre père avait lâché un lourd aveu à Laurent. Agé d’une dizaine d’années, il avait assisté à l’humiliation publique de son père dans un des cafés du village. Une propriétaire terrienne avec laquelle Eugène était en bisbille lui avait balancé ses quatre vérités devant toute l’assistance: il avait plusieurs maîtresses, et au moins un enfant illégitime. Papa avait alors reconnu qu’à cet instant, l’image paternelle s’était “effondrée” en lui, fracassante chute de piédestal. La franchise…
Eugène a-t-il épousé Renée par intérêt, pour ses quelques parcelles de terre ? Edouard a-t-il organisé leur union, voyant dans ce jeune homme bien bâti un laboureur capable de faire fructifier le patrimoine ? Ca, c’est le destin accompli par Georges Chalons, qui a fait passer son exploitation de 15 à 80 hectares en fin de carrière. C’est sans doute cette efficacité que souhaitait Edouard, et Renée aussi.
Jacqueline confirme le portrait d’Eugène en bon vivant, en homme aimable, toujours prêt à rendre service. En homme à femmes aussi, mais attention, « il n’a jamais forcé personne », elle insiste là-dessus. Par contre, il n’avait pas l’air très doué pour s’occuper de la ferme. “Son frère Georges lui reprochait de ne pas récolter autant qu’il aurait pu” se rappelle Georges Chalons. Quant à ses dons avec les animaux, “tous les paysans savaient faire vêler leurs vaches”, balaye-t-il. Bim, bam. Et si cette histoire d’Eugène appelé au secours dans les fermes lointaines lui avait simplement servi d’excuse pour aller voir ses maîtresses, une excuse à laquelle notre père aurait choisi de croire toute sa vie? Il avait aussi raconté à notre mère les longues soirées d’angoisse, seul avec Renée, à attendre le retour du héros. L’attendre pour manger, puis manger sans lui. L’attendre pour aller se coucher, puis se coucher sans l’avoir embrassé.
Cultiver, moyennement, donc. Mais semer, oui. Ensemencer, même. Des choux, et pis des roses aussi.
Nous connaissons le nom de la famille dont un des enfants ressemblait de si près à notre grand-père. Ce sont les Simon, qui avaient une ferme voisine de la sienne à Bréau. Il y a quelques années, Laurent avait tenté de tirer les vers du nez de Roland, l’aîné. Rien à faire. Parce qu’en fait c’est Marcel, le cadet, qu’il aurait fallu aller voir. Jacqueline et Georges nous indiquent où le trouver, lieu-dit « Les Blanchards », au fond du hameau de Villegeneray, trois kilomètres après le bourg de Ciez. Depuis tout ce temps nous passions à côté de lui, il passait à côté de nous.
Nous appelons d’abord un fils, Florian, qui habite aussi Villegeneray et dont le numéro est dans l’annuaire.
- “Bonjour, votre papa a bien connu notre grand-père, nous aimerions le rencontrer pour qu’il nous en parle”.
Florian n’a pas l’air surpris, il nous donne un numéro de portable pour qu’on puisse prévenir de notre visite. Ca ne décroche pas, messagerie. Alors on bondit dans le Golf, et on file aux Blanchards sous la pluie froide d’octobre.
Marie-Thérèse, la femme de Marcel, nous ouvre la porte. Elle non plus n’a même pas l’air surprise de voir deux Martinet débouler ce dimanche dans ce trou perdu. Et voilà Marcel, tiré de sa sieste, qui sort d’une chambre, un peu dépenaillé. Est-ce qu’il sait? Qu’est-ce qu’il sait? Comment aborder le sujet? Laurent tourne un peu autour du pot, “Eugène, vous l’aimiez bien, vous le connaissiez bien?”. Marcel commence par raconter deux ou trois trucs, notamment que c’est Eugène qui l’a amené un jour en voiture à l’hôpital où il devait passer des radios. Une attention à laquelle il semble toujours sensible. Et puis il lève son regard vers nous et lâche:
- “Ben Eugène… c’est le papa…”
C’est “le papa”, même pas c’est “mon papa”, n’empêche que voilà, on a retrouvé notre demi-oncle, et même s’il est tout amaigri et ralenti par des pépins de santé, il est devant nous l’homme dont tout Ciez parle comme du portrait craché de notre grand-père. Marcel est né en 1943, alors qu’Auguste Simon, le mari de Marie-Rose, est en Allemagne au STO. Quand il revient, elle a le ventre plein, classique. Auguste n’en dira jamais un mot à Marcel, mais ne le traitera jamais comme son fils à part entière. C’est Roland, l’aîné, qui gardera la ferme tandis que Marcel travaillera comme technicien agricole.
Ca se voyait comme le nez au milieu de la figure, et il habitait dans la cour en face de son géniteur. Il ressemblait plus à son vrai Papa que notre Papa. Tout le monde savait. Sa mère Marie-Rose a tenu à être présente à l’enterrement d’Eugène en 1965, avec à ses côtés son fils de 22 ans en tenue militaire, preuve vivante que les gènes d’Eugène l’habitaient au moins autant que le fils légitime, et qu’elle était aussi veuve que notre Mémé Renée.
Mais personne n’a rien dit à Marcel jusqu’en 1967. C’est seulement quand il se met en ménage avec Marie-Thérèse, issue d’une famille du village, qu’elle met les points sur les i. “Tu es un Martinet!” Eugène, malgré les marques d’affection, n’a rien reconnu, Marie-Rose n’a rien expliqué. En fait, nous sommes les premiers Martinet à faire acte de reconnaissance, ce dimanche 20 octobre 2019. Ni vraiment Simon ni officiellement Martinet, Marcel aura passé toute sa vie entre deux familles. Quand notre père Jean-Claude, qui avait passé son brevet de pilote, venait de Nevers survoler avec nostalgie son merdier familial, Marcel regardait passer son petit avion, confondu d’admiration et sûrement d’envie.
“Eugène et ses copines!” se rappelle Jacqueline. C’est comme cela qu’on parlait de lui, c’était un coureur proverbial, l’étalon du canton. “On était deux ou trois dans ce cas-là”, ajoute aussi Marcel Simon. Notre père était fils unique, mais voilà que la famille s’agrandit ! Eugène aurait eu un autre enfant illégitime avant la naissance de Papa, et aussi une fille, née en 1956 dans une autre famille de Bréau.
Eugène avait même pris pour maîtresse la tante Lucienne, veuve de son frère Norbert. Son mystère reste épais, même si nous avons pu nous en approcher un peu plus près. Pourquoi une telle frénésie amoureuse? Il y a des clés à trouver dans la génération d’avant. Son père, Paulin, c’est Voldemort dans Harry Potter, personne n’aime prononcer son nom chez les Martinet. Nous-même ne l’avons découvert que très récemment, en mettant le nez dans un arbre généalogique qu’avait établi notre père. Côté Charrault, il a poussé ses recherches au plus loin. C’est qu’il y avait du prestige à retrouver, avec le fameux Abbé Charrault, historien local auquel Jean Genet joua des tours quand il était enfant de choeur à Alligny-en-Morvan, ou grâce à l’alliance avec la famille Coignet, dont est issu l’illustre Jean-Roch, premier soldat du rang à être décoré de la légion d’honneur. Côté Martinet, notre père s’est vite arrêté. Paulin, père d’Eugène, et puis rien.
Jacqueline nous sort une photo, et pour la première fois nous voyons Paulin, entouré de ses quatre fils (Norbert, Georges, Marcel dit « Tinet » et Eugène), de sa fille Madeleine, de sa femme Marguerite, et de trois filles de l’assistance dont le couple s’occupait pour se faire de l’argent. Paulin a une grosse tête, une belle moustache, il porte beau, il ressemble à Gérard Depardieu. Mais apparemment c’était un ogre, un prédateur. Il aurait abusé de Georgette, une des filles placées. Peut-être des autres aussi, rien n’est très clair. Sur la photo, on dirait que sa main touche celle de Georgette, qui est juste à sa droite. Elle s’était plainte à Madeleine, qui n’a rien voulu faire. Il a vraisemblablement fait souffrir tout le monde, et après sa mort à 56 ans, tout le monde a voulu l’oublier. En premier lieu sa femme.
D’une manière ou d’une autre, nous avons l’impression que tous les enfants ont fui leur père. « Tinet » est carrément parti au Canada où les Martinet ont pris racine, Norbert est mort jeune, Eugène a couru toute sa vie, Madeleine est montée à Paris pour se marier avec un richard des Halles qui la prêtait à ses amis; seul Georges a vécu une vie apparemment stable, bien planté à Ciez.
"Les généalogies parallèles, où comment nous avons rencontré notre demi-oncle".
Samedi 19 octobre 2019, 18 heures. J’attends mon frère Laurent, qui à l’orée de ses 50 ans, et dans une période de profonds changements, a décidé de relier Conflans-Sainte-Honorine à Nevers en bicyclette, en suivant la Seine puis l’Yonne, crochetant par Vézelay.
C’est que nous avons rendez-vous le lendemain dans le Donziais, sur les traces de nos racines paternelles. De ce côté de l'arbre familial, notre ancêtre le plus lointain d’après les archives est un Paul Martinet, né à Perroy en 1625.
Voilà des mois et des années que nous enquêtons autour de la personnalité de notre grand-père Eugène Martinet, (1909-1965) mort avant même que nous soyons conçus. Notre père Jean-Claude (1937-1988) n’aimait pas parler de lui.
Au chapitre des ancêtres, il préférait nous conter la légende de son grand-père maternel Edouard Charrault (1881-1954), survivant de Verdun, paysan mais aussi chef cuisinier. A l’époque, d’Entrains-sur-Nohain à Donzy, pas de mariage réussi sans le colin “sauce Charrault”, une délicieuse recette au beurre.
Après avoir quitté la ferme qu’ils louaient et exploitaient au hameau de Bréau, nos grand-parents Eugène et Renée ont vécu leurs dernières années à Ciez, dans la petite maison héritée d’Edouard. C’est dans ce même village que nous avons rendez-vous avec une tante de notre père, Jacqueline Martinet, fille de Georges, un des trois frères d’Eugène. Nous ne nous rappelons pas que notre taiseux de père, pas plus que notre Mémé ne nous aient jamais parlé d’elle.
Nous avions quasiment renoncé à faire la lumière sur Eugène, avant que je tombe par hasard, lors de la Fête de Loire de Marseille-les Aubigny fin août 2019, sur Aude Martinet, une petite cousine du Cher (Beffes) grâce à qui nous avons pu remonter quelques branches de l’arbre. C’est la grand-mère d’Aude, Régine qui nous apprend que Jacqueline vit encore, et qu’elle garde encore bien vive toute la mémoire de ce passé.
Jacqueline habite en plein milieu du bourg, dans une petite maison semblable à celle de notre grand-mère. A plus de 80 ans, elle est toujours en forme. Elle a l’air si contente de nous retrouver, nous qu’elle a connu enfants, quand elle était épicière et que nous venions lui acheter des paquets “surprise” avec les cinq francs que nous avait donné Mémé. La dernière fois qu’elle nous a aperçu c’était à l’enterrement de Mémé (1995) ; la fois d’avant c’était à celui de Papa. Nous ne nous étions ni parlé, ni même salué. Pourtant – cela me surprend et me touche - elle a gardé deux articles du Journal du Centre, à l’époque où mes aventures audiovisuelles nivernaises intéressaient la presse locale. A distance, elle nous suivait.
Georges Chalons, son mari, est toujours là auprès d’elle, en pleine forme : une tête d’acteur américain, coiffé comme Reagan mais en tout blanc. Tu lui mets un chapeau, c’est un cowboy de western. La classe à l’ancienne, à la John Wayne.
Nous n’avons jusqu’à présent sur Eugène (ils prononcent « Ugène » à Ciez) que des informations soigneusement filtrées.
D’abord ce que notre père a confié à notre mère au fil de leur vingt ans de vie commune: que c’était un bel homme, chaleureux, drôle, aimé de tous. Mais aussi qu’il y avait dans le village, au sein d’une autre famille, un homme qui lui ressemblait étrangement, et auquel il avait été lié par une sorte d’affection.
Ensuite, le portrait qu’il en faisait pour nous: c’était un bon cultivateur, particulièrement doué pour aider une vache ou une jument à mettre bas grâce à un don presque surnaturel de communication avec les animaux. Si les choses se présentaient mal, c’est lui qu’on appelait à l’aide dans tous les hameaux des environs. Il ajoutait quelquefois avec solennité que son père lui avait inculqué la franchise comme valeur principale. Mais nous avions aussi appris que pendant des années, le fils avait refusé d’adresser la parole au père, et que celui-ci en avait beaucoup souffert.
Du grand-père, nous avons aussi hérité d’une clarinette, qui est censée lui avoir appartenu. Un puzzle, mais avec beaucoup de pièces manquantes. Du coup, nous le voyons tantôt comme une sorte de chaman magnétique, tantôt comme un type un peu fruste, comparé au Grand-Père Charrault. Nous n’arrivons pas à le cerner, Eugène. A vrai dire, quelques mois avant de mourir, notre père avait lâché un lourd aveu à Laurent. Agé d’une dizaine d’années, il avait assisté à l’humiliation publique de son père dans un des cafés du village. Une propriétaire terrienne avec laquelle Eugène était en bisbille lui avait balancé ses quatre vérités devant toute l’assistance: il avait plusieurs maîtresses, et au moins un enfant illégitime. Papa avait alors reconnu qu’à cet instant, l’image paternelle s’était “effondrée” en lui, fracassante chute de piédestal. La franchise…
Eugène a-t-il épousé Renée par intérêt, pour ses quelques parcelles de terre ? Edouard a-t-il organisé leur union, voyant dans ce jeune homme bien bâti un laboureur capable de faire fructifier le patrimoine ? Ca, c’est le destin accompli par Georges Chalons, qui a fait passer son exploitation de 15 à 80 hectares en fin de carrière. C’est sans doute cette efficacité que souhaitait Edouard, et Renée aussi.
Jacqueline confirme le portrait d’Eugène en bon vivant, en homme aimable, toujours prêt à rendre service. En homme à femmes aussi, mais attention, « il n’a jamais forcé personne », elle insiste là-dessus. Par contre, il n’avait pas l’air très doué pour s’occuper de la ferme. “Son frère Georges lui reprochait de ne pas récolter autant qu’il aurait pu” se rappelle Georges Chalons. Quant à ses dons avec les animaux, “tous les paysans savaient faire vêler leurs vaches”, balaye-t-il. Bim, bam. Et si cette histoire d’Eugène appelé au secours dans les fermes lointaines lui avait simplement servi d’excuse pour aller voir ses maîtresses, une excuse à laquelle notre père aurait choisi de croire toute sa vie? Il avait aussi raconté à notre mère les longues soirées d’angoisse, seul avec Renée, à attendre le retour du héros. L’attendre pour manger, puis manger sans lui. L’attendre pour aller se coucher, puis se coucher sans l’avoir embrassé.
Cultiver, moyennement, donc. Mais semer, oui. Ensemencer, même. Des choux, et pis des roses aussi.
Nous connaissons le nom de la famille dont un des enfants ressemblait de si près à notre grand-père. Ce sont les Simon, qui avaient une ferme voisine de la sienne à Bréau. Il y a quelques années, Laurent avait tenté de tirer les vers du nez de Roland, l’aîné. Rien à faire. Parce qu’en fait c’est Marcel, le cadet, qu’il aurait fallu aller voir. Jacqueline et Georges nous indiquent où le trouver, lieu-dit « Les Blanchards », au fond du hameau de Villegeneray, trois kilomètres après le bourg de Ciez. Depuis tout ce temps nous passions à côté de lui, il passait à côté de nous.
Nous appelons d’abord un fils, Florian, qui habite aussi Villegeneray et dont le numéro est dans l’annuaire.
- “Bonjour, votre papa a bien connu notre grand-père, nous aimerions le rencontrer pour qu’il nous en parle”.
Florian n’a pas l’air surpris, il nous donne un numéro de portable pour qu’on puisse prévenir de notre visite. Ca ne décroche pas, messagerie. Alors on bondit dans le Golf, et on file aux Blanchards sous la pluie froide d’octobre.
Marie-Thérèse, la femme de Marcel, nous ouvre la porte. Elle non plus n’a même pas l’air surprise de voir deux Martinet débouler ce dimanche dans ce trou perdu. Et voilà Marcel, tiré de sa sieste, qui sort d’une chambre, un peu dépenaillé. Est-ce qu’il sait? Qu’est-ce qu’il sait? Comment aborder le sujet? Laurent tourne un peu autour du pot, “Eugène, vous l’aimiez bien, vous le connaissiez bien?”. Marcel commence par raconter deux ou trois trucs, notamment que c’est Eugène qui l’a amené un jour en voiture à l’hôpital où il devait passer des radios. Une attention à laquelle il semble toujours sensible. Et puis il lève son regard vers nous et lâche:
- “Ben Eugène… c’est le papa…”
C’est “le papa”, même pas c’est “mon papa”, n’empêche que voilà, on a retrouvé notre demi-oncle, et même s’il est tout amaigri et ralenti par des pépins de santé, il est devant nous l’homme dont tout Ciez parle comme du portrait craché de notre grand-père. Marcel est né en 1943, alors qu’Auguste Simon, le mari de Marie-Rose, est en Allemagne au STO. Quand il revient, elle a le ventre plein, classique. Auguste n’en dira jamais un mot à Marcel, mais ne le traitera jamais comme son fils à part entière. C’est Roland, l’aîné, qui gardera la ferme tandis que Marcel travaillera comme technicien agricole.
Ca se voyait comme le nez au milieu de la figure, et il habitait dans la cour en face de son géniteur. Il ressemblait plus à son vrai Papa que notre Papa. Tout le monde savait. Sa mère Marie-Rose a tenu à être présente à l’enterrement d’Eugène en 1965, avec à ses côtés son fils de 22 ans en tenue militaire, preuve vivante que les gènes d’Eugène l’habitaient au moins autant que le fils légitime, et qu’elle était aussi veuve que notre Mémé Renée.
Mais personne n’a rien dit à Marcel jusqu’en 1967. C’est seulement quand il se met en ménage avec Marie-Thérèse, issue d’une famille du village, qu’elle met les points sur les i. “Tu es un Martinet!” Eugène, malgré les marques d’affection, n’a rien reconnu, Marie-Rose n’a rien expliqué. En fait, nous sommes les premiers Martinet à faire acte de reconnaissance, ce dimanche 20 octobre 2019. Ni vraiment Simon ni officiellement Martinet, Marcel aura passé toute sa vie entre deux familles. Quand notre père Jean-Claude, qui avait passé son brevet de pilote, venait de Nevers survoler avec nostalgie son merdier familial, Marcel regardait passer son petit avion, confondu d’admiration et sûrement d’envie.
“Eugène et ses copines!” se rappelle Jacqueline. C’est comme cela qu’on parlait de lui, c’était un coureur proverbial, l’étalon du canton. “On était deux ou trois dans ce cas-là”, ajoute aussi Marcel Simon. Notre père était fils unique, mais voilà que la famille s’agrandit ! Eugène aurait eu un autre enfant illégitime avant la naissance de Papa, et aussi une fille, née en 1956 dans une autre famille de Bréau.
Eugène avait même pris pour maîtresse la tante Lucienne, veuve de son frère Norbert. Son mystère reste épais, même si nous avons pu nous en approcher un peu plus près. Pourquoi une telle frénésie amoureuse? Il y a des clés à trouver dans la génération d’avant. Son père, Paulin, c’est Voldemort dans Harry Potter, personne n’aime prononcer son nom chez les Martinet. Nous-même ne l’avons découvert que très récemment, en mettant le nez dans un arbre généalogique qu’avait établi notre père. Côté Charrault, il a poussé ses recherches au plus loin. C’est qu’il y avait du prestige à retrouver, avec le fameux Abbé Charrault, historien local auquel Jean Genet joua des tours quand il était enfant de choeur à Alligny-en-Morvan, ou grâce à l’alliance avec la famille Coignet, dont est issu l’illustre Jean-Roch, premier soldat du rang à être décoré de la légion d’honneur. Côté Martinet, notre père s’est vite arrêté. Paulin, père d’Eugène, et puis rien.
Jacqueline nous sort une photo, et pour la première fois nous voyons Paulin, entouré de ses quatre fils (Norbert, Georges, Marcel dit « Tinet » et Eugène), de sa fille Madeleine, de sa femme Marguerite, et de trois filles de l’assistance dont le couple s’occupait pour se faire de l’argent. Paulin a une grosse tête, une belle moustache, il porte beau, il ressemble à Gérard Depardieu. Mais apparemment c’était un ogre, un prédateur. Il aurait abusé de Georgette, une des filles placées. Peut-être des autres aussi, rien n’est très clair. Sur la photo, on dirait que sa main touche celle de Georgette, qui est juste à sa droite. Elle s’était plainte à Madeleine, qui n’a rien voulu faire. Il a vraisemblablement fait souffrir tout le monde, et après sa mort à 56 ans, tout le monde a voulu l’oublier. En premier lieu sa femme.
D’une manière ou d’une autre, nous avons l’impression que tous les enfants ont fui leur père. « Tinet » est carrément parti au Canada où les Martinet ont pris racine, Norbert est mort jeune, Eugène a couru toute sa vie, Madeleine est montée à Paris pour se marier avec un richard des Halles qui la prêtait à ses amis; seul Georges a vécu une vie apparemment stable, bien planté à Ciez.
De gauche à droite en deuxième rang debout : Eugène, une fille de l’assistance, Norbert, Une fille de l’assistance, Georges ; premier rang : la petite Gerogette de l’assistance, Paulin, Marie-Madeleine, Marguerite et Marcel « Tinet »
Nous comprenons maintenant que ce nom, Martinet, a recouvert dans ce petit coin du nord-est Nivernais tout un voile noir, de silence, de non-dits, de tabous et de moqueries. Nous comprenons que notre père a dû avoir du mal avec ce nom, du mal à le porter avec honneur, du mal à en être fier. Nous comprenons qu’il a voulu que nous oubliions ce passé pour que nous puissions le porter sans souffrir. Et puissions aussi le transmettre à nos enfants sans trop d’encombre.
Eugène était un jouisseur, c’est entendu. Apparemment, il assumait. Etait-il un esprit libre, affranchi des codes de la morale et des bonnes manières ? Etait-il un moderne, en avance sur son temps ? Il voulait sans doute le bien pour tous et toutes, il ne pensait sans doute pas faire de mal, et pourtant…
Eugène était un jouisseur, c’est entendu. Apparemment, il assumait. Etait-il un esprit libre, affranchi des codes de la morale et des bonnes manières ? Etait-il un moderne, en avance sur son temps ? Il voulait sans doute le bien pour tous et toutes, il ne pensait sans doute pas faire de mal, et pourtant…
Notre père est mort accidentellement à 50 ans en Bretagne, après avoir plus ou moins surmonté une dépression nerveuse carabinée. Sa mère Renée, est encore restée quelques années avec nous, la tristesse incarnée. Quant à Marcel, sa vie n'a vraisemblablement pas été un long fleuve tranquille. Pour les deux autres dont nous venons d'apprendre l'existence, ils resteront un mystère.
Ah au fait, vous ne connaissez pas mon deuxième prénom ? C’est Eugène.
Samedi 7 mai 2022, 150 kms, trois cimetières et quelques survivants dans le viseur de ma petite 750 ailée, sur les traces de nos racines paternelles.
Départ de Nevers, premier arrêt au cimetière d'Urzy pour voir Papa et lui raconter la journée qui vient : nous allons rendre visite à ses grands-parents et parents avec Jacqueline, sa dernière cousine en vie. Je lui promets de penser fort à lui, ça ne sera pas difficile.
Je traverse un océan de verdure en remontant le Val de Nièvre par les petites routes sinueuses, bucoliques et printanières, puis j’arrive à Perroy, deuxième arrêt, deuxième cimetière. Pour la première fois je vais sur la tombe de Paulin et Marguerite, mes arrière-grands-parents paternels. Pourquoi Papa ne nous y avait-il jamais emmené ? Nous commençons aujourd’hui à avoir tous les éléments de réponse. Aucun de leurs enfants n’est enterré avec eux, ils ont une grande tombe pour eux tous seuls.
Paulin avait 4 fils : Eugène notre grand-père, Norbert mort à la guerre, Georges le Papa de Jacqueline, et Marcel, et une fille Marie-Madeleine. La force de répulsion de Paulin les a tous envoyé aux quatre coins du département, et au-delà jusqu’au Québec pour Marcel, le dernier, le petit surnommé « Tinet » ; toute une branche de Martinet est aujourd’hui bien greffée là-bas.
Nous nous retrouvons ensuite avec mon frère Laurent et sa fille aînée Alice à Bouhy, que nous ne connaissons presque que de nom.
Laurent a repéré une fontaine sacrée du IVème siècle, sans doute même bien avant, très anciens rites païens, animistes presque, petite source nichée dans un repli entre deux mamelons à l’ombre de grands arbres dont de beaux chênes séculaires. C’est la Fontaine Saint Pèlerin, désormais dominée par une rangée d’éoliennes.
L’histoire dit que jusqu’au milieu du XXème siècle, les très catholiques paysans du coin payaient le denier du culte avec des pièces romaines, tant il y en avait dans les champs alentours.
Mon copain Yvan, lui aussi originaire du coin, m’a recommandé le boucher de Bouhy, pour son célèbre filet mignon fumé. A la base, mon frère voulait pique-niquer au bord de la fontaine, mais nous voyons un restaurant attenant à la boucherie, juste en face de l’église. La queue devant celle-ci nous rebute, et nous décidons de tenter le restaurant qui date de 1629.
Il est à peine midi, nous entrons. Une vieille porte basse à droite donne sur le café tabac (très basse la porte, je me la prendrai sur le haut du front en repartant pour payer l’addition, ils étaient petits à l’époque), avec un magnifique comptoir et de grandes tables en bois pour les clients. En plus du tabac, les patrons ont également une station-service. La patronne nous reçoit sans emphase, elle nous jauge pour voir si on va l’ennuyer ou pas. Elle n’a qu’un plat du jour : poulet au riz.
Nous repassons par l’entrée pour pousser l’autre vieille porte à gauche, là nous découvrons une grande salle comme figée dans les années 1920, longues tables en bois, vieux papiers peints floraux, Christ en croix, grands miroirs, carrelages, petits tableaux de chasse, nappes en papier et verres de cantine. Nul effort pour y projeter des images de banquets formidables et bruyants, réunions familiales de mariages, de baptêmes et d’enterrements à travers les siècles.
Laurent engage la discussion quand la patronne nous sert l’entrée, des betteraves rouges et un peu de charcuterie. Il lui explique ce que nous venons faire dans le coin, notre quête, et que nous allons rendre visite à notre cousine Jacqueline Chalons née Martinet.
La patronne, qui contre toute apparence est jeune, nous dit que si on veut elle peut appeler la mère du patron qui loge au-dessus. Nous acquiesçons, elle repart et revient vite avec une adorable vieille dame en blouse, très souriante, qui s’assoit à notre table, bonjour Bernadette.
- « Je la connais bien la Jacqueline, elle habitait à Bouhy avec ses parents, son père était roulier : il allait chercher les arbres abattus dans les forêts et charroyer les troncs jusqu’à Saint Fargeau avec de grands chariots tirés par deux chevaux. »
Pendant ce temps-là, je demande à la patronne si je peux passer commande à la boucherie directement depuis le restaurant pour deux filets-mignon. Oui, c’est possible, ça va elle se détend, esquisse même un sourire, finalement nous ne sommes pas des Parisiens et nous ne semblons ni bien méchants ni trop exigeants.
La vieille grand-mère n’est pas avare de souvenirs et d’anecdotes, au contraire elle est même bien contente de nous parler, au fur-à-mesure un tas d’autres images lui reviennent. Elle connaissait bien Gilbert Martinet aussi, un autre cousin de mon père, fils de Norbert, que j’ai salué plus tôt au cimetière de Perroy. Il était garde-champêtre à Bouhy, et servait les enfants à la cantine. On le voyait tous les jours, c’était un bon copain, un vieux garçon. Il n’avait jamais voulu passer le permis de conduire, le code c’était trop compliqué pour lui, alors il avait fini par s’acheter une voiturette électrique. Il est mort assis à son volant, crise cardiaque à l’arrêt dans sa cour. Décidément pas fait pour la bagnole.
Moi aussi je me rappelle très bien Gilbert, car c’est le premier mort que j’ai vu de ma vie, allongé sur son lit dans la maison de sa mère Lucienne, nous lui avions rendu visite avec Papa qui était très ému.
Je m’en rappelle d’autant mieux que le deuxième mort que je vis, ce fut Papa lui-même, et cette coïncidence me frappe : Gilbert est mort lui-aussi en 1988, juste quelques semaines avant Papa.
Bernadette la petite grand-mère nous quitte, nous enjoignant de passer le bonjour à Jacqueline.
Direction Ciez maintenant, nous allons chez Jacqueline (93 ans) et Georges (97 ans). Voilà quelques années que nous avons renoué avec eux. Les mystères, les secrets, les tensions et les jalousies familiales ont fait que nous n’avons jamais été proches d’eux par le passé. Nous allions presque tous les dimanches à Ciez chez notre Mémé, parfois nous allions à l’épicerie nous acheter des pochettes-surprises avec les cinq francs que Mémé nous donnait, mais personne n’avait trouvé judicieux de nous dire que l’épicière était notre cousine Jacqueline. Nous n’avions même jamais rencontré son mari Georges.
Leur fille Marie-Noëlle nous rejoint, Georges est allé la prévenir à vélo (97 ans !) et nous voilà six assis dans la cuisine autour de la table ronde et sa toile cirée. Bien sûr, ils ont encore un peu vieilli depuis la dernière fois, il faut parler de plus en plus fort, tout répéter trois fois. Mais le dialogue s’engage petit à petit, comme à chaque fois, et les anecdotes arrivent.
Jacqueline est contente d’avoir des nouvelles de Bernadette, elles habitent à six kilomètres et ne sont pas vues depuis des années. Elle nous raconte son enfance à Bouhy, nous confirme que son père était roulier, avant de reprendre plus tard une ferme en exploitation.
On parle de Gilbert le cousin garde-champêtre, Jacqueline se souvient que c’est elle qui est allée chez Mémé ce jour-là pour lui apprendre la triste nouvelle, c'était sans doute un dimanche car nous étions là. Peu de temps avant, son frère Jacques était mort, et cela avait déjà beaucoup affecté Papa qui s’était rendu à son enterrement et avait passé toute la journée avec ses cousin-e-s. Alors d’apprendre qu’un deuxième cousin venait de partir, ça lui avait fait un choc, et Jacqueline se rappelle qu’il s’était pris la tête dans les mains en s’écriant « Oh non, mes cousins ! »
Quelques mois plus tard c’était son tour, trois cousins germains partis en moins de six mois, sinistre loi des séries.
Je propose à tous que nous nous rendions ensemble au cimetière de Ciez, comme ça Jacqueline pourra clairement nous resituer les uns et les autres allongés là. Elle est bien fatiguée mais accepte la promenade au soleil, il fait beau et doux. Notre grand-père Eugène est là avec notre Mémé Renée, à trois tombes de son frère Georges et de sa femme Berthe, les parents de Jacqueline.
De retour à la maison dans le bourg, je leur demande s’ils ont des souvenirs de la guerre, des Allemands. Jacqueline nous dit qu’ils en avaient quatre qui vivaient dans leur maison à Bouhy, et qu’ils étaient très gentils. Ils disaient : « La guerre pas bon ». Il y en a même un qui leur donnait du chocolat, "enfin qu’aux filles". Elle les aimait tellement bien, que quand elle voyait passer des résistants, elle avait peur pour eux.
J’enchaîne sur l’histoire des soldats allemands qui seraient toujours enterrés aux abords du village. Et là, Georges me plante son regard bleu perçant dans les yeux et se met à nous raconter toute l’histoire qu’il connait sur le bout des doigts.
C’était suite à une escarmouche entre un camion allemand et un groupe de résistants, sur la route d’Entrains-sur-Nohain. Il y avait eu du dégât, et deux soldats avaient réussi à s’échapper de l’embuscade. Ils s’étaient enfuis à travers bois, puis avaient débouché au bord d’un champ où les hommes faisaient le battage du blé avec la moissonneuse mécanique. L’un des deux était blessé, alors le valide était venu parler aux hommes pour leur demander s’ils avaient un cheval à lui vendre pour transporter son camarade blessé. Les hommes semblaient d’accord, ils l’accompagnèrent dans une écurie plus loin pour voir les bêtes. Mais dans cette écurie était caché un réfugié, et lorsqu’il les vit arriver, il proposa aux paysans de « se les faire ».
Ils sautèrent alors sur le dos de l’Allemand valide qui se débattit si bien qu’il réussit à s’enfuir. Pas loin, pas longtemps, il fut rattrapé, entre temps son copain avait eu son compte, alors un trou fut vite creusé et les deux types foutus dedans sans autre forme de procès.
Une autre fois, un camion de la Résistance avait traversé le village, et croisant un groupe d'Allemands à pied, ils avaient tiré une rafale sur eux, faisant un mort. En représailles, les Allemands revinrent en nombre pour demander des comptes au Maire, Monsieur Emile Prêtre. Celui-ci les attendait en sabot au café, conscient de ce qui allait arriver, et il se laissa embarquer sans résistance, puis déporter jusqu’en Allemagne dont il ne revint jamais. Courageux, Monsieur le Maire, héroïque même, car son sacrifice a sans doute évité de nombreuses souffrances à ses administrés.
Quelques années après-guerre, des fouilles furent entreprises pour retrouver les deux Allemands et leur rendre une sépulture digne, mais en vain.
Nous quittons Jacqueline, Georges et Marie-Noëlle, je prends quelques photos, et nous allons maintenant à Bréau, le petit hameau à côté de Ciez où nos grands-parents exploitaient la ferme dans laquelle notre Papa est né, et dont il parle si bien dans son texte « Mon Village ».
Nous ne sommes pas sûrs de retrouver la bonne ferme, il y en a deux ou trois, toutes très semblables, et nos souvenirs d’enfance sont trop vagues. Alors nous interrogeons les rares personnes que nous apercevons afférées ici et là devant leurs maisons. Bonne pioche : un couple est dans son hangar en train de mettre en pot du miel, nous nous présentons et ils nous demandent :
- « Vous êtes les Martinet ? »
Ils sont au courant de notre visite ! Mon copain Yvan a fait circuler l’info et le texte de Papa dans sa famille, sa mère, sa tante, et cette dernière l’a passé à son amie qui se tient devant nous. Ils savent tout : la ferme, et le fameux chemin vert si cher à Papa. Elle va nous montrer.
Finalement elle est là devant nous, cette ferme familiale dont nous connaissons tant d’histoires, le grand bâtiment agricole séparé de la maison d’habitation, et dans la cour, cette grande pompe à eau et le vieux chêne dont parle Papa, tout est là sous nos yeux, tout droit sorti du passé mais toujours en vie.
Sur la droite, un joli chemin herbeux descend en un « S » sinueux vers un bosquet tout vert, puis tourne à gauche en direction du village et se perd dans les champs. Est-ce lui le fameux "Chemin vert" ? Mon frère et sa fille s'y engagent, je les regarde s'éloigner, ensuite ils rentreront chez eux à Conflans-Sainte-Honorine, j'enfourche mon engin et reprends la route qui me ramène doucement d'hier à aujourd'hui.
Quel beau printemps, je ne le sais pas encore mais demain matin dimanche la Loire m'attend.
Ah au fait, vous ne connaissez pas mon deuxième prénom ? C’est Eugène.
Samedi 7 mai 2022, 150 kms, trois cimetières et quelques survivants dans le viseur de ma petite 750 ailée, sur les traces de nos racines paternelles.
Départ de Nevers, premier arrêt au cimetière d'Urzy pour voir Papa et lui raconter la journée qui vient : nous allons rendre visite à ses grands-parents et parents avec Jacqueline, sa dernière cousine en vie. Je lui promets de penser fort à lui, ça ne sera pas difficile.
Je traverse un océan de verdure en remontant le Val de Nièvre par les petites routes sinueuses, bucoliques et printanières, puis j’arrive à Perroy, deuxième arrêt, deuxième cimetière. Pour la première fois je vais sur la tombe de Paulin et Marguerite, mes arrière-grands-parents paternels. Pourquoi Papa ne nous y avait-il jamais emmené ? Nous commençons aujourd’hui à avoir tous les éléments de réponse. Aucun de leurs enfants n’est enterré avec eux, ils ont une grande tombe pour eux tous seuls.
Paulin avait 4 fils : Eugène notre grand-père, Norbert mort à la guerre, Georges le Papa de Jacqueline, et Marcel, et une fille Marie-Madeleine. La force de répulsion de Paulin les a tous envoyé aux quatre coins du département, et au-delà jusqu’au Québec pour Marcel, le dernier, le petit surnommé « Tinet » ; toute une branche de Martinet est aujourd’hui bien greffée là-bas.
Nous nous retrouvons ensuite avec mon frère Laurent et sa fille aînée Alice à Bouhy, que nous ne connaissons presque que de nom.
Laurent a repéré une fontaine sacrée du IVème siècle, sans doute même bien avant, très anciens rites païens, animistes presque, petite source nichée dans un repli entre deux mamelons à l’ombre de grands arbres dont de beaux chênes séculaires. C’est la Fontaine Saint Pèlerin, désormais dominée par une rangée d’éoliennes.
L’histoire dit que jusqu’au milieu du XXème siècle, les très catholiques paysans du coin payaient le denier du culte avec des pièces romaines, tant il y en avait dans les champs alentours.
Mon copain Yvan, lui aussi originaire du coin, m’a recommandé le boucher de Bouhy, pour son célèbre filet mignon fumé. A la base, mon frère voulait pique-niquer au bord de la fontaine, mais nous voyons un restaurant attenant à la boucherie, juste en face de l’église. La queue devant celle-ci nous rebute, et nous décidons de tenter le restaurant qui date de 1629.
Il est à peine midi, nous entrons. Une vieille porte basse à droite donne sur le café tabac (très basse la porte, je me la prendrai sur le haut du front en repartant pour payer l’addition, ils étaient petits à l’époque), avec un magnifique comptoir et de grandes tables en bois pour les clients. En plus du tabac, les patrons ont également une station-service. La patronne nous reçoit sans emphase, elle nous jauge pour voir si on va l’ennuyer ou pas. Elle n’a qu’un plat du jour : poulet au riz.
Nous repassons par l’entrée pour pousser l’autre vieille porte à gauche, là nous découvrons une grande salle comme figée dans les années 1920, longues tables en bois, vieux papiers peints floraux, Christ en croix, grands miroirs, carrelages, petits tableaux de chasse, nappes en papier et verres de cantine. Nul effort pour y projeter des images de banquets formidables et bruyants, réunions familiales de mariages, de baptêmes et d’enterrements à travers les siècles.
Laurent engage la discussion quand la patronne nous sert l’entrée, des betteraves rouges et un peu de charcuterie. Il lui explique ce que nous venons faire dans le coin, notre quête, et que nous allons rendre visite à notre cousine Jacqueline Chalons née Martinet.
La patronne, qui contre toute apparence est jeune, nous dit que si on veut elle peut appeler la mère du patron qui loge au-dessus. Nous acquiesçons, elle repart et revient vite avec une adorable vieille dame en blouse, très souriante, qui s’assoit à notre table, bonjour Bernadette.
- « Je la connais bien la Jacqueline, elle habitait à Bouhy avec ses parents, son père était roulier : il allait chercher les arbres abattus dans les forêts et charroyer les troncs jusqu’à Saint Fargeau avec de grands chariots tirés par deux chevaux. »
Pendant ce temps-là, je demande à la patronne si je peux passer commande à la boucherie directement depuis le restaurant pour deux filets-mignon. Oui, c’est possible, ça va elle se détend, esquisse même un sourire, finalement nous ne sommes pas des Parisiens et nous ne semblons ni bien méchants ni trop exigeants.
La vieille grand-mère n’est pas avare de souvenirs et d’anecdotes, au contraire elle est même bien contente de nous parler, au fur-à-mesure un tas d’autres images lui reviennent. Elle connaissait bien Gilbert Martinet aussi, un autre cousin de mon père, fils de Norbert, que j’ai salué plus tôt au cimetière de Perroy. Il était garde-champêtre à Bouhy, et servait les enfants à la cantine. On le voyait tous les jours, c’était un bon copain, un vieux garçon. Il n’avait jamais voulu passer le permis de conduire, le code c’était trop compliqué pour lui, alors il avait fini par s’acheter une voiturette électrique. Il est mort assis à son volant, crise cardiaque à l’arrêt dans sa cour. Décidément pas fait pour la bagnole.
Moi aussi je me rappelle très bien Gilbert, car c’est le premier mort que j’ai vu de ma vie, allongé sur son lit dans la maison de sa mère Lucienne, nous lui avions rendu visite avec Papa qui était très ému.
Je m’en rappelle d’autant mieux que le deuxième mort que je vis, ce fut Papa lui-même, et cette coïncidence me frappe : Gilbert est mort lui-aussi en 1988, juste quelques semaines avant Papa.
Bernadette la petite grand-mère nous quitte, nous enjoignant de passer le bonjour à Jacqueline.
Direction Ciez maintenant, nous allons chez Jacqueline (93 ans) et Georges (97 ans). Voilà quelques années que nous avons renoué avec eux. Les mystères, les secrets, les tensions et les jalousies familiales ont fait que nous n’avons jamais été proches d’eux par le passé. Nous allions presque tous les dimanches à Ciez chez notre Mémé, parfois nous allions à l’épicerie nous acheter des pochettes-surprises avec les cinq francs que Mémé nous donnait, mais personne n’avait trouvé judicieux de nous dire que l’épicière était notre cousine Jacqueline. Nous n’avions même jamais rencontré son mari Georges.
Leur fille Marie-Noëlle nous rejoint, Georges est allé la prévenir à vélo (97 ans !) et nous voilà six assis dans la cuisine autour de la table ronde et sa toile cirée. Bien sûr, ils ont encore un peu vieilli depuis la dernière fois, il faut parler de plus en plus fort, tout répéter trois fois. Mais le dialogue s’engage petit à petit, comme à chaque fois, et les anecdotes arrivent.
Jacqueline est contente d’avoir des nouvelles de Bernadette, elles habitent à six kilomètres et ne sont pas vues depuis des années. Elle nous raconte son enfance à Bouhy, nous confirme que son père était roulier, avant de reprendre plus tard une ferme en exploitation.
On parle de Gilbert le cousin garde-champêtre, Jacqueline se souvient que c’est elle qui est allée chez Mémé ce jour-là pour lui apprendre la triste nouvelle, c'était sans doute un dimanche car nous étions là. Peu de temps avant, son frère Jacques était mort, et cela avait déjà beaucoup affecté Papa qui s’était rendu à son enterrement et avait passé toute la journée avec ses cousin-e-s. Alors d’apprendre qu’un deuxième cousin venait de partir, ça lui avait fait un choc, et Jacqueline se rappelle qu’il s’était pris la tête dans les mains en s’écriant « Oh non, mes cousins ! »
Quelques mois plus tard c’était son tour, trois cousins germains partis en moins de six mois, sinistre loi des séries.
Je propose à tous que nous nous rendions ensemble au cimetière de Ciez, comme ça Jacqueline pourra clairement nous resituer les uns et les autres allongés là. Elle est bien fatiguée mais accepte la promenade au soleil, il fait beau et doux. Notre grand-père Eugène est là avec notre Mémé Renée, à trois tombes de son frère Georges et de sa femme Berthe, les parents de Jacqueline.
De retour à la maison dans le bourg, je leur demande s’ils ont des souvenirs de la guerre, des Allemands. Jacqueline nous dit qu’ils en avaient quatre qui vivaient dans leur maison à Bouhy, et qu’ils étaient très gentils. Ils disaient : « La guerre pas bon ». Il y en a même un qui leur donnait du chocolat, "enfin qu’aux filles". Elle les aimait tellement bien, que quand elle voyait passer des résistants, elle avait peur pour eux.
J’enchaîne sur l’histoire des soldats allemands qui seraient toujours enterrés aux abords du village. Et là, Georges me plante son regard bleu perçant dans les yeux et se met à nous raconter toute l’histoire qu’il connait sur le bout des doigts.
C’était suite à une escarmouche entre un camion allemand et un groupe de résistants, sur la route d’Entrains-sur-Nohain. Il y avait eu du dégât, et deux soldats avaient réussi à s’échapper de l’embuscade. Ils s’étaient enfuis à travers bois, puis avaient débouché au bord d’un champ où les hommes faisaient le battage du blé avec la moissonneuse mécanique. L’un des deux était blessé, alors le valide était venu parler aux hommes pour leur demander s’ils avaient un cheval à lui vendre pour transporter son camarade blessé. Les hommes semblaient d’accord, ils l’accompagnèrent dans une écurie plus loin pour voir les bêtes. Mais dans cette écurie était caché un réfugié, et lorsqu’il les vit arriver, il proposa aux paysans de « se les faire ».
Ils sautèrent alors sur le dos de l’Allemand valide qui se débattit si bien qu’il réussit à s’enfuir. Pas loin, pas longtemps, il fut rattrapé, entre temps son copain avait eu son compte, alors un trou fut vite creusé et les deux types foutus dedans sans autre forme de procès.
Une autre fois, un camion de la Résistance avait traversé le village, et croisant un groupe d'Allemands à pied, ils avaient tiré une rafale sur eux, faisant un mort. En représailles, les Allemands revinrent en nombre pour demander des comptes au Maire, Monsieur Emile Prêtre. Celui-ci les attendait en sabot au café, conscient de ce qui allait arriver, et il se laissa embarquer sans résistance, puis déporter jusqu’en Allemagne dont il ne revint jamais. Courageux, Monsieur le Maire, héroïque même, car son sacrifice a sans doute évité de nombreuses souffrances à ses administrés.
Quelques années après-guerre, des fouilles furent entreprises pour retrouver les deux Allemands et leur rendre une sépulture digne, mais en vain.
Nous quittons Jacqueline, Georges et Marie-Noëlle, je prends quelques photos, et nous allons maintenant à Bréau, le petit hameau à côté de Ciez où nos grands-parents exploitaient la ferme dans laquelle notre Papa est né, et dont il parle si bien dans son texte « Mon Village ».
Nous ne sommes pas sûrs de retrouver la bonne ferme, il y en a deux ou trois, toutes très semblables, et nos souvenirs d’enfance sont trop vagues. Alors nous interrogeons les rares personnes que nous apercevons afférées ici et là devant leurs maisons. Bonne pioche : un couple est dans son hangar en train de mettre en pot du miel, nous nous présentons et ils nous demandent :
- « Vous êtes les Martinet ? »
Ils sont au courant de notre visite ! Mon copain Yvan a fait circuler l’info et le texte de Papa dans sa famille, sa mère, sa tante, et cette dernière l’a passé à son amie qui se tient devant nous. Ils savent tout : la ferme, et le fameux chemin vert si cher à Papa. Elle va nous montrer.
Finalement elle est là devant nous, cette ferme familiale dont nous connaissons tant d’histoires, le grand bâtiment agricole séparé de la maison d’habitation, et dans la cour, cette grande pompe à eau et le vieux chêne dont parle Papa, tout est là sous nos yeux, tout droit sorti du passé mais toujours en vie.
Sur la droite, un joli chemin herbeux descend en un « S » sinueux vers un bosquet tout vert, puis tourne à gauche en direction du village et se perd dans les champs. Est-ce lui le fameux "Chemin vert" ? Mon frère et sa fille s'y engagent, je les regarde s'éloigner, ensuite ils rentreront chez eux à Conflans-Sainte-Honorine, j'enfourche mon engin et reprends la route qui me ramène doucement d'hier à aujourd'hui.
Quel beau printemps, je ne le sais pas encore mais demain matin dimanche la Loire m'attend.